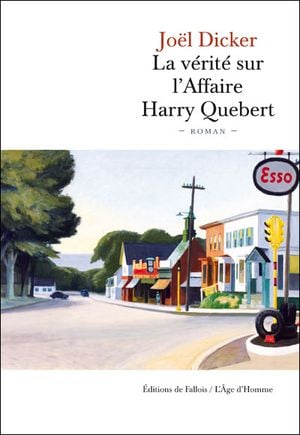Ce pavé de 800 pages aux prix littéraires prestigieux et aux critiques élogieuses s’avère être une véritable arnaque. Il est question dans ce livre d’une enquête policière, en gros, sur le cadavre d’une jeune fille de quinze ans, Nola, retrouvé enterré dans le jardin d’un écrivain célèbre et adulé, Harry Quebert. Son disciple, Marcus Goldman, un jeune écrivain tout aussi talentueux mais en panne d’inspiration après la publication de son premier roman, décide de disculper son ami qui risque la peine capitale. Car bien sûr, il est persuadé que ce n’est pas lui qui l’a tuée. Seulement, la tâche ne s’annonce pas facile : il se trouve que Harry avait entretenu une relation amoureuse avec elle jusqu’à sa mort. Déterminé à prouver son innocence, Marcus se lance alors dans une véritable investigation au sein de la petite ville de bord de mer Aurora. Pendant ces huit-cents pages il va interroger tout l’entourage de Nola, de son père, le révérend David Kellergan, à Elijah Stern, un riche homme propriétaire de la maison de Harry que la jeune fille aurait fréquenté régulièrement, et son chauffeur Luther Caleb, en passant par les propriétaires du Clark’s, dont la fille était tombée amoureuse de Quebert, deux amies d’enfance de Nola et quelques policiers.
A chaque début de chapitre, le mentor de Marcus se charge de lui donner des conseils d’une pertinence, on peut le dire, discutable sur comment écrire un bon livre qui se vendra bien ponctués de phrases philosophiques telles que « C’est ce que devrait être votre chapitre 2 : une droite dans la mâchoire de votre lecteur » ou « La vie est une longue chute, Marcus. Le plus important est de savoir tomber ».
Les dialogues sont vraiment cliché et d’une prévisibilité pour le moins exaspérante : « -Vous vivez seul ici ? -Bien entendu. Avec qui voulez-vous que je vive ? -Je veux dire : vous n’avez pas de famille ? -Non. -Pas de femme, ni d’enfants ? -Rien. -Une petite copine ? -Pas de petite copine. Rien. ». On dirait un peu un match de ping-pong, et très honnêtement cela n’a vraiment rien de palpitant. On a aussi cette désagréable sensation, à cause de la pauvreté des dialogues notamment, que l’auteur cherche à gagner quelques pages, ce qui n’est pourtant pas nécessaire lorsque l’on voit le pavé que représente ce roman.
D’ailleurs, vers le premier quart du livre, l’auteur semble vouloir nous faire un aveu à travers son personnage de Marcus : « Ecrire bien, c’est si difficile », dit-il. Ce n’est pas très convaincant, en tout cas je pense que ça ne suffit pas à disculper l’éditeur de Joël Dicker. Si l’on se concentre sur les mots qui encadrent cette phrase, on croit en apprendre davantage sur lui : « Je ne sais plus si je suis capable d’écrire. Ecrire bien, c’est si difficile. Mon éditeur m’a proposé d’écrire un livre à propos de cette affaire. Il dit que ça relancerait ma carrière. ». Cette mise en abîme nous révèle en fait la vérité sur l’affaire Joël Dicker.
Quelques pages plus tard, il tente de renverser les clichés : le révérend David Kellergan, qui répare des Harley-Davidson tout en écoutant du jazz à un volume assourdissant « aurait voulu que les étés ne finissent jamais » et « était si fier d’aller au Clark’s et d’entendre combien les clients et la mère Quinn étaient satisfaits d’elle ». Un passage émouvant pour montrer que le réparateur de cette « foutue moto » est, au fond, quelqu’un de sentimental. Pas mal, Joël.
Le personnage de Nola est quelque peu étrange pour ne pas dire ridicule, dépourvu de vraisemblance et de crédibilité, mais surtout d’un niais déconcertant : « J’aime les mouettes ! Ce sont mes oiseaux préférés. ». « Sur ces mots, elle dansa; elle dansa dans le corridor, elle dansa jusque dans le salon, elle dansa sur la terrasse. Elle dansait de bonheur, elle était si émue ». Sa relation avec Harry, qui devrait pourtant être poignante puisque c’est un amour interdit, se résume en fait à des « Nola chérie », « Harry chéri », « Ne partez pas, Harry ! » et des « N.O.L.A » griffonnés à longueur de journée sur les carnets de l’écrivain.
Quant à tout ce qui concerne l’intrigue policière, on ne cesse de nous répéter ce qui s’est passé dans cette sombre nuit d’août 1975, comme si nous lecteurs étions forcément occupés à autre chose durant notre lecture, ce qui est peu aisé pour comprendre l’intrigue sans avoir de rappels toutes les cent pages, il faut l’avouer. Afin de remplir quelques pages supplémentaires pour être sûr de respecter les caractéristiques d’un best-seller, Joël Dicker ponctue également ses dialogues de diverses phrases philosophiques d’une profondeur inégalable telles que « On n’est jamais sûrs de rien […] C’est pour ça que l’existence est parfois si compliquée ».
D’après les propos de beaucoup de personnes, la fin de ce roman était censée être vraiment « incroyable », « inattendue », « extraordinaire », « du jamais-vu », « une succession de coups de théâtre à en couper le souffle… » et j’en passe. En toute honnêteté, j’achève cette lecture sans grand sentiment. Vous allez peut-être croire que je suis dénuée d’émotions, mais j’ai vraiment l’impression que cet ouvrage est une véritable arnaque. L’intrigue policière, qui est sûrement l’aspect le moins inintéressant du roman, était assez bien menée, même si, notamment à cause des passages répétés, c’était tout de même cousu de fil blanc. Certes, il était presque impossible de deviner toute la fin dans ses moindres détails, à moins d’être l’auteur lui-même, mais lorsque l’on vous avertit que vraiment, les dernières pages de "La Vérité sur l’affaire Harry Quebert" sont absolument palpitantes et nous tiennent en haleine jusqu’au bout, je trouve cela exagéré. Lorsque Marcus publie son livre L’affaire Harry Quebert, il doit rester quelques centaines de pages, alors évidemment on se doute que l’enquête est loin d’être résolue. De ce fait, il me semble que durant les innombrables dialogues abrutissants des personnages et les conseils de Harry, on a largement le temps de penser à divers retournements de situation et de se retrouver à lire une fin assez similaire à au moins une des nos hypothèses.
Pour finir, comme le montre très bien la page 209, « un livre, c’est une bataille ».