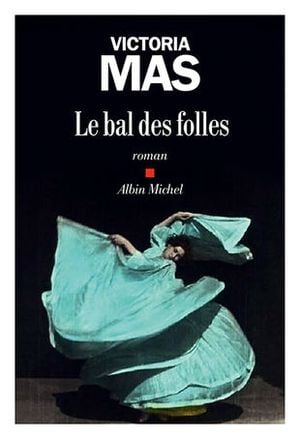Le livre a un sujet passionnant, lourd, sérieux, celui des femmes enfermées dans les asiles parce que trop libres, trop différentes des autres, parfois un peu folles, souvent pas du tout. Charcot, le célèbre médecin s'est juré de les guérir mais il fait surtout de ces femmes l'objet d'un spectacle permanent qui amuse autant les internes de médecine, que les bourgeois et le petit peuple, dont l'apothéose est le bal des Folles, un évènement presque mondain, où le tout Paris se précipite amusé pour observer la galerie. Les corps de ces femmes sont disséqués du regard, elles sont des objets dans les mains de la science positiviste et du patriarcat.
Une toute nouvelle catégorie d’internées se forma dans les différents secteurs de l’enceinte : on les nomme hystériques, épileptiques, mélancoliques, maniaques ou démentielles. Les chaînes et les haillons laissèrent place à l’expérimentation sur leurs corps malades : les compresseurs ovariens parvenaient à calmer les crises d’hystérie ; l’introduction d’un fer chaud dans le vagin et l’utérus réduisait les symptômes cliniques ; les psychotropes - nitrite d’amyle, éther, chloroforme - calmaient les nerfs des filles ; l’application de métaux divers - zinc et aimants - sur les membres paralysés avait de réels effets bénéfiques. Et, avec l’arrivée de Charcot au milieu du siècle, la pratique de l’hypnose devint la nouvelle tendance médicale. Les cours publics du vendredi volaient la vedette aux pièces de boulevard, les internées étaient les nouvelles actrices de Paris, on citait les noms d’Augustine et de Blanche Wittman avec une curiosité parfois moqueuse, parfois charnelle. Car les filles pouvaient désormais susciter le désir. Leur attrait était paradoxal, elles soulevaient les craintes et les fantasmes, l’horreur et la sensualité. (...) C’est de cet intérêt qu’était né, depuis plusieurs années, le bal de la mi-carême, leur bal (....). Le temps d’un soir, un peu de Paris venait enfin à ces femmes qui attendaient tout de cette soirée costumée : un regard, un sourire, une caresse, un compliment, une promesse, une aide, une délivrance.
Victoria Mas semble capter l'esprit de l'époque avec justesse et livre un roman documenté sur le milieu de la psychiatrie. Il faut comprendre ce qu'on résumait jadis : l'hospice ou l'asile c'est plutôt le lieu de l'enfermement que du soin. A défaut de guérir, on éloigne. Ainsi, la mission est davantage sociale que sanitaire, c'est d'ailleurs la mission originelle de l'hospice et de l'asile. Certes l'époque voit des progrès immenses en la matière : on parle désormais d'hystérie, de catalepsie... Les diagnostics sont posés, les corps livrent leurs secrets, des remèdes, tous plus brutaux les uns que les autres existent, temporairement, mais les causes de la démence, si tenté qu'il y ait démence, sont peu connues.
Quand la dernière pierre de l’édifice avait été posée, le tri avait commencé : c’est d’abord les pauvres, les mendiantes, les vagabondes, les clochardes qu’on sélectionnait sur ordre du roi. Puis ce fut au tour des débauchées, des prostituées, des filles de mauvaise vie, toutes ces « fautives » étant amenées en groupe sur des charrettes, leurs visages exposés à l’œil sévère de la populace, leurs noms déjà condamnés par l’opinion publique. Vinrent ensuite les inévitables folles, les séniles et les violentes, les délirantes et les idiotes, les menteuses et les conspirationnistes, gamines comme vieillardes. Rapidement, les lieux s’emplirent de cris et de saleté, de chaînes et de verrous à double tour. Entre l’asile et la prison, on mettait la Salpêtrière ce que Paris ne savait pas gérer : les malades et les femmes.
Il faudra attendre les travaux de Canguilhem dans la première moitié du vingtième siècle pour prendre toute la mesure de ce qu'est la folie par rapport à la normalité, qu'est ce que la pathologie par rapport à la norme, permettant ainsi de considérer de manière plus humaine les malades mentaux et les individus présentant des troubles psychiatriques. D'ailleurs c'est ce que conclue Victoria Mas à la fin du roman :
Maintenant qu'elle était folle parmi les folles, elle paraissait enfin normale.
On pourrait en faire un roman de Zola, tant le sujet s'attarde sur des destins ordinaires de femmes enfermées par une société patriarcale et terriblement conservatrice et le roman cite d'ailleurs l'auteur comme pour se placer dans son héritage.
Mais le livre souffre malheureusement selon moi de quelques facilités d'écriture. Je ne sais pas si ces facilités sont dues au fait qu'il s'agisse d'un premier roman ou bien au fait que ce sont des défauts récurrents dans les oeuvres de notre époque. Je suis à la fois très bien et très mal placé pour en parler puisque moi même je pratique cet exercice, et que je vois donc les limites et les difficultés inhérentes à l'écriture tout en m'intéressant à tout ce qui s'écrit actuellement, mais en ayant très certainement un bon nombre des défauts que je vais citer dès à présent.
La destinée des personnages est parfois prévisible. Pire, l'utilisation du présent est pour moi problématique dans un roman historique et naturaliste, désacralisant même l'objet qu'il s'attarde à décrire, le banalisant. Le style est assez plat, les dialogues mériteraient plus de travail, les descriptions sont laconiques. Le tout est très efficace, aussi efficace que le serait un scénario de film ou de série (c'est de là que vient d'ailleurs Victoria Mas), mais manque d'envergure littéraire.
Dommage car par moment, l'auteure parvient à distiller de l'ironie et bâtir une dramaturgie pour ses personnages, des scènes se faisant écho ou se répondant plus loin dans le livre. Mais elle parle trop en tant que femme du XXème siècle d'un sujet du XIXème. On a le sentiment dans certains paragraphes que ses personnages pensent déjà comme on penserait aujourd'hui.
Ses héroïnes sont trop libres et émancipées pour être pleinement crédibles. Elles ont une vision critique du patriarcat qu'elles n'auraient peut-être pas eu dans la réalité, non pas que la conscience des inégalités de genre n'existait pas, mais le féminisme était très balbutiant. Plus encore, les hommes ici sont présentés avec une forme de détestation un peu caricaturale, comme si tous les hommes étaient égaux dans leur oppression et qu'eux-mêmes ne souffraient pas d'une oppression exercés par une minorité d'hommes sur les autres.
Mais la folie des hommes n'est pas comparable à celle des femmes : les hommes l'exercent sur les autres ; les femmes, sur elles-mêmes.
On trouve des exceptions néanmoins : le frère d'Eugénie, dont on comprend qu'il se soumet à l'ordre social avec malheur. Tous les autres hommes sont au pire des porcs, au mieux des médiocres, malgré la vénération pour Charcot qu'entretiennent les femmes. D'ailleurs sur ce personnage célèbre, il aurait fallu s'attarder un peu plus : souligner plus clairement ses avancées médicales déterminantes et son conservatisme, le paradoxe du personnage.
Il y a des facilités, notamment lorsqu'elle parle d'Eugénie, personnage auquel Victoria Mas semble s'identifier et qui n'a pas vraiment de défauts apparents. Il s'agit d'une jeune fille de 19 ans, bourgeoise, enfermée par son père parce qu'elle parle aux morts. Une jeune fille qui déjà souffre d'être seule chez elle, dans un milieu étriquée. Or, elle se met à citer un auteur contemporain, Zola, alors qu'elle n'a qu'un accès restreint au monde intellectuel qui est réservé aux hommes, comme mentionné dans le roman. C'est d'ailleurs par le biais de son frère qu'elle découvre les sociétés spirites de Paris et le monde intellectuel, avant d'en être privé par l'internement. Autrement dit, l'homme est sa seule ouverture au monde et il est peu vraisemblable que dans cette logique elle est pu lire Zola en toute tranquillité quand on voit les orientations politiques et conservatrices de sa famille.
Autre erreur de construction des personnages : elle cite Geneviève, l'infirmière austère de l'hôpital, comme une femme n'aimant pas la fiction et n'aimant que la science et le concret :
La fiction, au contraire, suscitait les passions, créait des débordements, bouleversait les esprits, elle n’appelait pas au raisonnement ni à la réflexion, mais entraînait les lecteurs - les lectrices surtout - vers le désastre sentimental.
Or, lorsqu'elle se promène à Paris, via le style indirect ou indirect libre, elle parle de fiction, de roman, qu'elle ne lit pourtant pas.
Geneviève examine les alentours avec méfiance. Le calme qui règne sur la place l’étonne. A en croire les journaux et les romans, le quartier semblerait à priori peu séduisant.
Ici c'est l'auteure qui parle, de ses propres recherches documentaires en somme, ce qui entre en contradiction avec son personnage. Bien que Geneviève soit un personnage plus ambivalent qu'il n'y parait, il y a contradiction.
L'autre biais est davantage politique : il met en opposition bourgeois et ouvrier, conservateurs et éclairés, comme si le bourgeois n'était que conservateur (ce qui n'est pas le cas avec Zola par exemple) et l'ouvrier forcément progressiste. Là encore, c'est un biais classique dans les romans, issu de notre monde contemporain qui exagère le manichéisme politique et dénie toute conscience politique individuelle au profit d'une conscience de classe. Or, le problème de ce biais dans un roman, où les personnages sont centraux, c'est que cela les efface, en faisant d'eux une sorte de caricature, d'allégorie un peu lisse de toute une classe sociale, là où l'identification pour le lecteur passe par l'individualité. Victoria Mas fait peu de différence entre la femme bourgeoise et la femme pauvre. Le rapport de classe est stricto sensu un rapport de genre, face aux hommes, qui sont uniformément dominateurs, riches ou pauvres. Comme si genre et classe sociale coïncidaient alors que non.
Parfois aussi l'auteure parle au sein de son roman, commentant, assez justement le plus souvent en utilisant une forme de distanciation ironique, un procédé très intéressant en narratologie, notamment par exemple dans le film Barry Lyndon où le narrateur désacralise l'image à l'écran. Mais parfois elle semble douter d'elle-même et répète ce que pensent ses personnages et ce qu'elle veut sous-entendre alors que le lecteur attentif aura très bien saisi les ressorts du texte. Par exemple, elle rappelle plusieurs fois les motivations de Geneviève, l'infirmière austère de l'hôpital, à aider la jeune Eugénie. Alors qu'on les a comprise par les épreuves qu'elles traversent.
Je regrette que le fond, bien documenté, hormis les quelques défauts que j'ai cité, qui sont plus de l'ordre de la dramaturgie, se passe de la forme. J'aurais aimé plus de profondeur descriptive, dans les maladies, les corps maltraités par la médecine. Il y a une sorte de froideur minimaliste, presque chirurgicale dans les descriptions qui reprennent souvent les mêmes éléments : mains sur les poitrines, tresses qui cascadent sur les épaules, visages blancs, cheveux sales, sans pour autant décrire médicalement la folie. C'est quoi une catatonie, une hystérie, médicalement parlant ? On ne le sait pas vraiment. Cela n'empêche pas quelques réflexions intéressantes :
Thérèse cesse de tricoter et regarde Eugénie en souriant - un sourire froid, que lui ont amené des années de résilience et de détachement.
Ou encore :
Discret et fidèle, ni un regard ni un mot de trop, il était de ces domestiques qui confortent les bourgeois dans leur idée que certains hommes sont faits pour en servir d’autres.
Les dialogues aussi posent des problèmes. Ils sont des dialogues fonctions. C'est à dire que les personnages parlent presque comme ils pensent. Ainsi, un jour, le frère d'Eugénie, regrettant d'avoir été le complice de son odieux père dans l'internement de sa soeur, vient lui rendre visite. Mais cette dernière, à l'isolement ne peut être visitée. Il se confie alors à Geneviève, une femme qu'il ne connait pas, et pas des plus tendres en plus, dévoilant son coeur. Comme si ce grand bourgeois très élégant et maniéré, machiste et conservateur, allait se confesser, dans une époque aussi guindée, qui plus est avec une simple infirmière. Il n'y avait pas besoin ici de faire parler le personnage sur ses atermoiements. Son simple retour à l'hôpital, deux trois mots laconiques, auraient suffi à faire comprendre ce qu'on savait de toute façon déjà, que ce frère a des remords, de l'humanité, qu'il aime sa soeur. Mais non, Victoria Mas lui fait réciter toute son passé histoire qu'on comprenne bien. Il en résulte une situation peu naturelle. Je suis étonné, car elle est une scripte de films et de séries et dans un film cela produirait le même effet bancal et elle doit le savoir. On notera aussi le problème du style des dialogues : s'il se veut parlé voire populaire par instant, il ne le fait pas en se basant vraiment sur l'époque. On ne parlait pas comme aujourd'hui y a 150 ans. Le style est donc un style plus poli, propret, avec des élisions de voyelles pour faire davantage populaire mais en réalité c'est dans le vocabulaire, la grammaire et non dans le ton que les écarts existent avec notre époque. L'absence par exemple de proverbes religieux ou d'expressions vieillies est typique de cette impasse. Elle aurait pu pasticher du Zola assez facilement pour coller aux mots de l'époque, elle ne semble pas l'avoir fait.
Autre situation : Eugénie, inspectée par un amphithéâtre d'interne qui se rebelle et leur dit leur quatre vérités, face à des hommes en position de force, elle qui ne connait pas bien le monde extérieur, qui n'a que 19 ans. Je veux bien que les personnages adolescents soient affirmés, mais là encore c'est peu probable. Elle aurait pu se rebeller, évidemment, et c'est dans la nature de son caractère. Mais elle n'avait pas, selon moi, à étaler toutes les considérations sociales et politiques de ces hommes. Elle se serait condamnée à un enfermement plus grand encore. On dirait en fait que non seulement c'est Victoria Mas qui fait le procès de ces messieurs, mais plus encore que le personnage sait déjà tout de ce milieu qu'elle ne connaît pourtant pas. Elle est quasi omnisciente parce qu'elle dit la réalité du rapport social, elle le formule là où dans la réalité, on ne fait que le pressentir et qu'il faut mûrir, réfléchir, comprendre ce qui se trame pour en tirer la conclusion. Elle dit ce que le lecteur sait. Pas ce qu'elle en tant que personnage devrait savoir.
L'aspect spiritisme ne m'a en revanche pas dérangé. On comprend les prémonitions un peu fantastiques d'Eugénie. En revanche, on ne comprend pas ce qui justifierait une telle prédisposition dans son histoire personnelle, qui n'a aucune zone d'ombre. C'est une fille bien née. Or, le livre s'échine à rationaliser la folie, et à expliquer la réalité sociale et politique des crises de ce genre. Ici, il ne le dit pas. Ses visions sont des solutions narratives pour faire avancer l'histoire. On aurait aussi aimé en savoir plus sur les thèses d'Allan Kardec, cité dans le livre.
Enfin, je noterais aussi les répétions, stylistiques, mais à la rigueur, ce n'est pas très grave. Ça l'est bien plus pour le sujet. Elle évoque plusieurs fois, comme pour nous vendre l'apothéose du roman, le bal des folles, et à chaque fois nous rappelle l'hypocrisie de ce bal. Trois ou quatre fois, ainsi, nous lisons plus ou moins le même paragraphe sur le tout Paris qui viendra se moquer des jeunes femmes, un peu le spot publicitaire du grand final à venir.
Le livre est victime de ce biais contemporain qui consiste à calquer une idée politique sur un fait historique, déformant ainsi le fait lui-même. Ici, la conviction intime de Victoria Mas, conviction plus que louable, déteint sur ses personnages. Or, le romancier doit s'effacer derrière eux. Et sa distanciation critique, qu'elle prend par moment et qu'elle a raison d'utiliser pour marquer un écart entre ses personnages et elle, narratrice, est souvent balayée par l'envie de chérir les personnages qu'elle a imaginé des mois durant, comme s'il s'agissait de ses propres enfants, jusqu'à la complaisance.
Et au final, malgré tout l'intérêt pour ce sujet, malgré le fait qu'elle tenait une histoire en or, Victoria Mas m'a déçu. C'est d'autant plus dommage qu'elle sait ménager certains effets : Charcot qui plane comme une ombre sur tout le roman pour n'apparaitre que brièvement avec force, le bal final, et une fin douce-amère. La thèse que ces femmes sont en fait plus libres que les autres et que c'est pour cette raison même qu'on les enferme est également pertinente. Le roman possède une efficacité certaine. On se transporte immédiatement dans l'histoire des personnages et les lieux décrits. C'est aussi efficace et direct qu'un scénario. Mais il manque la saveur des sous-entendus, des secondes lectures, du verni littéraire. C'est au final trop convenu et trop victime de nos opinions politiques contemporaines pour être un pur roman historique. Le présent de l'indicatif renforce cette impression de platitude et d'attendu.
Il en résulte moins un roman historique qu'un plaidoyer féministe, presque politique où l'intrigue est au service de thèses. Il s'agit de ça, d'un roman à thèse. Le réalisme ne sert pas tant le récit que l'idéologie. Victoria Mas n'écrit pas pour ses personnages mais pour elle-même, et donc par extension, pour nous. Elle ne relate pas une époque mais une époque fantasmée malgré un travail documentaire indéniable. Mais ayant personnellement fait des études d'histoire et qui plus est ayant travaillé un an complet sur les questions de la santé au XIXè et XXè siècle, on est loin avec ce livre d'avoir fait le tour du sujet.
Il restera un récit plaisant et facile à lire, limpide, et un sujet, un vrai sujet, ce qui change de beaucoup de romans qui ne parlent de rien. On retient les situations et les personnages, c'est simple et efficace. Victoria Mas expose une histoire dans un milieu et un contexte original et rare, permettant une plongée vulgarisatrice dans l'histoire mais qui rebutera le lecteur à la recherche d'épaisseur et de ce qui fait au fond la littérature : une profondeur stylistique, psychologique, l'ambivalence, la folie, pas la normalité et la platitude. Je suis sûrement un peu sévère. Mais c'est un roman un peu convenu et trop convenable. Pas fou.