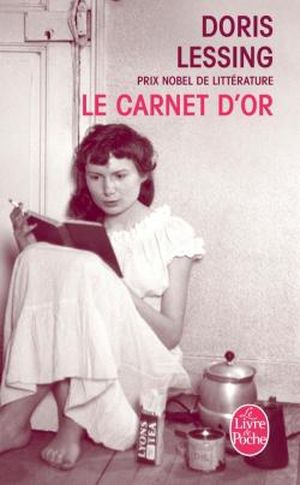Critique vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=lGQGOn4poZQ
Le carnet d’or regroupe plusieurs carnets dans lesquels l’autrice Anna Wulf consigne des éléments de sa vie. Mais au lieu de le faire de manière chronologique comme la plupart des gens qui tiennent un journal, le récit est fragmenté pour chaque domaine, carnet bleu, carnet jaune, carnet noir, et rouge, la politique, l’art, l’intériorité et les relations amoureuses. Et cette manière de faire donne un aperçu disloqué, fragmentaire de ce personnage féminin, qui pourtant se révèle peut-être plus juste que tout récit linéaire que j’ai pu lire jusque-là. C’est donc la question à laquelle on va tenter de répondre : comment se fait-il que la forme du récit, très moderne et déstructurée, rende aussi bien compte de la condition féminine et de l’expérience artistique.
Une forme moderne : la déconstruction narrative, miroir de l’individu fragmenté
Comme nous venons de le dire, le morcellement est mis en scène par différents carnets représentant des aspects de la vie d'Anna. Chaque partie permet de croquer une facette de sa personnalité, et chaque Anna apporte une nuance à la précédente : si l’on pourrait comparer la membre du parti communiste qui se questionne à l’écrivaine en proie au doute, les deux ne sont pourtant pas tout à fait semblables : l’écrivaine est déterminée pendant une partie du roman à ce que son œuvre ne soit pas trahie, alors que la militante semble effacée. Pareil, la confidente clairvoyante qu’elle est avec son amie Molly n’a que peu de choses à voir avec le visage de femme fragile qu’elle présente dans les bras de certains hommes. En fait, cette manière de faire permet de montrer l’extrême fragilité de l’individu. C’est un peu cliché de dire ça, mais nous portons tellement de masques différents selon les situations que nous nous n’existons pas à proprement parler.
Ainsi, s’il est dit par exemple sur Wikipedia que sa personnalité se dérobe grâce ou à cause de ces carnets, je dirais au contraire qu'elle est fidèlement représentée dans sa pluralité, la pluralité de toute personnalité : des carnets, chacun pourrait en avoir des dizaines pour chaque domaine de sa vie,... Par ailleurs, en plus de ces différents textes qui passe de la première à la troisième personne, avec différents alter égo d’Anna, le livre met aussi en scène une période d’après-guerre tout aussi fragmentée, avec des coupures de journaux, comme une histoire qui ne peut se dire qu’entre les blancs, que le lecteur doit faire l’effort de reconstituer autant avec ce qui est dit qu’avec ce qui ne l’est pas l’intrigue.
Expérience féminine
Je crois que c’est ce qui m’a le plus plu dans le livre, la justesse avec laquelle les relations entre hommes et femmes sont peintes. Ça m’a évoqué par moment Sur la route de Kerouac, mais je sentais pour ce livre une sorte de petit sentiment de restée-sur-ma-faim, comme si ce n’était pas tout à fait ça, qu’il manquait quelque chose pour totalement m’envahir. Et je crois que c’est que le point de vue féminin qu’il me manquait : le texte est d’une modernité folle sur le couple ou le sexe, il aurait pu être écrit en 2025 sans changer la moindre virgule. C’est un peu particulier car l’autrice refusait par la suite que son œuvre soit qualifiée de féministe — c’est là où l’on voit à quel point une œuvre échappe à son auteur, le livre est féministe, il n’y a pas à discuter, l’auteur n’a plus aucun droit dessus. Ce n’est pas juste un beau roman de femmes, qui proposent des portraits avec une belle écriture de femme : dans sa manière d’aborder les relations entre les deux sexes, dans la liberté de ton, dans le naturel avec lequel elle écrit les amitiés féminines, la maternité (je pense à ce moment où la fille d’Anna, quitte le nid familial et qu’elle se retrouve seule, comme si elle n’avait jamais eu d’enfant, dit-elle, et c’est si vrai, si réel, si simple). Ça a souvent été ma réaction lors de la lecture, c’est si simple, si vrai, si réel : la relation avec Saul, avec les hommes en général où l’on pourrait croire que la répétitivité des échecs pourraient conduire à quelque chose de très stéréotypé, mais non, chaque histoire se décale un peu de la précédente, s’en nourrit, répète les mêmes erreurs avec d’infimes variations qui rendent le tout très vrai. Être une femme, c’est être divisée, morcelée entre plusieurs rôles, l’amante, la mère, l’écrivaine, et à chaque fois que l’une rejoint l’autre, il y a conflit. On rejoint ce qu’on disait sur la forme, ce roman n’aurait pas pu être écrit autrement — la seule forme possible pour décrire la condition féminine aussi justement, c’est par la déconstruction du récit.
Un roman sur l’art
Dans le second numéro de Chini chini, en parlant de la critique littéraire, je disais que les propositions esthétiques qu’on fait dans un roman peuvent elles-mêmes être qualifiées de critique. Ici, des passages pastichent des romans certainement à la mode à l’époque, des livres à l’eau de rose qui se laissent aller à l’exotisme par exemple vers le milieu – l’idée du roman africain écrit par un blanc qui doit forcément faire appel aux sensations du lecteur, les odeurs, les couleurs, qui doit forcément évoquer des bêtes sauvages, qui doit forcément aborder des amours interdites entre Blancs et Noirs. Mais plus encore, Lessing propose un récit qui ne respecte pas les conventions, ou s’il fait, c’est pour mieux les détourner par la suite. D’ailleurs, au sujet de ce qu’elle comptait faire avec ce livre, elle a déclaré « Je nourrissais l'idée que si le livre était bien construit, il fournirait son propre commentaire sur le roman conventionnel. »
D'ailleurs j'ai eu plusieurs fois la joie et la tristesse de constater qu'elle avait des fulgurances que j'aurais pu avoir, que j'aurais voulu avoir, qui semblaient si évidentes : ce passage vers la fin qui accumule en journal tous les livres avortés d'Anna, les projets de romans que tout auteur a dans un fichier word, qui disent peut-être plus de l'auteur que ceux qu'il a bien poncés pendant des semaines. Ou ce moment où elle fantasme l’adaptation de son roman, et qu’elle ne reconnait pas ce qu’elle a en face des yeux, que son livre lui a échappé, et que ça n’a peut-être aucun rapport avec le film qu’elle a devant les yeux : toute œuvre une fois terminée devient étrangère à son auteur — ce qu’elle voit n’est plus sien, ça ne l’a peut-être jamais été.
Et on comprend en plus que ces projets de romans qui n'aboutissent pas sont en fait le magma souterrain de ce qu'il arrive dans sa vie amoureuse quelques pages plus loin. Que chaque sujet ou thème se jouent dans l'inconscient de son histoire avec Saul, un américain, et prend un motif pour le distordre et je crois que c'est rare qu'une œuvre montre aussi bien comment l'idée d'un roman se fait, comment c'est une distorsion du réel, comme dans les miroirs grossissant
Conclusion
Ce livre me domine, c’est une remarque que je me fais en ce moment, c’est-à-dire que je sens qu’il m’échappe encore, et qu’il faudrait peut-être deux ou trois autres lectures pour en venir à bout. On se sent petit, et en même temps, on sent qu’il ne sera pas épuisé dès cette première lecture, qu’il recèle encore tellement, ce qui donne juste envie d’y replonger. Pour moi, c’est le signe des très grands livres. Je suis toujours partagée dans ce genre de moment entre l’envie d’en parler, d’être prosélyte et celle de le garder pour moi, précieusement. Je me sens vraiment reconnaissante d’être tombée dessus, il est rare qu'un livre provoque un tel écho en moi, et même un écho d'artiste, Le carnet d'or, c'est ce vers quoi j'aspire en tant que lectrice mais aussi en tant qu'autrice. Un livre bizarrement foutu, j'ai dit plusieurs fois pendant ma lecture qu'il était déroutant (en précisant à chaque fois qu'il l'était de la bonne manière). Je crois que tout bon livre doit l’être un minimum. J’ai échoué à en parler aussi bien que j’aurais voulu, tout ce que j’ai dit ne rend même pas un dixième de ce que j’ai ressenti. Lisez-le.