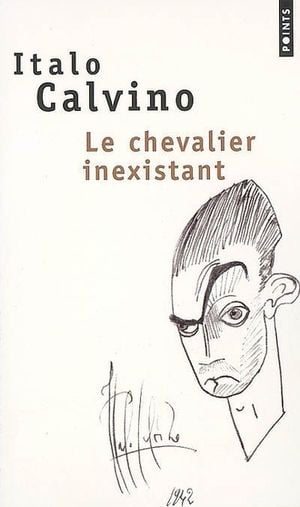Le Chevalier inexistant est un livre bref et efficace sur la condition humaine. Il est articulé autour de quatre personnages. Deux sont des archétypes qui représentent des contre-modèles (l'impossible chevalier inexistant, chef-d'œuvre de perfection mécanique, exemple de mécanisation de l'homme ; son écuyer dont même le nom est changeant, exemple d'accord inconditionnel avec l'être). Entre ces deux vertigineux extrêmes, deux personnages plus jeunes apprennent à exister (“même exister, cela s'apprend”, nous rappelle le roman) : Raimbaud (le jeune chien fou) et Torrismond (le dépressif).
Cet argument apparemment simple est démultiplié avec beaucoup de talent par Calvino, qui complexifie à l'envie sa structure. D'abord en enchâssant le récit dans celui d'une nonne, ce qui laisse envisager toute une série d'interprétations métaphoriques (Agilulfe, le chevalier inexistant, est-il l'allégorie de la perfection poursuivie à tort jusqu'à ce qu'elle se révèle pour ce qu'elle est, une illusion, une coquille vide ? ou tout cela n'est-il pas l'invention d'une nonne qui s'ennuie avant de fuir son monastère ?). Ensuite, en rompant les symétries qu'il avait établi — l'histoire de Torrismond, au départ anecdotique par rapport au duo de Raimbaud et Agilulfe, prend de plus en plus d'importance et traverse des épisodes marquants (notamment celui des chevaliers du Graal, figurés en moines bouddhistes adeptes de massacres occasionnels). Enfin, Calvino se joue avec beaucoup d'intelligence des normes du roman courtois (en pensant sans doute davantage à L'Arioste qu'à L'Astrée) — rebondissements invraisemblables, jeux de narration, sarrasins en carton-pâte, etc.
Cette intelligence n'empêche pas Le Chevalier inexistant de donner à son lecteur un sincère plaisir de lecture. Celui-ci passe bien sûr par la fantaisie du roman, souvent franchement drôle ("— J’ai entrepris un long voyage, pour tâcher d’avoir des nouvelles, avant qu’il soit trop tard, d’une virginité qui remonte à plus de quinze ans. / — Jamais je n’ouïs conter entreprise de chevalerie qui eût un but aussi chimérique, avoua Priscilla."). Il se prolonge aussi dans l'agréable voisinage de l'écriture assez neutre du conte philosophique et de surprenantes envolées, dont celle qui conclut le roman (“Quels âges d’or imprévisibles apprêtes-tu, ô toi mal gouverné, toi, fourrier de trésors payés d’un prix si cher, toi, mon royaume à conquérir, futur…”).