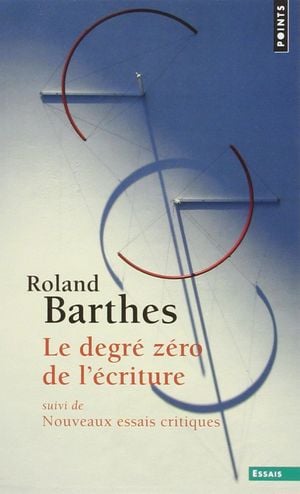Le Degré zéro de l'écriture par reno
Découvrant dans la forme littéraire, en plus de la langue et du style, un autre terme : l'écriture, comme « un ensemble de signes », Barthes s'autorise donc de la sémiologie pour aborder la critique littéraire. Or il semble étrange à quel point, dans le cadre d'une intention structuraliste, de voir combien le développement de sa pensée et de son idée fonctionne moins dans le cadre de la rigueur d'une logique qui lui échappe qu'il ne procède par glissements surprenants. Ainsi l'artificiel qui amène son idée d'écriture jalonne son discours.
Par exemple lorsqu'il déclare au début de son introduction « il n'y a pas de langage écrit sans affiche [...] et c'est vrai également de la littérature. Elle aussi doit signaler quelque chose, différent de son contenu et de sa forme individuelle, et qui est sa propre clôture, ce par quoi précisément elle s'impose comme Littérature. » Autrement dit pas de Littérature sans « écriture ». Or ne contredit-il pas son propos lorsque évoquant une certaine littérature contemporaine, il signale un « degré zéro de l'écriture » : une littérature où l'écriture serait « absente » ? Pour éviter cet écueil, il n'hésite pas alors à s'enfoncer dans le paradoxe et à parler d'écrivain sans Littérature (il évoque alors : Camus, Blanchot, Cayrol, Queneau). Ceci alors qu'un paragraphe avant il rappelle qu' « on sait que vers la fin du XVIIIe siècle, cette transparence [celle de l'art classique] vient à se troubler ; la forme littéraire développe un pouvoir second, indépendant de son économie et de son euphémie », permettez-moi de comprendre que pour lui « l'écriture » apparaît à ce moment-là. Ou mieux, qu'elle n'est pas séparée encore du langage qui n'a pas connu sa crise. N'en sommes-nous pas amenés à déduire que la période classique (disons le XVIIe siècle) connaît donc déjà une littérature sans écriture ? Qui ira dire que des écrivains tels que Molière, Racine, La Fontaine, Boileau, La Fayette, mais aussi Pascal, Descartes, etc. sont des écrivains sans littérature ? Bien qu'on puisse cependant le concevoir dans le sens où le terme n'était pas apparu (« littérature » dans le sens « ensemble des productions littéraires » n'apparaît qu'au milieu du XVIIIe siècle), il n'empêche que la Littérature peut reconnaître a posteriori comme appartenant à son histoire des œuvres qui précèdent son institution en tant que telle.
De même par rapport à Mallarmé, Barthes rappelle : « on sait que tout l'effort de Mallarmé a porté sur une destruction du langage dont la Littérature ne serait en quelque sorte que le cadavre », cela lui suffit à affirmer : « Mallarmé, enfin, a couronné cette construction de la Littérature-Objet par l'acte ultime de toute les objectivations : le meurtre. » Or détruisant l'une des composantes formelles de la Littérature, on pourrait penser qu'il se serait agit de laisser la part plus belle aux autres : le style et l'écriture, dans la logique barthesienne. Eh bien non, c'est l'écriture qui, par un transfert surprenant en est la victime : « partie d'un néant où la pensée semblait s'enlever heureusement sur le décor des mots [période classique], l'écriture a ainsi traversé tous les états d'une solidification progressive : d'abord objet d'un regard [Chateaubriand], puis d'un faire [Flaubert], et enfin d'un meurtre [Mallarmé], elle atteint un dernier avatar : l'absence. »
Et c'est ainsi que mélangeant au bonheur ces termes – dont la séparation, la définition lui importent et soutiennent son discours – ces termes que sont : langue, style et écriture, il glisse sans cesse de l'un à l'autre en faisant agir au besoin les attributs de l'un sur l'autre.
Ainsi opposant par exemple encore l'écriture de Gide dont il dit qu'il est « le type même de l'écrivain sans style » à la poésie moderne « saturée de style et [qui] n'est art que par référence à une intention de poésie », Barthes déclare : « on peut donc imaginer des écrivains préférant la sécurité de l'art à la solitude du style. » La redéfinition des termes à l'envie l'engage dans une voie où tout est à refaire et à redire, pour justifier l'emploi qu'il en fait.
Mais le propos de Barthes, son intention, est encore plus sibylline : « il n'y a pas de Littérature sans Morale du langage. » Il parvient assez bien à montrer que le style et la langue sont les données inconscientes de l'écrivain qui ne peut au niveau de la forme exprimer l'exercice de sa volonté, de son choix que par l'écriture, où le problème moral se pose du coup. Ainsi il affirme : « l'identité formelle de l'écrivain ne s'établit véritablement qu'en dehors de l'installation des normes de la grammaire et des constantes du style, là où le continu écrit, rassemblé et enfermé d'abord dans une nature linguistique parfaitement innocente, va devenir enfin un signe total, le choix d'un comportement humain, l'affirmation d'un certain Bien, engageant ainsi l'écrivain dans l'évidence et la communication d'un bonheur ou d'un malaise, et liant la forme à la fois normale et singulière de sa parole à la vaste Histoire d'autrui. »
Au passage, on aura plaisir à constater que l'individuation se fait ici par le choix, signe de rattachement à la morale existentialiste si le jargon ne suffisait pas à le signaler.
Cependant la moralité de l'écrivain n'est en tant que telle jamais explicitée. Et il est délicat de percevoir ce qu'est en définitive le choix formel auquel peut se soumettre l'écrivain, à déceler ce qu'est en définitive cette écriture, qui n'est ni langage ni style, et qui loin d'être un troisième terme, ne semble que le terme médian qui lie l'auteur à son lecteur, le pacte social qui lie ensemble, style, langage et propos dans la volonté de publication qui demeure désir d'écriture. Suspect semble toujours ce désir de clore, comme bête celui de conclure. Ainsi prétendre que « L'écriture blanche, celle de Camus, celle de Blanchot ou de Cayrol par exemple, ou l'écriture parlé de Queneau, c'est le dernier épisode d'une Passion de l'écriture, qui suit pas à pas le déchirement de la conscience bourgeoise. » ne prête-t-il qu'à sourire tant sous l'opacité d'un contenu foisonnant, se lit le type même d'une naïveté sachant s'accommoder d'une immense prétention.
CELA ETANT, si j'ai pris plaisir à charger ce livre (maladroitement qui plus est) par où il m'a scandalisé compte tenu de la place qu'il occupe dans la critique littéraire, je lui reconnais de grandes qualités moins dans la logique pure de son raisonnement que dans la tension (l'attention) qu'il réclame de nos facultés de lecteur. De surcroit l'effort constant (nécessaire à l'époque, existentialisme oblige) mené pour faire correspondre histoire des enjeux littéraire avec l'Histoire est éclairant et, malgré l'artifice de la manière et des concepts, il réussit par là, c'est-à-dire, dans son échec, par son échec, à tracer le drame d'une histoire qu'il ne commet l'erreur que de fermer. Aussi est-ce moins dans le regard sur une écriture qui lui est contemporaine que sur les mécanismes et les structures à l'œuvre dans l'écriture et à travers son histoire que l'essai trouve sa pertinence.