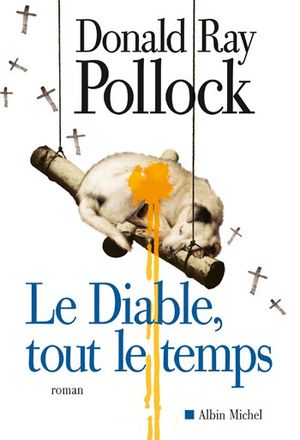Comme un air de déjà-vu, rien de brusque ni de déroutant. Un bigot traîne son marmot tous les samedis au tronc à prière vénérer le bon Dieu loin des dégénérés du coin. Puis dérouille un chasseur malappris devant le troquet histoire de rappeler à ces clampins qu’on peut rire de tout mais pas avec n’importe qui et sûrement pas de la toute jeune femme d’un survivant du pacifique à l’esprit fissuré par la bête humaine guerroyante. Voilà qu’on s’y attache bien inconsciemment au-dit Willard. Il ne faudrait pas. C’est douloureux. Inéluctable. Il y a trop de passif, trop de souffrance et d’abandon pour un seul homme qui déjà, avant la dégringolade, survit en feignant vivre, marionnette indécise n’attendant que l’étincelle qui consumera les restes de sa conscience.
Un air d’Amérique perdue, sur les terres de McCarthy et Egolf. Acharnement maniaque.
Willard, pourtant, n’est que le domino qui basculera dans l’indifférence générale, qu’on oubliera bêtement, tout occupé à contempler, hébété, la spectaculaire dégringolade qui s’en suivra. Dieu sait qu’on l’a aimé, plaint surtout, Willard, qu’on a cru en lui, en ses prières, son culte, son espoir. Si vite oublié. Comme du reste chacun préfère oublier dans le patelin. Continuer à vivre. Cultiver la bêtise. Institutionnaliser l’ignorance.
Peu à peu le style s’affirme. Par le jeu complexe des dates et des narrateurs, Donald Ray Pollock construit sa vision contemporaine du verbe américain. Sans jamais sacrifier le rythme, une fluidité surprenante, irréelle. Alors que le même chapitre voit trois protagonistes se partager la diction, alors que la temporalité reste incertaine, rien ne dépasse, le rouleau suit son cours sans que l’attention ne s’étiole d’un iota.
Effaçant Willard et son souvenir, renouveau de l’Histoire vouée à la réitération du péché originel.
La route. Là-voilà. Inévitablement. Toute cette comédie prend racine dans un bus intercontinental charriant sa dose de rêve en forme de fuite et de grands espaces.
D’apparence rien de nouveau sous le ciel grisâtre de l’Ohio. Enième récurrence du vagabondage américain déclinée sous des formes aussi diverses qu’improbables, du prêcheur hors-la-loi aux kidnappeurs d’auto-stoppeurs, facettes nuancées d’une même vadrouille vitale.
Mais à bien y regarder, voilà que les choses ne sont pas si simples. Cette route n’est pas celle de Kerouac et de Ginsberg, le songe évanescent de la Beat Generation. Cette route a vu passer des générations désabusées, n’a pas tenu ses promesses d’évasion. Elle ne porte nulle trace du romantisme, de la poésie crasse des clochards célestes qui lui donnaient vie.
Cette route, évidence enfin pointée, n’est qu’une vaste boucle.
Un océan de vacuité.
C’est là que s’affirme le trait de Pollock, architecte appliqué de ces boucles entremêlées. Au risque de perdre le lecteur, conscient de l’inévitable conclusion, de l’insupportable retour au foyer originel. A quoi bon arpenter cet asphalte pénible si la destination n’a d’attrait qu’à l’ignorant.
Un brin d’espoir, une dose homéopathique. A la croisée des chemins, peut-être, dans la violence de la collision, l’éventualité d’une déviation de l’orbite. Si infime soit-il, il suffit à l’homme, il le maintient en mouvement, il en faut si peu. Et advienne que pourra.