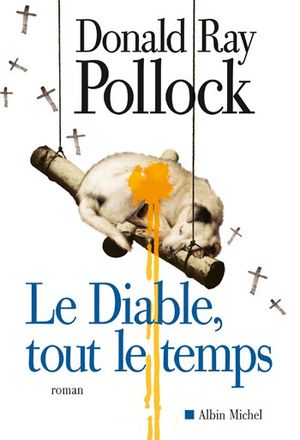Autant vous prévenir tout de suite : ce roman est de ceux qu’on se prend comme un coup de poing en pleine figure et qui vous laisse complètement chamboulé. Ce diable-là, il vous fout la trouille ou la nausée, il vous dérange, vous bouscule, vous secoue. Il peut même par moment vous faire sourire, si vous aimez l’humour noir, très noir. Alors oui, vous ressortirez de l’aventure totalement groggy. Mais en même temps, vraiment époustouflé.
Comment qualifier cet OVNI littéraire qu’est le premier roman de Donald Ray Pollock ? Un road-trip rural, sanglant et pitoyable, dont les héros sont tous plus allumés les uns que les autres ? Un thriller sociologique qui nous plonge dans les profondeurs désespérantes de l’Amérique white trash où vivotent les laissés pour compte du miracle économique ? De Meade ou Knockemstiff (Ohio) à Coal Creek (Virginie-Occidentale), de la fin des années 40 au milieu des sixties, s’entrecroisent les destins d’alcoolos et de camés, de serial killers, de pervers, d’accros au sexe ou d’hallucinés de la prière. L’ampleur de la misère humaine, ça laisse parfois incrédule : on commence par se dire qu’il est improbable de trouver autant de détraqué(e)s sur un si petit territoire. Mais après tout, si c'était possible? Si la misère, le manque de perspectives, la consanguinité, les traumatismes de l’enfance, les blessures de la vie, la religiosité bornée pouvaient se fondre dans ce creuset d’où émergent la délinquance, la haine ou la folie ?
Il y a d’abord Willard Russell, natif de Coal Creeck. Le diable, il l’a croisé dans l’enfer de la guerre du Pacifique : il y a vécu des choses tellement atroces qu’il n’arrive pas à s’en sortir les images de la tête. A son retour aux States, il tombe raide dingue de Charlotte, un joli brin de fille, serveuse dans un bar près de Meade. Sous ses dehors plutôt tranquilles quand il est à jeun, faut pas le chercher, Willard : il cogne dur et le pauvre crétin qui a manqué de respect à sa femme l’apprendra à ses dépens. Et quand il ne cogne pas, il boit sec ou alors il prie : l’alcool, c’est un dérivatif pour noyer ses angoisses mais la religion, c’est vraiment sa came, il est shooté aux cantiques. Alors, quand Charlotte se chope un cancer, sa raison déjà bien amochée largue les amarres. De marathons de prières auxquels il astreint son malheureux gamin en sacrifices d’animaux crucifiés au cœur de la forêt, il espère un miracle qui ne vient pas, tout en répandant des déluges de sang.
Mais Willard n’est pas le seul accro à la religion : pour Theodore Daniels et Roy Laferty , prédicateurs itinérants, Dieu est pour ainsi dire un fonds de commerce. Le premier, homosexuel , en chaise roulante depuis qu’il a eu la mauvaise idée d’ingurgiter du poison pour prouver sa foi, accompagne de quelques mauvais accords de guitare les prêches du second, sortes de spectacles déjantés au cours desquels il arrive à Roy d’avaler des insectes quand il ne lâche pas des araignées sur son auditoire. Notre prêcheur est persuadé qu’il a le pouvoir de ressusciter les morts. Le jour où Théo, par pure jalousie, persuadera son pote de buter sa femme pour la ramener ensuite à la vie marquera, comme on s’en doute, le début de leurs ennuis et de leur déchéance.
Des ennuis, c’est sûrement ce qui pend au nez de Carl et de Sandy Henderson. La marotte de Carl, c’est la photo, mais attention, uniquement les photos artistiques! Alors l’été, il part en virée sur les routes du Middle-West en compagnie de Sandy qui sert d’appât, de son appareil photo, et puis de son flingue, à la recherche de "modèles", jeunes autostoppeurs plutôt naïfs qui finiront bien malgré eux sur des photos très particulières.
Et puis, il y a tous les autres : un pasteur pédophile, une gamine en cloque et désespérée, un flic ripoux et assassin, un avocat cocu dont la femme, horreur, se fait sauter par un nègre, et qui rêve de vengeance. Et enfin ce gamin, Arvin Eugene Russell, fils de Willard, qui a décidé que dans ce pays où la foi délirante n’apporte aucune réponse et où la loi est la plupart du temps bafouée, il valait mieux ne compter que sur soi-même pour faire justice. Pour un peu, on en goberait le mythe du good guy with a gun, mais heureusement, au terme d’un suspense insoutenable, la fin nous laisse entrevoir que la solution n’est pas à chercher de ce côté.
Bref, dans ce coin paumé où le diable semble avoir élu domicile, on boit, on se shoote, on baise, on cogne, on prie, on tue. Et croyez-moi, l’auteur sait de quoi il parle : comme Arvin, Donald Ray Pollock a grandi à Knockemstiff, petit bled dans l’Ohio, avant de bosser pendant 32 ans comme ouvrier d’usine. Quand il ne travaille pas (et même lorsqu’il travaille, d’ailleurs), il boit sec ou se défonce. Knockemstiff, ça veut dire littéralement "étends-les raides", en clair "file-leur une dérouillée", alors on comprend que pour régler les conflits, les poings y ont généralement plus de poids que les mots. Mais le voilà pourtant à 50 ans qui s’inscrit à des cours d’écriture créative, et qui par la suite, pour son premier roman, nous pond carrément un chef-d’œuvre.
Je ne sais pas trop en quoi consistent les cours de création littéraire dans les universités américaines - ni même d’ailleurs si on peut réellement apprendre à devenir un écrivain, mais force est de constater la grande qualité d’écriture du récit : qu’il s’agisse de peindre la misère, la frustration ou la folie, les descriptions implacables sont criantes de vérité, les images d’une justesse et d’une force peu communes, sans pathos inutile et sans clichés. Et puis, il y a ce regard plein d’humanité que l’auteur pose sur ses personnages, ces désaxés venus au monde du mauvais côté de la chance, dans des bleds paumés où le mal se nourrit de la peur, de l’ennui, de la misère, du désespoir. Pas facile dans ces conditions d’échapper à sa première cuite à 13 ans, ou à une grossesse à 15. Il est tentant de se trouver des dérivatifs, que ce soit l’herbe, l’alcool, le fanatisme ou pis encore et de se jeter dans une fuite en avant qui ne peut que mener droit dans le mur. Mais qu’ils soient pervers, déments, toxicos, obsédés, jamais l’écrivain ne caricature ses personnages, jamais il ne les prive de leur humanité : nous les suivons dans leur vie de tous les jours et découvrons même qu’ils peuvent parfois éprouver des sentiments semblables aux nôtres. Pas des monstres donc, mais plutôt des naufragés de l’existence qui font ce qu’ils peuvent en s’arrangeant, plutôt mal que bien, avec ce qu’ils sont. Difficile pour moi de rendre compte de toute la palette d’émotions qui, de l’effroi à la compassion, m’ont submergée à la lecture de ce roman, mais ce qui est sûr, c’est qu’il m'a bouleversée et qu'il me marquera durablement.