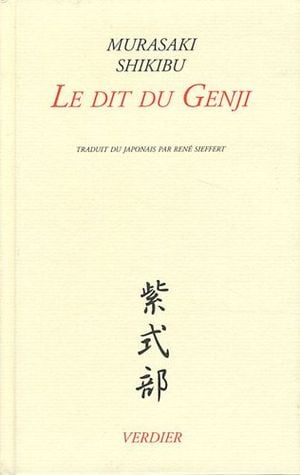Certains livres comme le Dit du Genji ne sont pas tant des livres que des expériences. Dans tous les sens du terme d’ailleurs : une connaissance acquise autant qu’une tentative quasi scientifique. Je m’explique.
On entre dans ce temple si vénéré, si sacré pour tout nipponisant avec le souffle court, comme retenu. Après d’ailleurs un long moment d’angoisse, de procrastination, de tergiversation, mêlé d’envie et d’impatience, cette fameuse montée de l’escalier qui précède une première rencontre amoureuse. Une fois caressé le volume - et quel volumineux volume ! - des yeux et de la main, pendant de longs mois, j’ai donc fini par plonger dedans. Et les premiers chapitres ont eu cette saveur un peu âpre du géranium : diable, un roman qui date du Xe siècle, mais c’est comme de regarder une étoile au ciel en sachant qu’elle est morte il y a tant et tant de siècle déjà !
Prêt à affronter une course d’endurance, on s’échauffe, on se délie le cerveau, on se dit que ça va, et on tente d’accueillir sans grimace cette marée pourtant tranquille, mais si salée. Oui, c’est ça, salée : saturée de détails qui n’apportent rien et que partant je ne saisissais pas, de notations qui ne dénotent rien, d’appellations aussi exotiques que mouvantes… Les heures et les heures de lecture passaient, et moi j’étais noyé. La tête de plus en plus sous l’eau, j’avais beau essayer de me rassurer, le constat finit par tomber : je ne comprenais rien. Mais vraiment, et terriblement, et définitivement rien. Qui est qui, qui fait quoi, pourquoi. Comme si toutes les catégories romanesques que je connaissais semblaient ici remises en question : le héros n’en est pas un, il ne fait rien d’autre que de passer de femmes en femmes, sans jamais pouvoir fixer son choix, sans non plus rompre d’ailleurs, et son palais se remplit de ses conquêtes, presque impossible à distinguer les unes des autres (puisqu’il est malséant dans le Japon du Moyen Age d’appeler un noble par son nom). Un peu de musique, contemplation d’un pin, d’une lune pleine, d’une chambre vide, la pluie tombe, une femme meurt, une autre s’installe. Et les pages aux pages s’ajoutent.
Arrive le moment du dilemme : continuer (mais continuer quoi ?) ou s’arrêter (là ? comme ça, en plein échec ?). Pris dans le courant si lent de ce fleuve gelé, j’ai continué. Frappé, au delà de mon exaspération, par l’étrange lacher-prise que cela impliquait. Car le fond du problème rabâché par dame Shikibu n’est autre que l’impermanence de ce monde, thème si cher aux Japonais d’hier et d’aujourd’hui : quoi qu’on fasse pour s’en prémunir, tout finit par changer. Or l’un des remèdes souvent proposé là-bas pour lutter contre notre dénuement face à un tel scandale est de se détacher peu à peu de notre égo. Or il y a t il UN livre moins « égotiste » qu’un livre où l’on ne parvient pas à distinguer les personnages, où l’on ne sait jamais qui fait quoi ? Et accepter cela, n’est-ce pas justement perdre un peu de SON égo de lecteur ? cette figure si puissante chez nous, sans qui aucun livre n’est censé pouvoir s’écrire et du même coup se lire ?
Au deux tiers du livre (en ce qui concerne mon édition, 1000 grandes pages écrites bien petit) la facétieuse Murasaki offre tout de même au patient (dans tous les sens du terme, bis repetita) qui la lit, une petite récompense, pour lui montrer qu’elle ne l’oublie pas totalement, malgré sa disparition progressive. Ou bien est-ce une ruse pour lui donner un peu de courage ? Bref, adieu Genji (il ne meurt pas à proprement parler, non, disons qu’au détour d’une page, il est mort, voilà) et puisque de toute façon ce ne sont pas les personnages qui font cette histoire (elle se déroule toute seule, comme un manège qui tourne, qu’il y ait des gens dessus ou non, qu’il y ait des gens qui la lisent ou non), l’histoire continue. Tant et tant de femmes sont mortes d’ailleurs, qu’il ne reste plus grand monde dans cette grande plaine d’ennui et d’amour : et enfin, alors qu’on ne s’y attendait plus, le brouillard devient moins dense, et l’on saisit mieux, plus longtemps, qui sont les protagonistes. Non pas que l’intrigue devienne plus consistante, mais l’analyse psychologique du rien s’impose doucement, et le texte agit comme un dompteur, insidieusement : c’est un livre qui apprivoise celui qui s’y aventure. Il lui montre en permanence qu’il n’a pas besoin de lui, et que d’ailleurs ce lui n’a aucune consistance. Jusqu’à le mettre à terre, plié sur ses genoux. Et là, il s’arrête, où bon lui semble. Quelle importance, puisque le monde n’est rien ? Rien qu’un flocon de neige, fondu à peine posé sur la branche de nos rêves.