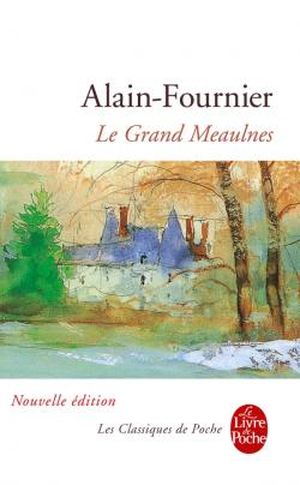Quelques mots sur un cahier de problèmes jauni, retrouvé dans une vieille malle d'écolier, pour ranimer la beauté d'un souvenir, celui d'une époque perdue. Se remémorer un bonheur peut-être jamais ressenti mais toujours perçu, qui fait tenir notre faible vie en équilibre au dessus d'une mer de désespoirs. La difficulté de se ressouvenir, de tenir sa mémoire au creux de sa main, de pouvoir en combler les lacunes, d'arrêter son inlassable dissolution, sous la pluie des jours qui passent.
Le Grand Meaulnes est un roman de l'entre-deux mondes, la seule œuvre et le cercueil de son auteur à l'existence tout autant passagère, Alain-Fournier, ce jeune instituteur sacrifié sur l'autel des tranchées.
Meaulnes, un grand garçon mystérieux arrive, par un froid matin de novembre, dans la vie de François Seurel, le fils de l'instituteur. Un jour que Meaulnes s'égare lors d'un voyage infortuné, il découvre un domaine sans nom, un monde qu'anime une étrange fête, où les enfants sont rois et les adultes joueurs, où les beaux habits vibrent aux reflets fantastiques de lanternes colorées. Un monde frémissant, plongeant ses habitants dans l'essence du bonheur ; une utopie bientôt perdue, quand sous le coup d'un drame que nul ne perçoit mais que tous ressentent, la fête se dissipe.
À l'improbable croisée du romantisme noir de la Sylvie de Nerval et des romans d'aventure de Stevenson, Le Grand Meaulnes est un fragment de romantisme aux frontières du merveilleux. Sa prose poétique fait même parfois bruisser la longue robe du symbolisme. Il est un roman de l'irressaisissable – pardon pour ce néologisme –, du bonheur qui a éclot puis fané, et de la recherche d'un nouveau printemps pour ce bonheur. Ce qui y importe, c'est la beauté du souvenir qui, alors qu'il s'estompe, apparaît en différentes strates mêlées, confondant le rêve et la réalité. Un souvenir à chérir d'autant plus que, quand le bonheur semble sur le point de rejaillir, c'est d'appréhension que l'on est engourdi : retrouvera-t-on jamais notre joie passée sous sa forme qui, peut-être, n'existe qu'en nos rêves ?
On retrouve cette esthétique du passage dans la nature même du Grand Meaulnes : paru à la veille de la Grande Guerre, il est le dernier roman du XIXè siècle, qu'il salue avec mélancolie.
Frantz et Meaulnes sont animés de cette indicible nostalgie romantique. Ils sont tous deux personnages du grand drame de la déliquescence des bonheurs de l'enfance, symbolisé par la figure du Pierrot, ce grand mime, tantôt effrayant, tantôt amusant, qui court dans les couloirs du domaine sans nom, hurlant à la mort et s'empêtrant dans ses manches trop longue, ou, dans le cirque des bohémiens, se jetant du haut d'une pyramide de chaises. Ceux qui le contemplent dans son spectacle s'amusent du burlesque de sa dégringolade, mais perçoivent le tragique de sa chute. Il est une sorte de fossoyeur tout droit venu de Hamlet, pitre bavard et homme qui tombe. Ainsi les extravagances romantiques de Frantz (la fête au domaine sans nom, le pacte solennel passé avec François et Meaulnes...) sont-elles comme des remèdes au spleen issu de ce monde qui passe, un antidote à l'inlassable progrès qui ne laisse que des pantins vides sur son passage.
Pour celui qui ne veut pas être heureux, il n'a qu'à monter dans son grenier et il entendra, jusqu'au soir, siffler et gémir les naufrages ; il n'a qu'à s'en aller dehors, sur la route, et le vent lui rabattra son foulard sur la bouche comme un chaud baiser soudain qui le fera pleurer.
L'aventure du Grand Meaulnes reste circonscrite dans l'horizon de la carte que saurait tracer un enfant. À l'instar d'une bonne partie de la littérature de ces premières années du XXè siècle, l'histoire avance au rythme des pas du promeneur. Je pense bien sûr aux balades Du Côté de chez Swann. Par les yeux des jeunes personnages, le paysage est appréhendé avec une grande sensibilité. Tel bosquet de tilleuls deviendra un point d'ancrage, telle ferme, aux confins des communaux, paraîtra comme l'ultime cap que le voyageur le plus hardi ne saurait dépasser s'il ne voulait pas être surpris par la nuit. On retrouve là l'Île au Trésor de Stevenson : le paysage est à part entière acteur de l'aventure.
D'errance en aventure, Meaulnes apparaît auprès d'Yvonne comme un chevalier courtois. Sa recherche de l'Eden disparu se mue en une folle quête de l'amour idéal, du "fin'amor" médiéval. La bien-aimée, Yvonne, est une icone, aperçue lors de la fête du domaine sans nom comme dans un vitrail, dont le chevalier cherche l'incarnation, au risque d'en froisser les reflets originels. Meaulnes, dès la merveilleuse fête, est pris dans ce jeu de charmes, dans cette recherche effrénée et impossible de l'absolu, piège que lui tend malgré lui Frantz.
Cette densité de propos n'alourdit pas le roman – dont chacun saura d'ailleurs extraire un sens neuf. On pourrait même penser que la narration est enfantine tant elle sait se dépouiller de toute arabesque stylistique superflue. Son intrigue est assez bien dosée pour que paraisse une réelle illusion d'un quotidien qui vient à être troublé par l'aventure, même si le récit se fait plus hésitant au moment de rassembler ses divers éléments et de leur donner un dénouement. En aucun cas le texte ne reste muet : ses riches images mettent aisément l'émotion en branle, toutes imprégnées des dernières lueurs du romantisme, comme des étoiles dont on percevrait encore l'éclat après leur mort.