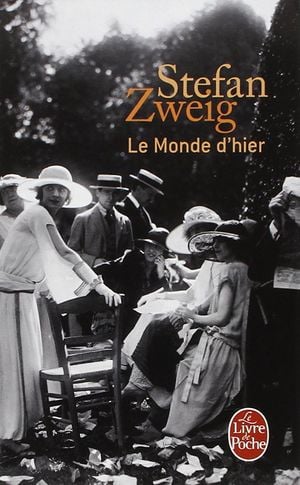Le Monde d’hier n’est pas un roman. C’est un testament : celui de l’auteur qui se suicida avec son épouse le 22 février 1942, après avoir envoyé à son éditeur – la veille – son manuscrit. Car lorsque Stefan Zweig travaille à son œuvre ultime – son Grand-Œuvre, son Chef-d’Œuvre (les majuscules son intentionnelles) – sa décision de quitter ce monde d’en bas est déjà prise. Le Monde d’hier apparaît donc comme son dernier témoignage. C’est la lettre qu’il laisse posée sur son bureau pour expliquer son geste de désespoir. Une lettre de 500 pages dans laquelle l’auteur analyse avec une profonde acuité la société européenne depuis les années 1890 – son enfance – à ce dramatique 3 septembre 1939, date à laquelle l’Angleterre et la France déclarèrent la guerre à l’Allemagne.
Né à une époque révolue, le jeune Stefan Zweig a grandi dans l’immense empire Austro-hongrois sur lequel régnait François-Joseph de Habsbourg et sa célébrissime épouse l’impératrice Elisabeth de Wittelsbach, connue sous le surnom de Sissi. Ses souvenirs d’enfants nous plongent à la cour de Vienne, au cœur de la saga romantique portée à l’écran par une Romy Schneider belle à croquer. Un empire presque millénaire, aux bases qu’on croyait inébranlables, éternelles. Un empire vieillissant mais ô combien noble, digne, dans lequel les vénérables cheveux blancs incarnaient l’autorité, la puissance autant que la justesse. Les jeunes premiers se vieillissaient artificiellement pour s’octroyer une modeste place dans une société où les quadragénaires étaient encore considérés comme devant faire leurs preuves. Et partout dominaient les arts, la joie de vivre, l’insouciance d’un peuple sûr du lendemain, le respect des institutions et celui des aînés. Mais avec le nouveau siècle qui s’approchait, les mœurs commençaient à évoluer. On prédisait que le XXe siècle serait celui de la modernité, du progrès autant technologique que social, de l’entente cordiale entre les peuples.
La société évolua donc, sous les yeux observateurs de l’auteur. Zweig a 19 ans à la naissance du siècle. Il s’inscrit à l’Université pour contenter son père mais ne met pas les pieds en cours avant sa quatrième et dernière année d’étude. Durant trois ans, le jeune Zweig profite de la vie. Il voyage beaucoup en Europe, rencontre les hommes qu’il admire (Emile Verhaeren en tête), échange avec eux et devient leur ami. Zweig a également commencé à écrire. Il ne travaille pas encore à ses propres œuvres, mais pour apprendre de ses aînés (lui qui a toujours fait peu de cas de ses talents, niant son propre génie), entame de traduire en langue allemande la production des autres. Il se fait peu à peu un nom.
Puis viennent les récits bouleversants de la Première Guerre mondiale, de son incompréhension pour la haine des belligérants. Il ne cesse de déplorer la propagande et l’apologie de la guerre auxquelles se livrent presque tous ces anciens amis écrivains qui discutaient ensemble encore quelques mois auparavant sans distinction de nationalité, mais qui maintenant s’expédiaient des obus par-delà la ligne de front de leurs plumes acérées. Pacifiste convaincu, Zweig fut, avec son grand ami Romain Rolland, l’un des rares à publier des articles de paix. Il fut abondamment critiquer pour cela. Travaillant aux archives, il resta longtemps hors des combats. Pourtant, il vit le front, ses horreurs, la misère et la profonde détresse des combattants – imaginant qu’elles devaient être semblables dans le camp adverse.
Puis vint l’infâme Traité de Versailles qui mit les vaincus plus bas que terre, semant les premières graines du ressentiment et de la haine qui conduisirent au second conflit. Le démantèlement de l’Empire d’Autriche-Hongrie qui fut particulièrement douloureux pour lui avec la création d’une minuscule Autriche exsangue et sans défense, écrasée entre l’Italie de Mussolini et l’Allemagne d’Hitler. Stefan Zweig revient aussi sur l’incroyable période d’inflation qui décima l’Autriche d’abord, l’Allemagne ensuite, et durant laquelle la baguette de pain valait plusieurs milliards de marks. Au cours de cette période nous dit-il, la monnaie pouvait être dévaluée tant de fois qu’avec ce que coutait un simple repas, on pouvait peu de temps auparavant, s’offrir l’assiette, la table sur laquelle était posée l’assiette, la maison dans laquelle la table se trouvait, voire toute la rue de la maison en question. Les prêts immobiliers ne signifiaient plus rien, l’argent lui-même n’avait plus de sens. Le troc réapparaissait. L’Allemagne, stricte et amoureuse de l’ordre, sombrait dans un chaos sans fin. C’est ce chaos, d’après Stefan Zweig, qui explique en grande partie la montée du nazisme. Le peuple allemand aurait suivi n’importe quel homme fort promettant le retour à l’ordre, fusse au prix de l’aliénation de ses libertés fondamentales.
Zweig poursuit avec Hitler et sa folie, sa mégalomanie. Sans oublier les bailleurs de fond qui, alors qu’Adolf était encore sans le sou et sans pouvoir, ont armé les nazis, leur ont procuré des uniformes flambant neufs et tout ce dont ils pouvaient avoir besoin dans leur conquête du pays. En tant que juif, il s’inquiétait énormément de la radicalisation de l’Allemagne. Il craignait que ce fascisme ne finisse par franchir la frontière et à s’inviter en Autriche. Avec une prémonition époustouflante, cet homme perspicace a vécu deux fois les drames de l’entre-deux guerres : une fois dans ses pires cauchemars avant qu’ils ne se produisent et une seconde fois dans l’atroce réalité des événements de l’époque.
Dès 1933 et l’arrivée d’Hitler au poste de chancelier, Zweig quitta sa patrie pour l’Angleterre. S’il vécut à l’abri des lois antijuives prises successivement chez lui, il souffrait atrocement de voir sa chère Autriche et les siens restés au pays aux mains des nazis. Car avec le développement des moyens techniques, il n’était plus possible à un homme de se retirer du monde. A chaque instant, une voix à la radio, les manchettes des journaux lui rappelaient ce qu’il cherchait à fuir par tous les moyens.
C’est un homme brisé qui écrit ses lignes bouleversantes. Un homme qui a pris en conscience la terrible décision de se tuer. Parce qu’il avait perdu foi en l’humanité. Parce que ses rêves d’union et d’entente entre les peuples s’étaient évanouis. Parce que le juif traqué qu’il était devenait terriblement las de fuir toujours plus loin. Pour trouver enfin la paix.
Le monde d’hier est un livre terrible et magnifique à la fois. On découvre un Stefan Zweig profondément humain, attentif aux autres, souffrant avec eux, se battant pour eux avec toute l’énergie de sa célébrité, usant chaque fois que possible de son influence, de sa richesse pour soulager son prochain de ses maux. En 500 pages, Zweig parle assez peu de lui pour se concentrer sur son époque et ses contemporains qu’il aime plus que lui-même. Sans cesse à l’écoute, il choisit toujours de rester dans l’ombre, s’assoit au dernier rang quand il entre dans une salle de spectacle, sort peu. Tout au long de son récit, il rend hommage au talent, au génie des grands hommes qu’il rencontre tout en refusant de considérer ses propres atouts. Le lecteur croise ainsi la route d’Emile Verhaeren, de Romain Rolland, de Thomas Mann, de James Joyce, de Rainer Maria Rilke, de Freud, de Dali et de bien d’autres encore.
Le monde d’hier est un livre éblouissant qui devrait être étudié dans toutes les écoles. Peut-être l’est-il dans certaines. C’est plus qu’un livre d’histoire : c’est un document inestimable d’une époque en pleine mutation, d’une société stable, austère mais dans laquelle l’humain dominait, à un monde de suspicion dans lequel l’autre représente un danger potentiel, une menace qu’il convient de circonscrire, ou tout au moins de surveiller. Un monde que Stefan Zweig refusa. Un monde qu’il a décidé de quitter.
On ne sort pas indemne d’un tel livre !