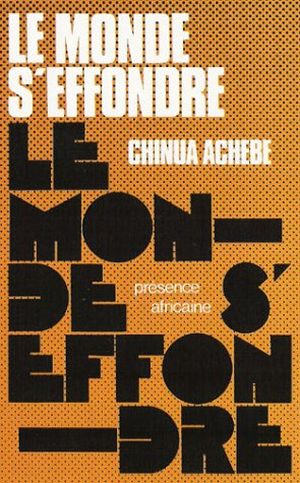Things Fall Apart raconte l'histoire d’un homme, Okonkwo. Il vit en pays igbo, dans le sud-est du Nigéria, dans les préludes de l’époque coloniale (au XIXe siècle — rappel toujours utile de la tardiveté et de la brièveté de la colonisation européenne dans la majorité de l’Afrique, qui n’a guère été plus qu’une parenthèse de cent ans).
Ce petit roman (150 pages) offre un discours très subtil — au point, d’ailleurs, qu’on aurait presque des remords à le caractériser comme un roman sur la colonisation. Seul le dernier tiers met en contact les Igbos d’Umuofia avec les Européens, mais le lecteur est immédiatement tenté de relire tout ce qui a précédé par le prisme de cette rencontre finale. Si cette relecture n’est sans doute pas strictement fausse du point de vue de la composition, elle est aussi une manière de piège : le lecteur, en résumant le roman à sa brève conclusion, est induit à commettre la même erreur que le colon ou l’historien qui résumerait les sociétés africaines à leur contact avec les Blancs. Bref, il est déjà difficile de résumer l’objet du roman sans aborder tout ce qui fait son intelligence ; preuve que la grande simplicité formelle choisie par Achebe ne l’empêche pas de faire preuve d’une grande rouerie dans l’exercice de son métier d’écrivain.
Things…, c’est un des discours les plus explicites qu’il porte, nous faire déjà réfléchir au dialogue du passé précolonial et de l’époque coloniale. La conclusion de l’ouvrage, qui évoque le futur ouvrage auto-satisfait et probablement simplificateur que rédigera le District Commissioner sur son expérience en pays igbo aborde assez frontalement cette question. Elle nous renvoie au portrait riche et détaillé que fait Achebe de la société igbo d’avant le contact. Par son prosaïsme littéraire, Achebe réussit à incorporer les traits de cette société, y compris les plus spectaculaires pour un lecteur européen (les esprits masqués, les enfants mort-nés que l’on croit destinés à revenir…), sans tomber dans l’ethnographie, le folklore ou l’ornementation — tout semble parfaitement naturel, comme il serait naturel que le personne d’un roman occidental aille communier.
En même temps qu’il donne toute son épaisseur à la période précoloniale, Achebe lui rend aussi ses nuances et ses ambiguïtés, et notamment celles du protagoniste, Okonkwo. Obsédé par la force et la masculinité (en réaction, notamment, à l’humiliation que constituait la faiblesse de son père), c’est un homme de valeur mais aussi un patriarche colérique, souvent méprisant à l’égard des coutumes et des règles de la société traditionnelle. Après qu’un oracle a condamné à mort son fils adoptif venu d’un autre village, qu’il aime plus que les siens, il choisit d’accompagner les hommes pour son exécution, alors qu’un sage le lui avait interdit (dans une belle symétrie, d’ailleurs, du sacrifice d’Isaac : Okonkwo faute en sacrifiant, là où Abraham s’accomplissait ; mais, et finalement comme dans l’Ancien Testament, la mort de l’enfant aux mains de son père est la preuve d’un échec, d’une faillite). Plus tard, alors qu’il rencontre les chrétiens et l’administration coloniale qui s’installe, il leur oppose un refus radical, ce qui l’amènera à la chute et à la mort. Au fond, on se demande si Okonkwo ne portait pas en lui-même la nécessité de la chute (dans son chi, son dieu personnel), qui n’a pris la forme d’une confrontation avec les colons que par un accident historique.
Ainsi, bien qu’Achebe condamne nettement l’effacement du passé précolonial et le ressuscite avec talent, il montre aussi la double impossibilité du retour (message actuel à l’époque de l’écriture du roman, mais qui l’est toujours aujourd’hui). Impossibilité, d’abord, de ressusciter un mode de vie dont les fondements axiologiques ont été bouleversés et condamnés : comme le remarquent à plusieurs occasions les personnages, notamment Obierika (un ami d’Okonkwo qui incarne une voie médiane — (1)), la société traditionnelle mène à des injustices (qu’est-ce qui peut justifier la mise à mort systématique des jumeaux ? l’exil septennal d’Okonkwo pour un accident ?) que la force corrosive du christianisme fait apparaître dans leur nudité. On pense à René Girard citant Stendhal : les coutumes sont ces « grands seigneurs aimables » devenus de « vieux ultra méchants » sous l’effet du dévoilement d’une institution arbitraire. Impossibilité plus fondamentale d’un retour net quand la rupture est relative : la christianisation rapide des Igbos prend sa racine dans le monde d’avant.
On comprend au vu de ces quelques suggestions la fortune critique qu’a connu Things Fall Apart, en particulier dans le monde anglo-saxon. Si le roman se prête particulièrement bien à une approche « post-coloniale », il a aussi donné lieu à une multitude de lectures par le prisme du genre. C'est une des adresses étranges de la littérature qu'un ouvrage, rédigé à la fin des années 1950 par un écrivain nigérian, finisse par saisir le Zeitgeist de la Californie des années 2010…
(1) Appel à d’éventuels lecteurs de cette critique : existe-t-il, en théorie littéraire, un terme général pour désigner ces personnages “témoins” dans une œuvre, qui paraissent incarner l’auteur ou le lecteur, sans, pour autant, en être directement la voix à la première personne ?