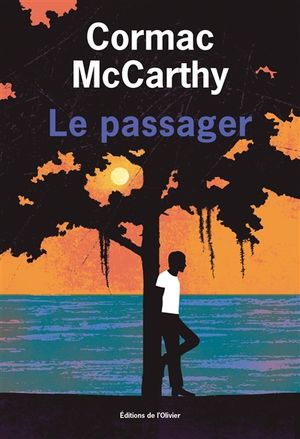(Critique provisoire, en attente de plus de temps pour faire mieux)
J'ai été si déconcerté par ce roman que j'ai oublié dans un premier temps de l'ajouter à ma liste de lectures de l'année, presque comme si je ne l'avais pas lu...
Cela paraît anecdotique, mais pas tant que cela. Ce livre, la presse s'en fait largement l'écho pour en chanter les louanges, d'une manière aussi suspecte que prévisible. Prévisible, parce que c'est le premier de McCarthy depuis quinze ans, que l'auteur a 89 ans et qu'il s'agit sûrement de son dernier opus (enfin, avant-dernier, puisqu'il en a écrit deux coup sur coup, le deuxième - à paraître en mai - répondant à celui-ci) ; et puis, parce que son précédent n'était autre que La Route, phénomène d'édition et immense succès public qui a un peu faussé la donne au sujet de ce romancier.
Cormac McCarthy est tout sauf un écrivain grand public et facile. Relativement épuré, allégé de certains de ses tics d'écriture, La Route allait à l'essentiel et pouvait toucher par sa simplicité, qui permettait à son atmosphère de prendre le lecteur à la gorge et de la hanter longtemps. Ici, on revient à quelque chose d'à la fois plus élaboré et plus insaisissable, plus proche du reste de son œuvre.
Le Passager cause beaucoup, et sur tous les tons. De là à dire qu'il est bavard, il y a un petit pas que je vais me permettre de franchir allègrement. C'est même l'essentiel de son moteur narratif.
D'un côté, au fil de l'errance crépusculaire du protagoniste, on voit s'allnger des dialogues interminables entre des personnages plus ou moins quotidiens (certains paraissent plus farfelus, mais sans qu'on comprenne réellement pourquoi ni qui ils sont, car McCarthy se tient aussi éloigné que possible de tout psychologisme et de tout portrait détaillé), qui causent de choses quotidiennes sans rien nous épargner, à la manière de héros de Tarantino mais sans la vista du dialoguiste de cinéma. De temps à autre, on aborde des sujets soudain plus trapus, comme la physique quantique ou la plongée sous-marine, en creusant bien profond, et le lecteur a tout à fait le droit de se sentir largué.
D'un autre côté, il y a ces passages, consacrées à la sœur du protagoniste, où surgit soudain une sorte de grotesque à la "Freaks", où les dialogues dégorgent de pitreries et de grossièreté foutraque, pour illustrer le profond malaise mental où s'enfonce la malheureuse jeune femme. J'aurais pu apprécier le parti pris si ces chapitres n'avaient pas été si longs, si inutilement longs au point d'en devenir parfois exaspérants.
La problématique au cœur du livre, c'est la langue. Ce qu'elle transmet ou non, ce qu'elle charrie, ce qu'elle sous-entend, ce qu'elle inflige, plus rarement ce qu'elle permet de soulager. La langue de McCarthy se charge de tout dans ce roman. Syncopée, violente, portée par un rythme qui pourra en fatiguer plus d'un (avec son goût pour les enchaînements de propositions scandées par des "et" en file indienne, pas du tout nouveau dans son travail), elle fouille autant qu'elle noie, partant dans toutes les directions pour tenter de creuser, au milieu de ce dégorgement, une forme d'existentialisme désenchanté, d'établir un constat humain confrontant au sentiment de la perte, d'une solitude constitutive de toute vie, et à l'approche inexorable de la mort.
Pour être honnête, la lecture de ce roman m'a épuisé, un peu laissé au bord de la route en dépit de très beaux moments réveillant soudain intérêt et curiosité, et j'en ai achevé la lecture rapidement et dans la douleur. Parce que, si je suis capable d'appréhender la puissance littéraire et la singularité du travail de McCarthy, je ne parviens pas vraiment à y être sensible. Cela ne me parle pas, ne me touche pas.
Je suis sans doute beaucoup moins intelligent que les critiques littéraires, hélas. J'espère juste que les lecteurs qui se précipiteront sur ce livre sur la seule foi de leurs articles y trouveront davantage de satisfaction que moi...