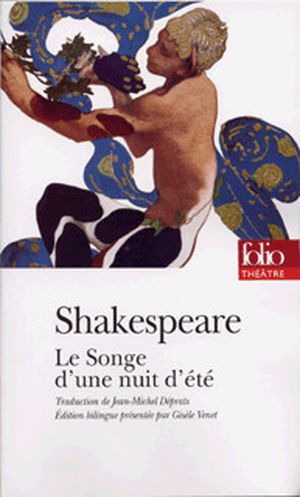"L'oeil du poète, roulant dans un parfait délire, va du ciel à la terre, et de la terre au ciel."
"Le songe d'une nuit d'été" est l'un des rares cas où Shakespeare n'a pas réécrit une histoire déjà connue. Cela n'empêche pas la pièce d'être parsemée de références à de nombreuses oeuvres qui ont nourri l'imaginaire du brillant dramaturge: "Les Métamorphoses" d'Ovide, véritable livre de chevet de Willie, le bien membré "Âne d'or" d'Apulée, "Les Contes de Canterbury" de Chaucer et "Le Livre de Huon de Bordeau" étant les principales sources d'inspiration, pour le moins éclectiques. Rien d'étonnant lorsque l'on contemple le résultat final...
"Le songe..." est une oeuvre assez complexe car composite, avant tout comédie, certes, mais rehaussée d'éléments tragiques et féeriques. La comédie est assurée par une bande de rustres qui, s'improvisant comédiens à l'annonce du mariage du Duc Thésée, se lancent dans l'élaboration d'une pièce de théâtre complètement dégingandée, du niveau de celle que vous pourriez monter en trois heures avec des potes bourrés. La tragédie repose sur le destin de quatre jeunes gens aux amours contrariées (le contraire serait étonnant), réunis par la force des choses dans une forêt en proie aux esprits nocturnes. Ce sont bien évidemment ces derniers, lutins, fées et autres affreux elfes qui assurent la partie fantastique de la pièce. Dit comme ça, les choses semblent claires. La vérité: ces trois histoires, ces trois univers, ne cessent de s'enrichir mutuellement, de se contrecarrer, s'influencer, se couper, dans un grand foutoir carnavalesque digne de la veine maniériste du baroque.
Si ce syncrétisme de l'imaginaire est alléchant, un détail gênant m'a personnellement un peu refroidi... D'accord, faire se "rencontrer" dans la même oeuvre des personnages mythologiques (Thésée est mon héros grec préféré, alors attention !) et des créatures du folklore médiéval peut être une excellente idée à condition d'équilibrer l'ensemble. Vous savez, histoire que tout ce petit monde résiste brillamment au choc des cultures qui ne peut manquer d'arriver, pour la plus grande joie du théâtre baroque dont le but est tout de même de dégager une certaine harmonie de l'exagération, du doute, de l'illusion, etc. Malheureusement, la partie d'inspiration mythologique ne m'a pas vraiment convaincue. Pour être franc, Shakespeare ne s'inquiète absolument pas de respecter l'héritage grec, malgré quelques allusions un peu vaines, et le côté artificiel de la présence de Thésée, d'Hippolyte et d'Egée (qui n'est même pas le père de Thésée, ici !!) m'a violemment sauté aux yeux. Je sais pertinemment que l'idée de la pièce n'est pas de faire montre d'une cohérence implacable, mais je ne peux pas pour autant prétendre que le mélange des genres soit tout à fait réussi. Comment voulez-vous ne pas tiquer quand, dès les premières pages, le grand Thésée (qui est "Duc d'Athènes" depuis quand, d'ailleurs ?) donne son accord pour l'éventuelle mise à mort d'une jeune fille sans être plus troublé que ça ("Hé oui ! Tu vas mourir, c'est la loi ! Bon, maintenant je dois te laisser, j'ai un mariage à préparer...") ?
Une fois surmonté ce choc, j'ai néanmoins été capable d'admirer tous les autres éléments de la pièce. L'humour employé par le dramaturge me plait beaucoup: tour à tour cynique, grivois, parodique, le comique est avant tout employé comme effet de distanciation et nourrit véritablement le projet du "Songe...": poser une réflexion sur la nature du théâtre en particulier et de notre imaginaire en général, via une mise en abîme aussi profonde que poétique. Tout est asséné avec délicatesse et subtilité, chaque scène contient son lot d'idées stimulantes qui fournissent un second degré de lecture absolument passionnant. Si, en plus, je vous avoue que Thésée a tout de même la meilleure réplique de toute la pièce, un monologue d'une insoutenable perfection poétique dans l'acte V, vous comprendrez aisément que tout se termine pour le mieux après un début un peu difficile.
Le déséquilibre du "Songe...", dont la puissance onirique excite l'imaginaire tout en restant inachevé, voire un peu bancal, en a paradoxalement fait une des oeuvres de Shakespeare les plus appréciées et les plus reprises dans la culture mondiale: d'innombrables mises en scène à travers les siècles, bien sûr, des plus chargées aux plus sobres, de la musique (le très célèbre ballet de Mendelssohn), des peintures (Füsseli fut inspiré par cette pièce), des bandes-dessinées (Gaiman et son inoubliable reprise de la pièce dans son chef-d'oeuvre "Sandman")... Jumeau tordu et troublant de "Roméo et Juliette" dont il partage la probable date de composition (1596) et de nombreux éléments, "Le songe d'une nuit d'été" est une porte d'entrée idéale dans l'univers de Shakespeare, le début de sa période de maturité, encore toutefois marquée par la fraicheur de la jeunesse.
N.B. Pièce lue dans l'édition bilingue "Folio Théâtre", dotée de la traduction particulièrement gracieuse de Jean-Michel Déprats, ainsi que d'un appareil critique vraiment éclairant qui n'est autre que celui de la Pléiade (tout comme la traduction, du reste).