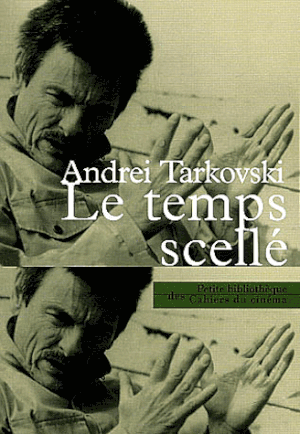Réédité en 2014 par les éditions Philippe Rey, Le Temps scellé, écrit par Andrei Tarkovsky est un essai rédigé en plusieurs années, essentiellement pendant les périodes de chômage forcé pour le réalisateur. Peu rancunier, Tarkovsky ne traite presque pas de ses rapports contrariés avec le pouvoir soviétique, alors en place en URSS, préférant consacrer sa plume à son art, le cinéma, et à toutes ses facettes. De là découlent des considérations sur comment, selon lui, les choses doivent être faites au mieux, pour que le cinéma dépasse enfin sa logique commerciale, ainsi que tout ce qui le rattache par des liens solides aux autres arts, afin de s’élever indépendamment, au rang des oeuvres à part entière. Plusieurs thématiques sont abordées : le jeu des acteurs, le montage, l’esthétique, la musique, à la fois à travers des productions que lui-même désigne pour leur exemplarité, d’autres pour leurs intentions avortées. Dans cet enchevêtrement, Tarkovsky cite également longuement ses propres films, non pas pour en faire l’éloge, ou jeter le discrédit dessus, mais pour tenter d’expliquer au mieux comment lui a procédé pour appliquer ce qu’il exige des autres, en le décuplant dans son travail. Par extension, le réalisateur n’hésite pas à faire sa propre critique, dès lors que son intention artistique, émotionnelle initiale n’a pas été accomplie dans son entièreté.
Les réflexions philosophiques de Tarkovsky qui s’articulent autour de la place du cinéma dans l’Art méritent d’être saluées, essentiellement pour leur qualité et leur richesse. Le tout recèle une vision forte, qui pourrait sembler dure, voire implacable. Et il est vrai que, en y réfléchissant intensément, il serait difficile de concilier la plupart des films que nous connaissons avec une vision aussi absolutiste du cinéma. On pourrait ne pas être d’accord avec ce que Tarkovsky affirme, tout en clamant aussi qu’il n’a pas été capable d’atteindre son ambition, tant elle semblait être au sommet de la montagne la plus haute. Mais, il faudrait à ce moment-là proposer une alternative suffisamment tangible, et consistante pour pouvoir tenir la route de la comparaison, et de l’application directe dans le cinéma. Car le noeud du problème est bien celui du cinéma, en tant qu’art : comment le caractériser, le sublimer, le rendre unique, libéré des chaînes qui l’entravent face au reste ? Le cinéma possède une particularité ontologique, celle de capter des bouts, des morceaux du temps. Il s’agit (pour le moment ?) du seul art qui possède cette capacité formidable. Il faut ici creuser la notion de temps, afin de comprendre ce dont il en retourne : la littérature peut être détentrice de la mémoire, individuelle, collective, par le biais de l’écrit, en se faisant conservatrice de l’instant. La peinture, grâce à la couleur, dégage une émotion, palpable, une idée vague et imaginative du temps, tel qu’il a pu être, tel qu’il aurait pu être, voire tel qu’il sera. Le cinéma, lui, donne la possibilité d’aller beaucoup plus loin que la littérature, la peinture, ou encore la photographie : il enregistre des pans entiers du temps, tout en délivrant le pouvoir magistral de le modeler, de le rythmer, et de l’enfermer sur une pellicule, en pouvant le retranscrire visuellement, de façon à le mettre à la portée de tous. Dit autrement, le cinéma, en temps qu’art, art qui fait naître du temps construit à partir de rien, ou si peu, « recréer la vie ». De là se déroule une logique naturelle pour Tarkovsky, qui, considérant par ailleurs qu’il y a « encore tout à faire » dans le cinéma (et à juste raison, plus que jamais aujourd’hui), insiste sur ce qui fait la qualité première d’un film : le temps, au rythme inhérent dans les plans, à un stade déjà adulte, que le montage ne fait que corroborer. Par inversion, un film dont le rythme serait créé par le montage en lui-même serait comme mort-né, factice, et superficiel dans l’esprit du spectateur, qui à terme, et en y songeant à nouveau saurait intimement que ce qu’il a vu faisait office de poudre aux yeux.
Sans revenir sur tous les aspects traités par Le Temps Scellé, tout en sachant qu’il fallait parler du temps dans toute son abstraction pour tenter de faire comprendre la base de la réflexion Tarkovskienne en guise d’introduction, il est probablement utile de suivre la transition vers le spectateur. Tarkovsky affirme sans ambages que l’art est élitiste, par nature. Non pas qu’il soit réservé à une caste de privilégiés, dans l’idée, bien qu’il le soit en grande partie dans notre réalité contemporaine, mais, comme l’a affirmé Marcel Duchamp au début du 20ème siècle, il doit « dépasser le bon goût d’une époque », c’est-à-dire être là au moment où on ne l’y attend pas, en révélant une idée du futur qui a seulement germé dans le cerveau de l’artiste, mais dont l’évidence après coup est si limpide qu’elle en passe, sinon de suite, au moins après plusieurs années pour du génie. De fait, et de par cette caractéristique dominante, il apparaît que l’art ne peut être validé par une masse d’individus. Pas parce qu’il doit s’en passer, mais parce qu’il ne peut en être autrement. En cela, le cinéma, même s’il constitue en soi un art paradoxalement accessible grâce, et à cause de la passivité qu’il offre au spectateur ne doit pas tout lui donner sur un plateau d’argent. Tarkovsky parle à cet effet de « drame », tout en arguant la nécessité pour le réalisateur de faire jeu égal avec le spectateur, en le traitant comme il se doit, sans tout lui dévoiler d’emblée, comme s’il était un idiot impotent, ni en obscurcissant trop son propos, à coup de symbolisme suranné, ou de mystifications inutiles, cachant la faiblesse de l’intention comme de la poussière sous le tapis.
Et là, lisant cela, on pourrait s’écrier que, cette simplicité dont parle Tarkovsky existe, mais pas dans ses films. Pourtant, malgré les apparences, le réalisateur réitère fermement : il n’y a généralement rien d’autre de caché dans ses films que ce que les spectateurs veulent bien y voir, et s’en approprier, mis à part un cas particulier où il ne se cache pas d’avoir versé dans le métaphorique, l’interprétation multiple de-ci de-là, à doses minimes, pour Le Sacrifice, son dernier long métrage. Parce que, comme lui-même le prétend, à un moment donné, l’homme doit savoir dépasser ses propres exigences, non pas par échec, mais par transcendance.
Pour terminer, je voudrai simplement laisser ce paragraphe qui, par sa tonalité et sa chaleur m'a laissé le sourire aux lèvres toute une journée, comme rarement un auteur a su le faire : "je voudrais enfin, pour clore ce livre, dévoiler un espoir caché. J'aimerais que tous ceux qui ont été convaincus par ces pages, même si ce n'est qu'en partie, et à qui je n'ai rien dissimulé, soient devenus maintenant pour moi comme des alliés, des âmes soeurs".