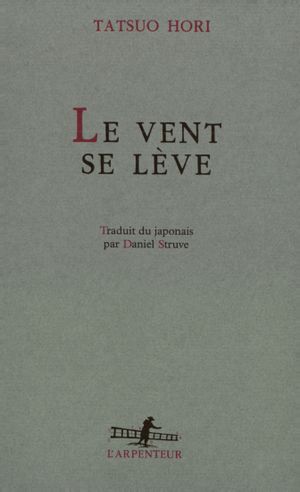Un roman-haïku magnifique
Pas grand chose, à peine une intrigue, à peine du sens : je sais qu'on peut le dire pour beaucoup de romans japonais, mais j'éprouve de la difficulté à mettre des mots sur ces 120 pages, à peine 120 pages.
Un écrivain accompagne sa fiancée dans un sanatorium à la montagne, et vit avec elle quelques moments suspendus, émouvants et pratiquement silencieux, tandis que la maladie, au gré des saisons, s'en va, revient, et finit par accomplir son travail. Un an plus tard, le héros retrouve les lieux jadis partagés.
On peut dire ce qu'on veut : que les choses sont suggérées, que la retenue et la délicatesse du trait sont particulièrement émouvantes, qu'aucune surenchère, aucun voyeurisme, aucune grossièreté ne viennent affecter ce récit d'une blancheur, d'une discrétion absolument remarquables, ou encore que l'histoire d'amour est belle et triste ; mais c'est encore peser de tout son poids sur ce texte.
Lorsqu'on referme la dernière page, c'est avec presque rien qu'on quitte le roman : aucune morale, aucune fin, aucun message, aucun sens caché, aucune réflexion particulière de l'auteur ; mais ce presque rien me semble infiniment précieux. Il a peut-être consisté à me rendre infiniment plus sensible aux petits regards, aux doigts qu'on pose sur sa bouche, aux infimes variations des saisons, aux écarts de voix, aux gestes, aux plis, aux manières de s'assoir et de marcher. On dira que c'est l'objet, sans doute, de tout beau roman. Mais ici rien ne pose ou ne pèse, comme disait Verlaine, et le livre me semble être un décalque à peine retravaillé au crayon, ici ou là, de la vie.
Un "roman-haïku". L'expression est de Natsume Sōseki pour qualifier Oreiller d'herbe. Et on trouve à première vue certaines ressemblances. Dans le roman de Sōseki, un artiste est également retiré à la montagne et médite sur son art.
Mais je dois avouer qu'à mes yeux, Le vent se lève correspond bien plus à l'image qu'on pourrait se faire d'un roman-haïku. Je n'aime pas trop, en général, ces histoires d'écrivain qui réfléchissent sur l'écriture, de poètes qui méditent sur la poésie. Autant faire une prière, comme disait Cioran, qui médite sur la prière... Oreiller d'herbe m'a souvent ennuyé pour cette raison.
Au contraire, Le vent se lève m'a semblé ici plus intimiste, réaliste, effacé, moins intellectuel. L'écrivain médite un peu, il est vrai, sur un roman qu'il projette d'écrire, mais sans que cela ne prenne le pas sur l'intrigue en général.
Et, pour le reste, il me semble qu'on peut se plaire à le considérer comme le développement poétique et narratif, toujours très court, toujours très simple, de quelques haïkus. Des haïkus à peine prolongés.
Du haïku, au fond, il en présente le même silence, la même austérité pour ainsi dire, mais aussi la même attention à la nature, aux animaux, aux saisons, aux petites choses. Mais, oui, surtout le même silence.
Rien, presque rien. Comme ce poème d'Issa qui me semble tellement correspondre à ce qu'on emporte, au final, en le refermant, de ce témoignage pudique, émouvant et magnifique :
Sous la brise d'automne
ces fleurs rouges
qu'elle aimait arracher
Ou cet haïku qu'on pourrait former à partir du vers de Paul Valery qui donne son titre et l'un de ses sens au livre :
Le vent se lève
il faut tenter
de vivre