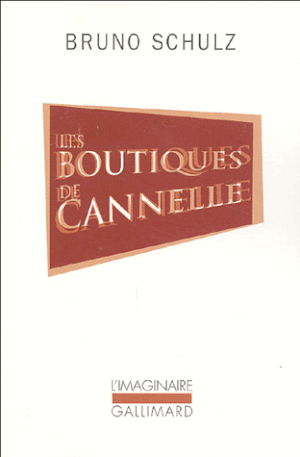Les Boutiques de cannelle est la première production littéraire du Polonais Bruno Schulz. J’évoque une « production littéraire » car on peut hésiter à la qualifier de roman très disjoint ou de recueil de nouvelles plein d’esprit de suite. B. Schulz collectionne en effet de multiples vignettes — le terme me semble nécessaire pour rendre compte de leur formidable densité visuelle — de l’étrange existence d’un jeune homme dans une ville anonyme de la province polonaise.
Les Boutiques de cannelle évoque le pronkstilleven, la nature morte ostentatoire qui a notamment fait la gloire de Jan Davidszoon de Heem ou de Pieter Claeszoon — l’œuvre est aussi débordante de richesses que ces tableaux pleins de verres Roemer, d’huîtres et d’agrumes ; mais plane aussi sur elle un sentiment d’inquiétude, que peut aussi susciter ces peintures flamandes dont les fonds noirs et gris forment un discret memento mori.
Ces nouvelles proposent d’abord une expérience sensorielle remarquable (raison pour laquelle — observation sans cesse réitérée — la comparaison parfois faite avec Kafka ne pourra pas aller bien loin). B. Schulz déroule sa prose avec une prodigalité qui a peut-être justifié que plusieurs traducteurs s’attellent à son importation en français. Il multiplie les accumulations dans un vocabulaire riche d’adjectifs et de métaphores originales, dès la première page qui évoque « les énormes quartiers de viande, puissants et nutritifs, avec le clavier musical des côtes de veau ; les légumes comme des plantes aquatiques, des méduses mortes et des mollusques » (on pense à Rimbaud vantant les poteaux télégraphiques).
À cette richesse répond une atmosphère d’inquiétude légère, transmise par l’absurde (« Cela commença quand il fit couver des œufs d’oiseaux » : la phrase aurait pu être écrite par Cortazar) mais aussi par une fascination pour la forme et le toc. Ce propos lancinant est traité sur tous les tons, y compris celui de l’exaltation (« “Si, perdant tout respect pour le Créateur, je voudrais m’amuser à critiquer sa création, je m’écrierais : Moins de fond, plus de forme !” ») ou du moralisme (sur l’amour : « Il leur aurait suffi d’un Pierrot bourré de sciure, d’un ou deux mots qu’elles attendaient depuis toujours, pour entrer enfin dans le rôle depuis longtemps préparé, suspendu depuis longtemps à leurs lèvres, plein d’une amertume terrible et douce, riche d’élans passionnés comme les pages d’un roman d’amour dévoré pendant la nuit »). Il dialogue avec les descriptions denses et sirupeuses de B. Schulz qui cherchent au contraire à épaissir la réalité. L’art devient la pectine qui permet de conjurer ou de transcender une existence en carton-pâte.