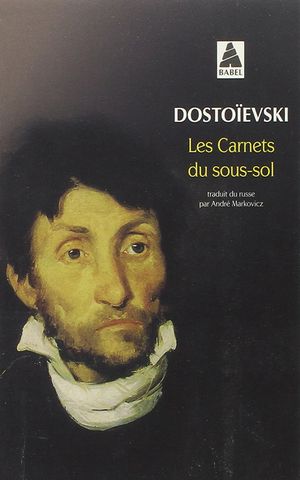Je vais essayer d’analyser le livre, plus riche qu’il n’y paraîtrait de prime abord.
Dostoïevski sort du bagne en 1854, Les Carnets du sous-sol paraissent en 1864. Dix ans durant lesquels cette expérience unique, tragique autant que bienfaitrice, a eu le temps de mûrir et de se développer dans l’esprit et la conscience de l’écrivain. C’est une « sinistre confession dont l’importance est capitale », nous dit Robert André dans l'introduction de l’édition folio, capitale en ce qu’elle « sert de charnière entre ce que l’on appelle parfois les deux manières de Dostoïevski », toujours pour le citer. En effet, après la publication du Sous-sol, l’écrivain se mettra à l’édification de ses chefs-d’œuvre les plus reconnus, les plus ambitieux, les plus complexes, que sont Crime et Châtiment, L’Idiot, Les Démons et Les Frères Karamazov, tous parus entre 1866 et 1881, année de sa mort.
Dans sa jeunesse, Dostoïevski était un socialiste plus ou moins convaincu, du moins très intéressé par ces idées-là, jusqu’à son arrestation et un simulacre d’exécution en 1849, qui fut une expérience absolument traumatisante pour lui. C’est à la suite de ces événements qu’il sera condamné aux travaux forcés, et il faut bien avouer que le bagne a probablement été le vivier d’expérience dans lequel l’écrivain a le plus abondamment puisé. Il le dit d’ailleurs lui-même, dans sa correspondance :
« Je n'ai pas perdu mon temps : j'ai appris à bien connaître le peuple russe, comme peut-être peu le connaissent ».
Ou encore :
« J'étais coupable, j'en ai pleine conscience… J'ai été condamné légalement et en bonne justice… Ma longue expérience, pénible, douloureuse, m'a rendu ma lucidité… C'est ma croix, je l'ai méritée… Le bagne m'a beaucoup pris et beaucoup inculqué. »
C‘est donc à partir de là que Dostoïevski abandonne ses idéaux de jeunesse et se tourne vers une conception du monde plus mystique, d’une certaine façon plus proche des hommes, qu’il s’interroge sur la foi, et qu’il remet sérieusement en cause la modernité. Plus globalement, c’est un roman qui chante l’imperfection, en même temps que d’être un miroir tendu vers les questions propres à son époque. Le roman d’une inquiétude métaphysique autant qu’un crachat violent à la face du monde moderne.
Le premier étonnement du Sous-sol, c’est la manière dont le narrateur se présente : « Je suis un homme malade… Je suis un homme méchant. Je suis un homme déplaisant. Je crois que j’ai une maladie de foie. D’ailleurs, je ne comprends absolument rien à ma maladie et ne sais même pas au juste où j’ai mal. ». C’est le premier paragraphe du roman et il ne cessera tout au long de la lecture de se rabaisser lui-même. La mention du foie, dont la bile contenue et déversée sera un thème exploité dans le récit, nous renvoie immédiatement à la conception médiévale des humeurs, c’est-à-dire au sens d’énergies intérieures qui nous gouvernent et nous caractérisent. En ce sens, la bile (ici, plutôt la bile jaune) est le moteur d’un tempérament acariâtre, violent et autoritaire. En un mot : désagréable. Dès le début, le récit est imprégné de l’image d’un homme qui n’a pas une belle opinion de lui, et qui tient manifestement à ce que ce soit précisé tout de suite, comme une prérogative à toute lecture potentielle, sans quoi on ne pourrait comprendre le propos.
Et c’est bien le cas, parce que cette dévalorisation est essentielle, c’est par elle que le narrateur existe, et pour cela entre autre raison qu'il décide d'écrire. Car « la conscience, toute conscience, est une maladie », affirme-il plus loin. Et de la conscience, il en a, et même une très développée, plus que les autres hommes, les hommes ordinaires. Il prend donc la plume et déblatère, vitupère, maudit tout le monde, mais aussi lui-même, précisément à cause de cette conscience développée (ou grâce à elle, ce qui est toute la question). Très rapidement se formule dans le roman une dichotomie importante : celle entre les hommes ordinaires, qui sont les hommes d’action, et les hommes supérieurs, ceux qui pensent. Le narrateur se place dans la seconde catégorie, ce qui peut paraître paradoxal pour quelqu’un qui semble avoir une aussi basse opinion de soi. Mais justement, c’est cette conscience si développée, si « clairvoyante » pour employer son propre mot, qui lui donne la lucidité dont il fera preuve dans le roman. Il l'annonce lui-même : « Une conscience trop clairvoyante, je vous assure, messieurs, c’est une maladie, une maladie très réelle. » L’image que l’on avait de lui au début du roman se renverse alors, et l’annonce de sa maladie apparaît comme ayant été au moins en partie ironique : il est malade, certes, mais de lucidité. Et de poursuivre : « Plus était claire ma conscience du bien et de toutes les choses belles et sublimes, plus profondément je m’enfonçais dans ma boue, plus je me sentais capable de m’y enliser définitivement » : on voit bien là une fuite en avant, une fuite du beau, une peur de ce qui est élevé, ce que la mention ironique des « choses belles et sublimes » ne parvient pas à cacher totalement.
Le plus frappant est qu’il ressent une honte et une volupté dans cet état de fait, il parle quelques pages plus loin de « plaisir du désespoir » et de volupté dans l’humiliation, une volupté masochiste, donc. Mais cette volupté peut aussi s’expliquer autrement : « elle tenait à la sensation d’avoir atteint une extrême limite ». C’est à dire qu’on ne peut tomber plus bas, il y a une certaine idée du confort, celui d’une situation immuable, qui ne demande plus d’efforts. On peut penser à ce titre à la paresse d’Oblomov élevée au rang d’art de vivre et de moyen d’accès à un bonheur à hauteur d’homme, c’est-à-dire à un bonheur bas. Mais la bassesse serait peut-être toute la noblesse qu’une conscience clairvoyante pourrait se permettre en toute connaissance de cause ?
Chez Dostoïevski, il y a une omniprésence du sentiment de vide, et cela est annoncé dès la note de l’auteur : « J’ai voulu montrer au public, en en soulignant quelque peu les traits, un des personnages de l’époque qui vient de s’écrouler, un des représentants de la génération qui s’éteint actuellement ». Un ancrage dans une réalité tangible et sociohistorique est actée, le narrateur des Carnets n’est plus seulement un homme bilieux et désabusé, confiné volontaire dans un sous-sol métaphorique, mais il est le véritable prétexte pour l’écrivain à une critique de la modernité, ainsi que de la civilisation. « Je ne suis parvenu à rien, pas même à devenir méchant ; je n’ai pas réussi à être beau, ni méchant, ni une canaille, ni un héros, ni même un insecte. » Ça sonne plutôt juste.
Plus tard il explique avoir attendu un héritage pour pouvoir quitter son emploi de fonctionnaire et se terrer en solitaire pour le reste de son existence. Voilà le portrait d’un homme qui ne trouve pas sa place dans la vie. Manifestation d’un mal-être fondamental, d’un mal-être dans la civilisation moderne, dans laquelle, sans doute, un homme intelligent et raffiné comme prétend l’être notre narrateur, ne saurait par définition trouver une place. Alors il parle, il prend la plume pour signifier son existence à défaut d’avoir parlé dans la vie, à défaut de s’être pleinement manifesté. Ce n’est pas faute d’avoir essayé, comme il le dit lui-même dans la première partie du roman, mais toujours son moi profond a repris le dessus, ce moi solitaire, méprisant et, d’une certaine façon, lâche (j’emploie le terme de moi profond pour plus de clarté). Ce mal-être se précise au fil des pages et devient un mal-être organique, si profond qu’il le ressent même physiquement : sa méchanceté, nous dit-il, n’est pas réellement présente en lui, il sentait des éléments qui l’empêchaient de l’être vraiment, et ces éléments « grouillaient » en lui, pour employer le même mot. L'emploi de ce verbe précis renforce l’aspect organique et foncièrement déplaisant de son mal-être, et on peut repenser à la mention du mal de foie, qui, comme pour l’hématome fatal d’Ivan Ilitch chez Tolstoï, revêt une dimension psychologique assez certaine.
Le narrateur nous apparaît alors comme un homme gouverné par ses sensations, par ses humeurs, et non par la raison, ce qui est le contraire d’un homme civilisé : il est donc un homme véritablement perdu, condamné à ne pas trouver sa place dans une collectivité d’hommes civilisés, c’est-à-dire d’une société, d’une civilisation. Et se poursuit la dichotomie déjà mentionnée entre les deux sortes d’hommes. L’homme de pensée est qualifié de « souriceau » par le narrateur, c’est-à-dire de bête de laboratoire, mais consciente de son statut par l’usage de sa raison, et qui met ses tiraillements, ses hésitations perpétuelles, au service d’un renoncement volontaire à la société, la société des « hommes de la nature et de la vérité » que sont les hommes d’action, comme il les appelle, ceux qui ont une « conscience ordinaire ».
Un cercle vicieux se dessine : ce renoncement donne lieu à de la rancœur, il fait bouillir la bile du narrateur, et il peut aussi être vu comme une dérobade. Après tout, le renoncement est une forme de lâcheté ! Parce que la volupté dont je parlais précédemment prend également place dans une attitude générale du narrateur, la volupté de la révolte inutile, qui par définition repose sur elle-même et n’a de fin qu’elle-même. Peut-être s’agit-il là d’une pose de sa part, puisqu’une révolte inutile est une révolte qui n’engage à rien, qui n’a aucun enjeu, et à plus forte raison lorsque l’on a passé toute sa vie à se taire et à se terrer dans son trou. On retrouve alors l’idée de confort dans ce repos du courage, ce qui nous amène au bien-fondé de la raison et de sa toute-puissance. Une autre distinction essentielle sera formulée par le narrateur plus tard, à savoir celle entre raison pure et volonté humaine, car un homme sans volonté est une coquille vide, un « écrou », c’est-à-dire une composante interchangeable d’un tout ordonné et prévisible, d’un tout calculable, et calculé. Dostoïevski semble précisément mettre ce renoncement à la société sur le compte d’une critique de la modernité et de son héritage rationaliste venu du siècle précédent, critique que je vais tenter d’étayer ensuite.
Les Carnets du sous-sol, c’est un roman. Il y a donc la question du regard, celui du lecteur, du moins d’autrui en général. Après tout, le narrateur décide de prendre la plume à la fin de sa vie pour la raconter, pour rédiger un carnet de mémoires, et quoiqu’il se défende de chercher un public et même de publier son journal, l’acte d’écrire implique celui de lire, automatiquement. Cette notion d’acte est d’ailleurs intrigante et se révèle fondamentale, puisque c’est le seul acte véritable qu’il aura accompli dans sa vie. C’est là que je convoque à nouveau Tolstoï, chez qui Anna Karénine se suicide, et qui par ce suicide accomplit elle aussi, paradoxalement, le seul et dernier acte de sa vie. Il semble y avoir chez les Russes de ce siècle un intérêt pour la nature de l’action et pour son opposition à la pensée, un thème manifestement cher à cette période de l’histoire où la raison étouffe les volontés humaines, un thème que l’on retrouve aussi dans la littérature de début de XXème siècle, et pas seulement russe. On pense à la phrase fameuse et pleine de sens de Drieu La Rochelle, dans Le Feu follet : « Un revolver, c'est solide, c'est en acier. C'est un objet. Se heurter enfin à l'objet. » L’objet est solide, on s’y heurte, on s’y heurte enfin (et l’objet est létal, toute une métaphore) : tout comme l’acte, il représente le concret, le tangible tant désiré dans un monde qui s’opacifie dans les brumes de la raison pure paradoxalement aveuglante. Et le narrateur du Sous-sol fait sienne, aussi, cette volonté, lui qui est impuissant, atteint d’apathie fondamentale de par ses hésitations permanentes. L’acte, comme l’objet, sont les îlots de vérité auxquels on peut s’accrocher et s’assurer que l’on vit, au contact desquels l’existence se prouve. En somme, des outils de la connaissance de soi (à la dernière page du chapitre 3, il y a un long passage qui explique parfaitement l’inertie dans laquelle est plongé l’homme à la « conscience raffinée ». Malheureusement je ne l’ai plus sur moi, lisez-le si vous avez le bouquin sous la main. D’ailleurs, lisez tout le bouquin tant que vous y êtes).
La lucidité permet de se rendre compte de l’impossibilité d’agir, la raison est frustration, l’intelligence un fardeau (peut-être faut-il voir là-dedans la signification du fameux slogan franquiste « A bas l’intelligence »). On remarque aussi une sorte de faux dialogue instauré durant toute la première partie du roman avec le lecteur, né du besoin de secours d’un narrateur perdu. Il exprime sa détresse : « Il y a des questions qui me tourmentent : aidez-moi à les résoudre », et le lecteur est pris à partie à de nombreuses reprises, sous forme de questions ou d’invectives. Prétexte au sarcasme et aux touches d’humour ? Mise en valeur de l’étendue de l’isolement d’un homme seul durant quarante ans, qui a besoin d’imaginer un public à son discours ? Rapprochement avec la dialectique platonicienne, dans laquelle la vérité résulte d’un dialogue entre au moins deux interlocuteurs ? On ne sait pas : « Il peut y en avoir des milliers, de ces motifs… ».
Dans tous les cas, le regard du lecteur semble important pour lui, comme si dans l’acte égoïste d’écrire ses mémoires, il espérait secrètement survivre dans l’esprit de quelqu’un, puisqu’il n’y a que l’écrit, le tangible, qui reste, et qu’il n’y a que dans l’écrit, dans l’action, que l’on se connaît.
Dans sa dévalorisation, le narrateur, en réalité, s’estime beaucoup et se place au-dessus des autres hommes. Il se dit être doté d’une conscience trop clairvoyante, opposée à la conscience normale, censée être celle de chacun, et que c’est cette conscience qui le rend malheureux et hésitant, cette conscience qui a amené la lucidité qui l’a empêché de s’affirmer durant sa vie. C’est pourquoi, en fin de compte, il dévalorise la pensée même, amoindrit l’aura de la raison au profit d’un éloge de la bêtise et de l’action. Car non seulement la raison pure est incapacitante, mais elle amène à un recul de la liberté, prise sous l’angle du libre-arbitre et de la fantaisie personnelle, c’est-à-dire de l’individualité brute, et donc pure. Pour le narrateur, le libre-arbitre est le bien le plus précieux des hommes, et il l’oppose à leurs intérêts, qu’ils soient des besoins primaires ou plus simplement des désirs matériels. Par cette opposition, il désigne le seul élément non calculable mathématiquement par la raison et qui garantit aux hommes leur liberté : car une volonté logique et calculée pour correspondre à un besoin raisonnable serait-elle toujours libre ?
C’est la question rhétorique que pose le narrateur, et par là l’écrivain. « Tout cela parce que l’homme, quel qu’il soit, aspire toujours et partout à agir selon sa propre volonté et non d’après les prescriptions de la raison et de l’intérêt ; or, votre volonté peut, et doit même, parfois, s’opposer à vos intérêts ». Cette affirmation est formulée en réaction aux théories utopistes, dont il se moque à plusieurs reprises dans le roman ; utopistes et utilitaristes, c’est-à-dire déshumanisantes, des penseurs du XVIIIème siècle, qu’ils soient russes, allemands ou français. Les penseurs et philosophes de la perfectibilité absolue de l’homme et de la cité. En résulte alors une critique de la civilisation moderne en tant que processus linéaire, qui selon l’écrivain ne serait pas nécessaire au bonheur humain, car loin d’offrir la paix « elle ne fait que développer en nous la diversité des sensations », c’est à dire des sensations bonnes comme des mauvaises. Il y a là l’affirmation du caractère neutre, impartial de la civilisation, comme si elle était une émanation de la nature autant qu’une construction humaine, une sorte de machine monstrueuse qui aurait échappé à son géniteur et qui serait dotée de desseins propres.
Mais c’est la civilisation du confort matériel et métaphysique qui est visée, celle bourgeoise du XIXème siècle, et un parallèle peut être fait avec la critique de la science prise comme un absolu, et donc avec le progrès. La liberté, la fantaisie individuelle est l’élément qui empêche toutes les utopies, c’est le grain de sable dans l’engrenage, car la fantaisie est arbitraire et ne peut par définition être calculée. Dostoïevski (ou le narrateur, mais peut-on encore les dissocier ?) prédit cependant un moment où cela sera possible, de par l’évolution des sciences mathématiques et statistiques, ou même économiques, et il met en garde contre ce moment. Cette exacerbation de l’individualisme semble d’ailleurs trancher avec les moqueries du narrateur à propos des romantiques, qu’il qualifie de stupides ; je dis trancher, car oui, comment nommer une telle démarche autrement que par « romantique » ? La raison pure rébarbative et déshumanisante mettant en danger le caprice ; plus encore, la volonté individuelle, insatisfaite de l’état naturel des choses, refusant d’admettre ce que le narrateur appelle le « mur » des lois immuables de la nature, celles contre lesquelles l’homme ne peut rien par définition : voilà du romantisme, et même la manifestation d’un orgueil démesuré ! Peut-être même pourrait-on rapprocher ça de l’idée de surhomme ? Le parallèle est sûrement possible, quand on sait que Nietzsche a découvert Dostoïevski précisément par ce roman, et qu’il s’est extasié à son propos dans une lettre à Franz Overbeck, historien allemand : « L’affinité instinctive a parlé tout de suite ; ma joie a été extraordinaire ».
Mais Dostoïevski est un Russe, et sa vision de la condition humaine est donc fortement teintée de ce que cet état de fait peut impliquer. Vers le milieu du livre, il fait le pari que, même si l’homme était plongé dans le plus grand des bonheurs, si tous ses besoins étaient en permanence satisfaits et qu’il n’aurait plus jamais à travailler ni même à se mouvoir pour accéder à ses désirs, il arriverait quand même à faire n’importe quoi, par pur caprice individuel, par « pure ingratitude ». Il y a là l’idée de la souillure intrinsèque de l’humanité, et surtout de ce besoin de souillure, « uniquement pour se prouver à lui-même que les hommes sont des hommes et non des touches de piano, sur lesquelles daignent jouer, il est vrai, les lois de la nature. » Encore ces lois naturelles, décidément aussi incapacitantes que celles de la civilisation...
Cette vision de l’homme en montre aussi le pouvoir de nuisance et la dangerosité que lui donne son libre-arbitre, car s’il devait en être définitivement privé (par le progrès, par l’évolution des sciences), il perdrait aussi la raison. Ainsi, la privation de l’un entraîne la privation de l’autre, on peut en conclure que, selon Dostoïevski, raison et fantaisie personnelle doivent s’opposer, mais également coexister. C'est l’idée de la polarité de l’homme, ainsi que la dissociation, en lui, de ces deux notions et de leurs buts. C’est pourquoi il ne faut pas calquer l’une sur l’autre : chacune a son but, chacune sert son dessein. Une très belle formule de Dosto pour le dire mieux ?
« Allons donc, messieurs ! Que restera-t-il de ma volonté quand on en sera aux tables de calculs et quand il n’y aura plus que ce “deux fois deux : quatre” ? Deux fois deux feront quatre sans que ma volonté s’en mêle. La volonté veut bien autre chose ! ».
A cette lumière, la mention de « l’homme cultivé du XIXème siècle » dont parle le narrateur en plusieurs endroits, s’éclaire et pourrait désigner, toujours d’une manière ironique, le Russe occidentaliste, c’est à dire, en fait un homme méprisable, tourné vers les idées nouvelles qu’apporte l’Occident rationaliste, éloigné de la Russie et de sa tradition. La bataille entre occidentalistes et slavophiles dans la Russie de ce siècle trouve ici son évocation, et Dostoïevski prend indéniablement partie pour les seconds, comme le démontre sa biographie d’ailleurs, lui qui a été socialiste dans sa jeunesse avant de se tourner vers un mysticisme slavophile. La critique de la modernité s’inscrit aussi dans ce retour aux sources russes, et le lien peut être établi avec Pouchkine plus tôt, chez qui la légitimité du nouveau tsar, Boris Godounov, est remise en question au regard de la tradition héréditaire qu'il rompt malgré lui, la lignée descendante du fondateur mythique de la Russie que serait Rurik.
L’incohérence, la souillure, l’ingratitude, le caprice irrationnel, en somme, l’imperfection de l’homme, seraient en fait partie intégrante de sa perfection, et c’est dans ces irrégularités que sa perfection peut éclater. Tout cela au sein d’une vision assez passéiste, que j'ai envie de lier aux arts baroques misant sur l’irrégularité et la fantaisie, ou encore au Moyen-Âge, époque de toutes les incertitudes ; dépourvue, en tout cas, de ce confort de la civilisation bourgeoise que Dostoïevski semble attaquer.
Je précise que tout cela n’est qu’hypothèses de ma part, évidemment.
Pour terminer ce (trop) long texte, je dirais que c’est la souffrance qui l'a fait accoucher de ce roman, et que c'est elle qui continuera son œuvre, poursuivie par Crime et Châtiment. Les Carnets s'achèvent d'ailleurs presque comme une transition :
« Ne vaut-il pas mieux terminer ce journal ? Je crois que j’ai eu tort de le commencer... En tout cas, je n’ai cessé d’avoir honte en écrivant cette histoire : ce n’est plus de la littérature, c’est un châtiment, une peine correctionnelle. »