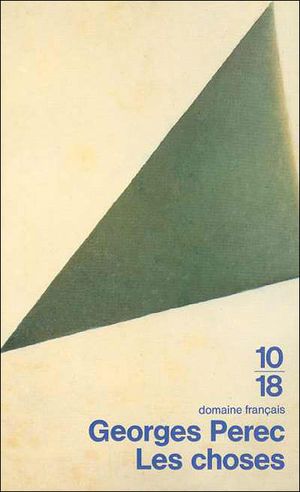"De petits êtres dociles, les fidèles reflets du monde qui les narguait. Ils étaient enfoncés jusqu'au cou dans un gâteau dont ils n'auraient jamais que les miettes."
L’écriture de Perec a deux faces, celle d’un scalpel et celle d’un pinceau. Son écriture est à la fois chirurgicale et impressionniste. Il dissèque autant qu’il peint. Et le lire relève autant d’assister à une opération qu’admirer un tableau de maître. Chaque bibelot décrit est un coup de pinceau, chaque chapitre est une précise incision. Et là est toute la puissance de ce roman aussi court que redoutable.
L’auteur oulipolien raconte une "histoire", celle d’un couple, Jérôme et Sylvie, mais il construit son récit comme le négatif d’une photographie, en ce sens que les objets, le matériel, la dimension consumériste inhérente à une vision du bonheur, tout ce qui est inerte, inanimé ou ne devrait pas avoir d’importance, de poids sur une soi-disant intrigue ou sur une quelconque une évolution narrative, tout cela est minutieusement décrit pour mieux mettre à l’air un cœur, des cœurs, façonnés par les choses, justement. Le matériel influe sur les cœurs, et non l’inverse.
En peignant les choses du quotidien, les choses possédées, les choses voulues, Perec fait l’autopsie d’un couple, représentant d’une société, l’autopsie d’un bonheur impossible au sein d’une vie qui s’essouffle de plus en plus. Posséder, mais pour quoi? Pour qui? La quête d'une image du bonheur ou du bonheur lui-même? Se poser les mauvaises questions revient à faire le vide d’un monde paradoxalement rempli, débordant de choses. Un monde où le plaisir du cher est parfois aussi si ce n’est plus fort que celui de la chair. L'auteur n'hésite pas à nous plonger dans la boutique obscure de ces protagonistes, leurs rêves plein d'espérance. La confrontation avec la réalité en devient incroyablement brutale.
Au-delà de cette violence, une véritable cruauté suinte des pages, et peut-être l'ombre d'un wake-up call avant que la lumière de la réalité ne l’estompe. C’est comme sortir de la Matrice, même si on sait qu’on y replongera. Mais une fois le livre refermé, on regarde autour de nous, les objets sur l'étagère, les cadres au mur, la lampe de chevet, Ikea probablement à l'instar de la table... Et tout prend une dimension étrange, fausse, ou disons faussée. Chaque objet devient un miroir, un miroir tendu vers se propre personne. On se sentirait presque comme Orson Welles à la fin de The Lady from Shanghai.
Je me souviens, l'année dernière, je me suis fait cambrioler. La façon rationnelle d'aborder la chose avait été simple: "Ce n'est que matériel." Un MacBook, ça se rachète, d’ailleurs, j’écris cette critique du dernier modèle, un MacBook Pro avec plus de mémoire, et un appareil photo Pentax reste un appareil photo. Son propriétaire va bien, c’est le principal. Oui, et puis il y a toujours l'assurance. C’est important ça, d’être assuré. On ne sait jamais. Ce roman de Perec a beau dater des années 60, la société plus consumériste que jamais a contribué à sa puissance intemporelle.
"Ils étaient à bout de course, au terme de cette trajectoire ambiguë qui avait été leur vie pendant six ans, au terme de cette quête indécise qui ne les avait menés nulle part, qui ne leur avait rien appris."
Rechercher la vérité fait partie de la vérité, selon Marx, cité à la fin du récit. Perec questionne nos vies. À nous de déterminer notre vérité et surtout, par-dessus tout, à nous d'apprendre. Car apprendre, c'est aller quelque part, c’est lutter contre l’inertie, cette condition horrible et vampirique, et après, on pourra se questionner sur la vérité du bonheur, et des choses, et sur leur véritable mode d’emploi.