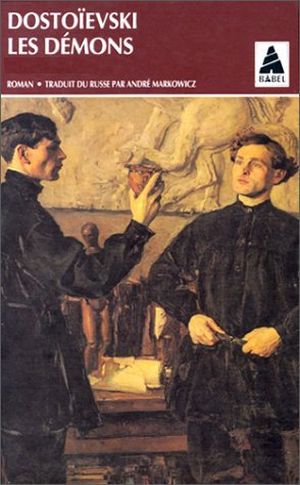Pourquoi est-ce mon roman préféré de Dostoïevski ?
Kundera a écrit quelque part que Démons est plusieurs romans en un, qu’il amalgame roman psychologique, satyre, comédie, discussion philosophique. Difficile de le contredire, Démons est le plus long et le plus foutraque des grands romans. Alors pourquoi celui-là ? Il n’a pas la pressante angoisse de Crime et Châtiment, la majestueuse grandeur des Karamazov ou la beauté lumineuse de l’Idiot. Pourquoi donc les Démons ?
Tous ses grand romans reposent sur des arguments assez minces, eu égard à leur longueur. Les Démons est le plus long et repose sur un projet d’attentat aux motivations nébuleuses. Mais en cela il n’est pas exceptionnel. Un parricide suffit à soutenir les mille pages des Frères Karamazov ; le crime de Raskolnikov intervient dans les premiers chapitres et ses conséquences font toute la trame de Crime et Châtiment. De ce point de vue il ne se distingue en rien: il prend un problème pivot et élabore son propos autour de celui-ci en faisant valser une foultitude de personnages plus ou moins secondaires.
Néanmoins, il se distingue par quelques particularités de structure qui font son originalité dans le canon.
Chez Dosto, les personnages sont souvent opposés selon un axe bien/mal clair. C’est Mychkine et Rogojine dans l’Idiot, exemple particulièrement clair si l’on pense que le roman est la chronique du balancement de Nastasia Filipovna entre ces deux extrêmes. Dans les Démons par contre, s'il y a effectivement opposition entre Verkhovenski fils et Chatov, dont l’opposition occupe la meilleure partie de la deuxième moitié, celle-ci se complique par l’insertion de Stavroguine, mis en opposition avec Verkhovenski et par celle de Kirilov qui cohabite et affronte Chatov.
À cela s’ajoute le fait que souvent Dosto utilise un protagoniste principal bien défini qui nous guide à travers le labyrinthe des états d’âme. Aliocha Karamazov par exemple. Dans les Démons par contre, qui est le personnage principal ? Pas le narrateur qui n’est qu’une vague couverture littéraire pour Dostoïevski lui-même. Verkhovenski père a l’honneur des deux cents premières pages mais est relégué assez vite, avec toute sa clique de vieux débris, à l’arrière-plan. L’homme dont l’ombre est la plus large est Stavroguine, mais il apparait après deux cents pages et disparait au milieu pour ne réapparaitre qu’à la fin. Piotr Verkhovenski est celui qui fait avancer l’intrigue et monopolise le milieu du récit, mais de plus en plus c’est dans son opposition avec Chatov qu’il prend sens à tel point que celui-ci devient progressivement le pivot thématique du roman.
Cette dissolution des repères est bien entendu voulue par Dostoïevski dont le but est de nous mener dans le tunnel de la passion et nous y perdre, un labyrinthe où il n’y a pas de lumière et dont la seule issue est le désespoir et la mort. L’unité du roman se crée dans ce mouvement éperdu vers la catastrophe, dans la fuite en avant. Il nous assène page après page le choc d’une moralité devenue folle, d’une société démobilisée, d’une jeunesse perdue et d’une vieillesse sénile, et après mille deux cents pages d’un tel traitement nous abandonne dans la nuit la plus noire, proprement possédés.
Les démons est pessimiste, certes. Il n’a pas la foi simple et ferme d’un Aliocha Karamazov. Mais ce pessimisme n’empêche pas Dostoïevski de se délecter dans le portrait de ce petit monde à la dérive : Verkhovenski-père et son groupe de vieilles badernes littératrices prostituées à une noblesse vermoulue (il me semble avoir lu que Tourgueniev se serait reconnu dans certaines pages et l’aurait très mal pris…), Kirilov et sa philosophie suicidaire amphigourique, Verkhovenski-fils révolutionnaire à la mie de pain juste capable de fomenter des meurtres à la petite semaine et des incendies d’izbas crasseuses. À certains égards, les Démons est le plus drôle de ses romans : son portrait au vitriol de la noblesse de province n’a pas rougir de la comparaison avec celui des Âmes mortes.
Et comme toujours il y a cette profondeur psychologique de tous les instants, cette angoisse qui suinte de chaque ligne qui fait marcher ses livres en dépit de leur parti-pris christique réactionnaire, en dépit du fait que Dostoïevski lui-même n’était, sous certains aspects, rien d’autre qu’un antisémite nationaliste orthodoxe intégriste. Preuve s’il en fallait que la question et la façon de la poser comptent bien plus que la réponse elle-même. C’est pour cela que le portrait qu’il fait de son temps parait encore si vif et actuel. Dostoïevski savait que toute violence critique doit d’abord s’appliquer à soi-même. Débarrassé de toute indulgence, même pour sa propre pensée, il dévoile tous nos nihilismes, nos tartufferies, nos compromissions, nos résignations. Les Démons est le roman de cette mise à nu sans pitié. Même si malgré tout le personnage de Chatov fait signe vers l’espoir des Frères Karamazov, il s’agit avant tout d’un monument de lucidité enragée. C'est un livre écrit avec un marteau et chaque coup résonne encore longtemps après la dernière page.