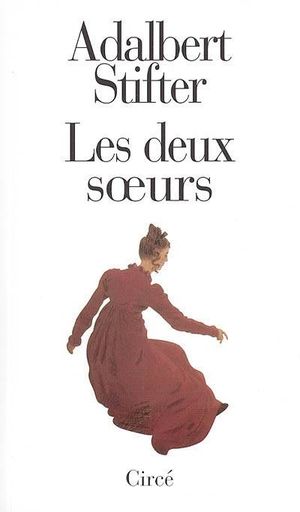Non seulement c'est quand même bath class de s'appeler Adalbert, mais en plus le gars - totalement délaissé en France comme il se doit - se paie le luxe d'être un romancier expé en plein XIXe siècle. Sturm, Drang et autres échevelades n'ont pas dans ses romans droit de cité, Stifter remonte les courants et fait les choses à sa guise : ici tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme et volupté.
Imaginez un Goethe reposé, un Stendhal apaisé, un Balzac sans intrigue, un Pinget en redingote, un Perec à boucles dorées, ou plutôt non, cessez donc d'imaginer, et laissez vous bercer par le ton inimitable d'Adalbert qui finalement ne ressemble à rien. Oh le ton non même pas, la tonalité. C'est doux, c'est obsédant, c'est léger et caressant, on dirait d'un lent zéphir dans les pétales fragiles d'un pavot nacarat.
Il se pourrait bien d'ailleurs que personne n'ait pensé à imiter le sieur Stifter pour la simple et peut-être bonne raison qu'à terme le roman en serait mort. Non mais : pas d'histoire, pas de coups de théâtre, pas de trahisons, de langueurs, d'ennui. Du simple bonheur à longueur de longues pages où l'auteur épuise le réel à le décrire point à point. Les lignes s'étirent, à la chaleur du soleil italien qu'aucun nuage ne menace. Le héros (le terme n'est en rien adéquat) s'englue dans la propriété de ses amis si gais, et soudain la vie semble tellement facile. Il suffisait d'y penser ? Oh, il suffirait de ne plus penser...
Oui, sous ses dehors de lisse boule à rêvasser, cette charmante romance campagnarde est à mon avis une bombe qui feint de s'ignorer. Les effleurements aussi, par contre coup, peuvent être bien brutaux. C'est comme de courir à la poursuite de l'horizon. La vie n'est pas dans les livres, mais n'est-il pas bien cruel d'en écrire un pour nous le dire ?