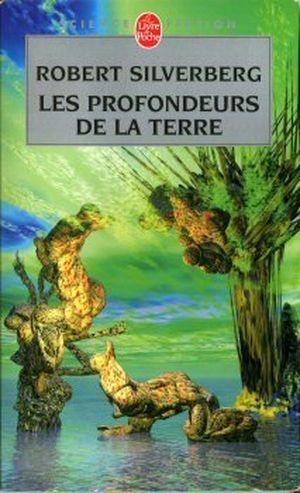Autant en emportent les brumes
Il y a chez Silverberg une forme de poésie tragique - que l'on retrouve dans la quasi-totalité de ses romans. Cette poésie tire sa beauté d'une esthétique du déclin, de la lutte désespérée, pour finir systématiquement dans une forme d'apothéose qui nous apprend que les peurs, les tensions éprouvées tout du long non seulement étaient vaines mais aussi fallacieuses.
Sigmund est le catalyseur parfait, le prisme qui permet à cette poésie de se manifester et de rayonner dans tout le roman. Revenu sur la planète où il a connu la grandeur, l'amour, le peché, Sigmund cherche à éclaircir les mystères qui le hantent depuis plusieurs années ; et d'une certaine manière, c'est en perçant les mystères de Belzagor qu'il percera les siens propres et pourra enfin se retrouver lui-même, s'unifier, se purifier. Voilà qui donne de belles images, auxquelles l'on ajoute l'exotisme de Belzagor, ses créatures intelligentes aux formes et modes de pensée tout à fait étrangères aux conceptions humaines. Mais la beauté poétique n'est pas tout, et parfois ce n'est plus seulement la mélancolie qui accompagne SIgmund, c'est également une forme d'ennui ; car le récit manque de rythme, et malheureusement l'épaisseur d'un papier à cigarette du personnage, son tempérament assez anodin somme toutes, contribuent à l'engluer parfois dans la vase de la planète tropicale. Faits suffisamment regrettables qu'ils font parfois "sonner faux" le livre et qui ne permettent pas réellement de s'attacher au héros. Ainsi, Les Profondeurs de la Terre laisse au lecteur un goût amer, celui de la beauté illusoire dont les vapeurs brumeuses se dissipent aussi vite qu'elles sont apparues. Dommage.