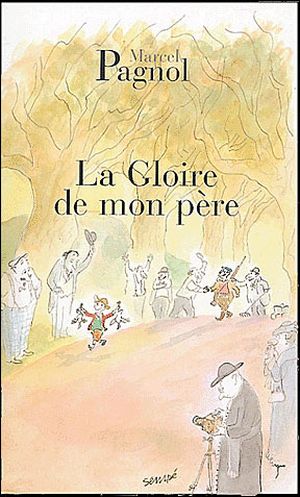Voilà un classique, La Gloire de mon père, de ce bon vieux Marcel, passé au moulinet de la canonisation, et du coup, imposé à une foultitude d’enfants par des enseignants-fouettards. Ils lisent Pagnol en cours élémentaire, ils en subissent les dictées. Quant à ceux passés entre les mailles du filet, ayant évité Pagnol au cours d’une scolarité hantée par son spectre, ils sont bien trop contents de se voir saufs pour s’y plonger de leur plein gré. Ils se vanteront au cours de soirées mondaines : « Moi Pagnol ? Mon frère a dû le lire lorsqu’il avait dix ans, il en pleurait tous les soirs. J’y ai échappé, crédiou, et ce serait cracher sur le destin bienfaiteur que d’y mettre le nez. » Voilà quel a été mon crédo pendant longtemps. Jusqu’au jour où j’ai décidé de cracher sur le destin bienfaiteur. Bien m’en a pris.
Il n’y a rien d’exceptionnel chez Pagnol, tant dans l’écriture que dans la structure narrative, rien qui a priori justifiât cette diabolique canonisation, hormis peut-être un talent certain de metteur en scène (normal, sans doute, pour quelqu’un venu du théâtre et du cinéma). Pour autant, La Gloire de mon père vaut la peine d’être lu.
La Gloire de mon père, c’est la nostalgie, ce sont les cigales. Le livre ouvre une fenêtre temporelle, pousse de force le lecteur à travers celle-ci, qui tombe lourdement sur une sente desséchée couverte de poussière et de crottes de lapin au milieu de la garrigue. L’auteur y joue le jeu de l’enfance, où les parents sont des dieux, et où le monde se limite à l’entour, au village, aux collines à l’horizon. L’enfant goûte, savoure cet univers restreint, il le découvre, il l’apprivoise. La Provence, la garrigue, les cigales, les bartavelles y sont autant d’évidences regorgeant pourtant d’indicibles mystères et de possibles aventures. Pagnol immerge le lecteur dans cette Provence merveilleuse et le submerge d’images. L’œuvre est follement dépaysante, et renvoie à tellement d’amour et de nostalgie que le pauvre lecteur ahuri et sceptique ne peut plus s’empêcher d’en tourner les pages ; il ne veut pas abandonner le cocon douillet et rassurant où l’a conduit Pagnol. C’est là que se trouve la force de La Gloire de mon père, c’est dans cette faculté qu’il a de nous mener par la main à travers les rues du village jusqu’aux collines, de nous inviter à traquer la mystérieuse bartavelle avec lui.
Et sans que nous nous en rendions compte, nous tournons la dernière page, tristes de voir s’interrompre nos vacances dans le Midi. Mais encore quelques instants nous entendrons les cigales chanter, et nous nous dirons : « Crédiou, quel merveilleux été je viens de passer. »