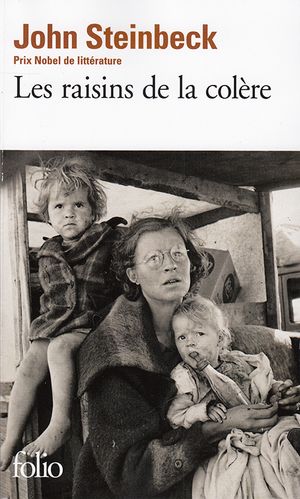Longtemps, je m'étais posé la question du concept de chef d'oeuvre en littérature. Quelque part, ces chef-d’œuvres sont rares, ce qui s'explique par leur caractère de complétude, en ce sens qu'ils atteignent l'universel par une forme de transcendance littéraire, qui ne passe pas par Dieu, mais par les mots. Chaque lettre forme un atome imparfait pour reprendre l'expression de Lucrèce et ainsi, une seule petite variation du texte pourrait déséquilibrer totalement l'harmonie de l'oeuvre générale. Les Raisins de la colère de John Steinbeck représente l'un des quelques rares joyaux de la littérature mondiale, certes alourdie légèrement par une traduction française parfois maladroite, mais qui n'en reste pas moins un roman que l'on pourrait qualifier à de nombreux égards de parfait. Ce roman est tout simplement la représentation aboutie, pertinente et indépassable de la question sociale aux Etats-Unis, et même plus généralement de la question sociale au XIXème-XXème siècle. Parfois même, il dépasse ce cadre temporel pour éclairer d'une lumière nouvelle, crue et sans concessions des thématiques actuelles, comme l'extrême pauvreté de nos sociétés, et également, de façon plus étonnante, de la question migratoire. John Steinbeck semble avoir tout compris, et se trouve être beaucoup plus efficace qu'un marxiste-léniniste classique, ou qu'un anarchiste, ou encore qu'un socialiste: il présente la question de manière concrète, multifactorielle, observant tant bien les causes individuelles, que les raisons financières et collectives de ces situations, avec une finesse d'analyse, d'observation et de pensée qui époustoufle le lecteur. Par la littérature, il réussit sans rien laisser paraître tout ce qu'aucun philosophe ou sociologue n'a réussi. Il fait tout comprendre, sans rarement dire clairement ce qu'il pense, parvient à nous faire saisir le fonctionnement d'un personnage sans pour autant nous abrutir par un psychologisme de bas étage.
Le roman s'ouvre sur la description magnifique et cruelle d'un cycle naturel d'une récolte, assassinée par la poussière et la sécheresse. Les familles, déjà pauvres, qui cultivent des terres de l'Oklahoma, s'interrogent et observent la fatale catastrophe qui les frappe. La banque, si bien décrite comme un montre inhumain composé d'humains, eux-mêmes dépassés par le Léviathan qu'ils semblent incarner malgré eux, expulse les métayers de ces terres dont elle est la propriétaire depuis la souscription des anciens fermiers de crédits. Ces crédits meurtriers, des chevaux de Troie envoyés par des grands propriétaires fonciers et des financiers sans scrupules, permettent alors le remplacement froid de ces hommes et de ces femmes par des machines, arrachant les familles à leur terre, les déracinant et ainsi détruisant la cellule traditionnelle familiale. Quand de rares métayers demeurent sur place comme conducteurs de tracteur, des milliers de personnes se retrouvent sans demeure, livrées à la route, ce serpent de bitume, dans le dénuement le plus extrême, confronté à la mort, à la famine et à l'indifférence la plus totale. C'est le cas de la famille Joad qui décide de se rendre comme tous les autres en Californie, présentée au début du livre comme un nouvel Eden, mais qui se révèle dans la deuxième partie du livre être l'Enfer sur Terre livré aux grands patrons qui profitent de l'immigration des Okies pour réduire les salaires, exploiter leurs terres, les laissant mourir en les livrant à la fureur de milices locales corrompues et haineuses. En filigrane, l'espoir de la grève générale, la critique de la religion protestante et de la prison comme superstructures marxistes, la dénonciation des égoïsmes provoqués par la Finance elle-même, le rôle de la femme, la dislocation de la famille dans le nomadisme et la tragédie humaine de la pauvreté. Le propos est si juste qu'il serait inutile d'en dire davantage, sauf peut-être de rendre la lecture du livre la plus urgente possible pour les lecteurs encore vierges de l'écriture steinbeckienne.
Que dire du style à part qu'il est très agréable, bien que parfois très lourdement traduit? Les descriptions sont jolies, poétiques, presque méta-littéraires. Elles laissent souvent très vite la place à plusieurs types de chapitre : des moments pendant lesquels le lecteur suit à la trace la famille Joad, par des nombreux dialogues, dont Steinbeck est véritablement un modèle, tant il les mène avec brio et talent. Il expérimente également des chapitres originaux, qui sont riches de tentatives littéraires originales et réussies, comme le suivi d'une tortue, l'observation d'une journée dans un restaurant sur le bord des routes ou dans un commerce de voitures, etc ... D'autres fois, John Steinbeck se livre à un véritable réquisitoire politique, social et économique qui fait l'effet d'une balle de revolver tant elle est vive et éclairée, peut-être un peu violente, toute teintée d'un espoir de Révolution. La lecture de ce livre est un véritable plaisir, tant sur la forme que sur le fond, et elle témoigne tout de même d'un pessimisme, et d'un véritable sens du drame que Des Souris et des hommes ou La perle avaient déjà mis en évidence. John Steinbeck ne vole pas son appartenance au mouvement incroyable de la Génération Perdue et s'en fait à mon sens le meilleur des éléments. Steinbeck semble obnubilé par la question sociale, par le soucis de la dignité humaine, et, en niant toute autre différence, participe à la création d'un Homme Universel. A l'heure d'un néo-libéralisme, et d'un traitement de l'immigration inhumain, la lecture de Steinbeck est plus que jamais essentielle.