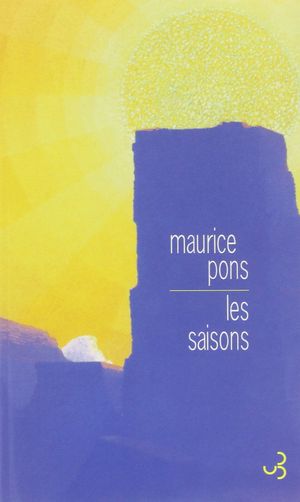« Vous pouvez leur dire, à vos Stars de la Sainte Russie, et à tous vos étrangers de l’extérieur, que chez nous, du pain, y en a pas. C’est la lentille chez nous, mon beau monsieur : soupe de lentilles, beignet de lentilles, alcool de lentilles… Et voilà. » (p. 21)
Les lentilles, tout le monde sait ce que c’est. L’alcool aussi. Pourtant, il faut un petit travail d’imagination pour imaginer à quoi peut ressembler de l’alcool de lentilles. (Je me dis qu’il faudrait en boire pour savoir. J’aimerais mieux ne pas savoir.) C’est la même chose avec les Saisons : la campagne, tout le monde sait ce que c’est ; une œuvre de fiction centrée sur un personnage solitaire aussi ; pourtant, cet étrange roman campagnard déroute énormément. Alors que le titre n’annonce rien de tel. J’insiste vraiment là-dessus : pris un à un, aucun des éléments figurant dans le livre n’étonne ; c’est leur association qui donne lieu à un véritable délire, comme ces substances chimiques stables qui produisent des cocktails détonants dès qu’on les mélange à d’autres substances chimiques stables… On peut penser au Buzzatti du Désert des Tartares, à du Julien Gracq contaminé par un virus mutant, voire à du Jacques Abeille version années 1960. Si les Saisons étaient passées au cinéma, ç’aurait pu être Black Moon de Louis Malle et son poney-licorne.
Le cadre des Saisons est un village où l’on semble ne pouvoir arriver que par hasard ; les saisons, justement, y sont au nombre de trois – saisons de la pluie, du gel et de la neige – et d’après mes souvenirs l’année y dure quarante mois. Pour peupler ce décor sans nom et hors du temps, une galerie d’échappés d’un tableau de Bruegel, avec quelques figures kafkaïennes au milieu : Louana la fillette lubrique et sauvage, le Croll en bon gros géant borgne assoiffé d’alcool, une paire de douaniers grotesques et inquiétants, une aubergiste qui semble un condensé de bassesse… Les loisirs de ces braves gens : commérer, et s’extraire mutuellement la séborrhée sale des ailes du nez…
Le personnage principal est un voyageur dont on ne saura jamais s’il reste au village par résignation, par un choix naïf ou parce qu’il y trouve la souffrance qu’il cherche. Un peu scientifique, en tout cas se proclamant dépositaire d’une science que les villageois seront trop occupés à confondre avec la magie pour qu’elle lui soit de quelque utilité. Tantôt agneau – « agneau souffrant », p. 81, mais aussi « plus coupable que l’agneau qui vient de naître », p. 147… –, tantôt bélier – « vieux bélier, obstiné, rageur » (p. 195) et à « l’air triste » (p. 13) –, Siméon est surtout écrivain, bien qu’« au cours de son existence déchirée, il n’[ait] jamais réussi à trouver ni le temps ni surtout le lieu propice à l’exercice de son métier » (p. 32). On se demande bien quelle image de l’écrivain veut donner l’auteur des Saisons. Veut-il seulement donner une image de l’écrivain ?
D’une manière générale, si cet anti-Évangile est un chef-d’œuvre, c’est parce que le porte-à-faux et l’indécision y sont roi et reine ; non seulement ils règnent, mais ils gouvernent. Le travail sur la langue – oui, « les yeux d’un bleu très pâle, un peu comme le ventre d’une truite » (p. 177), c’est le genre d’images dont je me souviens – place la question de la compréhension au centre de l’œuvre, ce qui est à mon sens le propre des grands livres. Si « les lecteurs des Saisons forment une sorte de confrérie d’initiés » (quatrième de couverture), c’est parce que la musique de cette langue reste en tête, et qu’on n’oublie pas non plus ces épisodes à la fois grotesques et fondamentaux que sont les scènes de l’âne, du coït ou du vêlage… N’importe quel lecteur ou presque comprendra littéralement ce qui s’y passe ; mais je défie quiconque, y compris les plus « initiés » d’interpréter ce roman de façon définitivement satisfaisante.
Ce n’est pas un défaut, au contraire. L’irréductible noyau des Saisons résiste à la plupart des outils dont on peut apprendre à se servir au cours d’une carrière de lecteur. On peut trouver des pistes dans ce roman, comme j’en ai proposé, on peut formuler des hypothèses à son sujet, jamais on ne pourra fondamentalement l’expliquer au sens étymologique, le déplier, probablement parce qu’il est inexplicable. L’auteur le sait, et je crois qu’il veut qu’on sache qu’il le sait.
P.S. du printemps (?) 2018 : Depuis les Saisons, j’ai lu Un roi sans divertissement, et il me paraît évident de rapprocher le récit de Pons de celui de Giono.