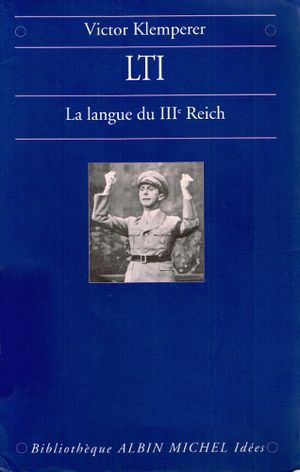Klemperer se penche sur l’usage des mots par le régime nazi. Travail universitaire, abécédaire froid et distancié du vocabulaire utilisé par le régime ? Non ! Car l’auteur, spécialiste de la littérature française enseignant à Dresde jusqu’en 1935, est d’origine juive. Témoin inquiet de l’ascension et de l’arrivée au pouvoir du nazisme, privé progressivement de ses droits et subissant des humiliations croissantes, bientôt mis au travail forcé, il reste protégé de l’envoi en camp de la mort par son mariage, son épouse étant allemande « de souche ». Il voit l’élimination de la population juive et l’Allemagne s’enfoncer dans la guerre jusqu’à son anéantissement final. L’ abominable bombardement de Dresde en février 1945 lui permet de s’échapper ; il erre alors des mois dans les décombres de ce régime meurtrier au milieu d’allemands à leur tour victimes du conflit. La fin de la guerre le voit retrouver sa dignité d’homme et sa chaire d’enseignement, dans un pays en ruine.
LTI porte donc en filigrane cette histoire d’un homme au bord du gouffre, presque une autobiographie, car pendant ces douze années ce pur intellectuel collecte en secret les textes de propagande, étudie les allocutions des pontes du régime, analyse le dévoiement des mots et l’infiltration, la « contamination » du vocabulaire commun par l’idéologie nazie.
Klemperer tire des conclusions d’intérêt général, qui font écho à Orwell, Gustave LeBon ou Bernays : Les mots peuvent être utilisés pour dissimuler la vérité, construire le consentement, anesthésier l’individu, empêcher la réflexion. Il pose aussi la question de l’origine du nazisme. Est-elle contenue en germe dans le naturalisme romantique et les auteurs chers à l’auteur (Heine, Rilke…), ou le nazisme les a-t-il seulement dévoyés ? Il constate avec amertume des similitudes, comme un écho, entre le nazisme et le sionisme de Théodore Herzl.
C’est aussi un regard porté sur l’humanité, car l’auteur a vu basculer dans le nazisme ses collègues universitaires, et la population en général. Mais il témoigne aussi de ces gens qui persistent à le voir en être humain, et qui encouragent d’un mot ou d’un geste, parfois au risque de leur vie.
Ces notes cachées au fur et à mesure furent péniblement regroupées après-guerre, ce qui donne un ensemble un peu disparate. Au final un ouvrage un peu étrange, une sorte d’hybride entre un travail de recherche et un journal personnel.
Un regard exceptionnel d’un intellectuel témoin et victime du nazisme, une interaction entre le régime assassin et sa proie qui illustre curieusement l‘aphorisme de Nietzche : « quand tu regardes l’abîme, l’abîme regarde en toi ».