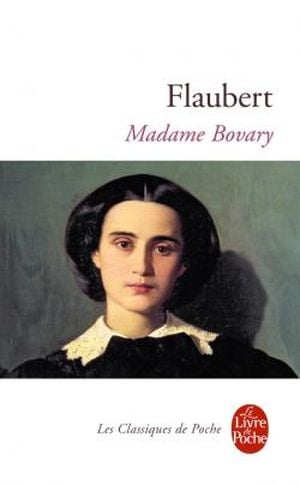Il y a très peu de livres au monde qui rendent aussi bien compte de la fragilité du vivant comme celui ci. Madame Bovary est ceci : un condensé de pâte humaine, médiocres alignés sur le verbe puissant de son auteur. A l'ennui et à l'ironie pincée de son récit et de ses mots, Flaubert place, toujours comme un souffle, toujours entre les lignes, la lave érotique et suave qui dynamite le réel.
C'est un livre qui offre à la bêtise sa beauté, à la trivialité sa folie, à de figures aussi tristes et balisées l'honneur d'un roman, l'honneur d'un regard, celui d'un peintre impartial à l'omniscience cruelle.
C'est un livre comme un paradoxe, le plus beau des paradoxes : la platitude est sujet à la plus intense des variations, courbes de plaisir et de malice qui se dessinent sur les arabesques des mots couchés sur le papier. Entre deux lignes se cachent des orgasmes, des malheurs, des coups de poing tendus à la face de la bourgeoisie. Bovary est une scandaleuse hybride, mutante, traînant sa robe, sa frustration et ses désirs, dans le drôle de monde de son auteur. Naturaliste, jusqu'à l'expression la plus romantique possible des chimères d'une femme coupable de rêver ; impartial, jusqu'à se donner à son oeuvre jusqu'au délire ; omniscient, jusqu'à incarner chaque individualité avec passion et complexité ; artificiel, jusqu'à rendre l'essence même de la vie et de ses états d'âme sur la page qui se tourne.
Le paradoxe, chez Flaubert, est bien une affaire de "jusqu'à". Il s'agit d'épuiser un système pour le rendre autre, le mystifier, le tourmenter, en donnant à lire toutes les nuances, lui en inventer d'autres, encore. Il s'agit de surpasser l'invention pour faire qu'elle en vienne à se confondre à sa source. Madame Bovary est autant le livre de l’impersonnalité que celui d'une radicale plongée dans les propres limbes et fantasmes originels de son auteur. Il en va de son mépris narquois autant que de sa croyance infinie envers ses personnages, de son pessimisme noir autant que sa foi inébranlable en la vie comme moteur de transcendance artistique, dans lequel il se jette, toujours tête baissée. C'est pour cela que Flaubert dérangeait. Parce qu'à la pureté, il inventait des vices. Parce qu'à la vie plaquée d'encre noir sur la feuille, il convoquait des fantômes et des formes nouvelles, uniques, ainsi que l'héritage dérangeant d'un lyrisme poitrinaire qu'il moquait. Il n'en avait rien à foutre, Flaubert, il s'est impliqué jusqu'à la folie, jusqu'au délire. Il a tout mis de lui et rien à la fois. Il a mis ses tripes et n'a fait que du faux. Aucune dissertation d'étudiant, aucune analyse, ne saurait pleinement épuiser la puissance de son oeuvre. Parce que Flaubert ne se contente de rien. A son récit monotone et réaliste, il offre des secousses et des abîmes insensés, plus forts que le plus palpitant éclat romantique. Au recul apparent et à la distance critique établit entre le romancier et ses personnages, il invente des chemins de traverse, des contres-allées sublimes qui le plongent dans le cœur profond de ses figures. C'est parfois l'affaire d'un mot, d'un verbe, d'une juxtaposition. Ecrire une seule phrase est une aventure, un accomplissement épique. Flaubert peut tout faire : faire de Charles, l'homme simple, l'homme médiocre, l'homme passif, un visage qui vit et qui s'émeut, qui existe, à lequel on croit, dont les traits bougent à chaque apparition. D'Emma, personnage étrange et désagréable, il peut accoucher d'un portrait de la souffrance féminine, que chacun peut recevoir en son sein.
Lire Flaubert, c'est lire le talent jusqu'à y déceler le travail acharné de l’illusionniste qui bat et qui enfle sous la couverture sobre de son trésor. Ecrire la vie avec style, voilà son travail insensé, impalpable, qui dépasse toutes les espérances, tous les rêves de lecteur les plus fous. Dans sa mesure et sa rigueur, Flaubert donne tout, crache tout. Pervers, presque. Car il élucide la bêtise de chaque corps et de chaque âme, et fait de cette bêtise l'alibi du style et de la beauté - le plus grand vice de ce roman, c'est ce roman lui-même. Tout ici surgit, avec évidence et surprise. De nul part (parce que Flaubert a tout inventé) et de la vie même pourtant (car c'est de la frustration de cette vie bourgeoise que les mœurs seront défiés). Les personnages déboulent, les ruptures s'accumulent, le roman est violent, bavard, ridicule, grotesque, pathétique, ironique, épanché, sexuel, sensuel, contestataire, conservateur, moral, amoral, immoral...
Pendant longtemps, on fit dire à Flaubert (et d'ailleurs encore aujourd'hui) cette belle formule : "Emma, c'est moi", sans vraiment de preuves sur la véracité historique et textuelle de cette affirmation. C'était la phrase la plus sensée lue sur cette oeuvre. Puis, on découvrit plus tard, dans une lettre, ce que Flaubert avait vraiment écrit, noir sur blanc : "Ce livre, tout en calcul et en ruses de style, n’est pas de mon sang, je ne le porte point en mes entrailles, je sens que c’est de ma part une chose voulue, factice. Rien dans ce livre n’est tiré de moi ; jamais ma personnalité ne m’aura été plus inutile". Impliqué jusqu'à se vider de sa substance, vampirisé par son oeuvre, Flaubert erre comme un fantôme autour des catastrophes essaimés. Comme Emma, gisant, pâle et cadavérique, la substance noir d'encre dégueulant de sa bouche, sur le lit de l'outrage. Flaubert a balancé une bombe qui explose encore aujourd'hui. Il a plongé dans ses flammes torrides, il a tout mis, tout balancé, et puis il a prit du recul, comme toujours. Il ne fallait plus lui parler de réalisme : à force de trop voir la vie, on passe de l'autre côté.