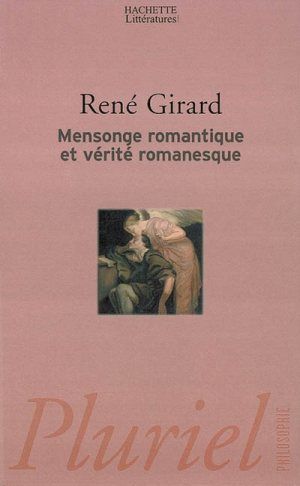Dans Mensonge romantique et vérité romanesque, René Girard oppose le roman romantique au roman romanesque : le premier est construit sur la dissimulation de la vérité ontologique de l’homme (son inauthenticité et sa vacuité pour faire simple), le second sur son dévoilement.
On l’aura rapidement compris : le propos excède d’emblée un cadre proprement romanesque pour porter sur l’essence de l’homme. Le postulat de Girard est simple : ‘homme est un être incomplet, caractérisé par l’inauthenticité et la vanité. Quiconque dévoile cette vanité est dans la vérité (romanesque) ; quiconque la dissimule est dans l’illusion (romantique).
Cette inauthenticité ontologique s’illustre, en partie, par le caractère mimétique du désir, objet principal de l’analyse de l’auteur. Loin d’être auteur et maître de mes désirs, ce n’est jamais que l’autre à travers moi qui désire, ou, plutôt, que l’autre à travers moi que je désire : « Le désir selon l’Autre est toujours le désir d’être un Autre ».
Pour autant, les hommes se mentent et s’illusionnent, et ce, de deux façons : en postulant la spontanéité de leurs désirs (illusion subjectiviste) ou en postulant la réalité des qualités de l’objet désiré (illusion objectiviste).
C’est ici qu’intervient la fonction du roman qui se doit de mettre à nu les mécanismes du désir, mécanismes qui s’opèrent toujours selon une logique mimétique. À travers eux, c’est toute la vacuité ontologique de l’homme qui apparaît.
L’une des analyses les plus fécondes de l’oeuvre est la démonstration de l’historicité de la médiation : de Cervantès à Dostoïeski, la médiation a changé de nature ; le médiateur n’occupe plus la même place face au sujet désirant : de supérieur au sujet, le médiateur, tout au long du XIXème siècle, devint l’égal, entraînant le sujet dans les méandres de l’envie, de la jalousie et du refoulement. Si la médiation externe s’affirme comme telle, la médiation interne, elle, se dissimule. Source d’élévation pour la première, la seconde est au contraire source de tourment : « Le héros de la médiation interne est une conscience malheureuse qui revit la lutte primordiale en dehors de toute menace physique et qui joue sa liberté dans le moindre de ses désirs ».
Alors, qui ne serait pas convaincu par le fond métaphysique de sa pensée – on est en droit de penser que l’homme est une substance plus qu’un vide, de l’être plus que du néant – sera certainement conquis par l’historicisation de la médiation du désir, difficilement contestable à mes yeux.
Si « l’homme possède ou un Dieu ou une idole » (Max Scheler), les idoles et les dieux d’aujourd’hui opèrent masqués et gisent dans les espaces cachés de nos esprits refoulés. Ils sont un voisin, un collègue, un ami. Et nous, pauvres jaloux inconscients, nous tombons dans la « maladie ontologique » par excellence : l’envie de l’autre et le mépris de soi ; deux vices dont seule délivre l’acceptation de la vanité de la vie et de l’être.