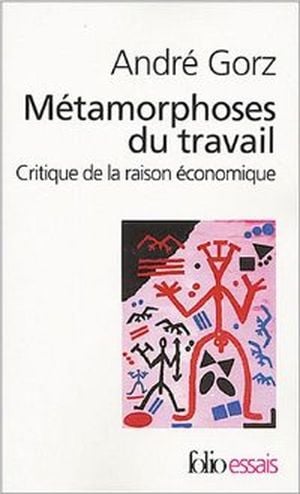Dans cet ouvrage, l’auteur propose une étude de la notion de rationalité économique, de son extension et de ses limites. La thèse soutenue est que passer ces limites, la rationalisation se transforme en son contraire.
Une idée structurante de l’ouvrage est celle du temps libre ou plutôt, libéré. En effet, pour l’auteur, il s’agit là d’une contradiction interne au capitalisme, système social qui « s’effraie de [l’]accroissement [du temps libéré] alors qu’il fait tout pour l’augmenter ».
Le progrès technique emporte un gain de temps au niveau social, lequel est inégalement réparti entre les individus. Il défend l’idée d’une réduction du temps alloué aux activités marchandes plutôt qu’une extension de cette sphère, idée qu’on retrouve souvent dans le discours économique dominant avec l’idée selon laquelle le progrès technique engendre plus de nouvelles activités qu’il n’en détruit.
Ce gain inégal de temps libre entraîne une scission entre une élite professionnelle d’une part et des personnes assignées à des activités de serviteurs d’autre part. L’activité de ces derniers permet de dégager davantage de temps libre dans la sphère de reproduction au profit des premiers : le cercle vicieux s’amorce donc. Les développements de l’auteur, sur ce point, mériteraient d’être approfondis, en particulier concernant la répartition de ces activités à l’échelle mondiale.
Cette scission est, pour l’auteur, différente de la scission en classes : la première serait fondée sur une dépendance personnelle de style féodal alors que la seconde refléterait les règles immanentes de fonctionnement du capitalisme. Une telle subjectivisation me semble à première vue douteuse et je pense notamment que saisir cette scission à son échelle mondiale permettrait de discuter cette idée.
Dans la première partie de l’ouvrage, intitulée « Métamorphoses du travail », l’auteur rappelle que ce qu’on nomme aujourd’hui « travail » est une invention de la modernité. Ce qui caractérise le travail au sens actuel, c’est qu’il est à la fois moyen et but de la société moderne. Il est une activité autotélique.
Il relève de la sphère publique, et non plus de la sphère privée comme pendant la période antique (la production étant alors dépendante de la reproduction, c’est-à-dire de la nécessité). A partir du XVIIIème, on commence à distinguer le « travail » qui désigne les activités pénibles des serfs et des journaliers car répétées chaque jour et « l’œuvre » qui désigne l’activité des artisans qui font des choses durables, donnant un caractère discontinu à leur activité. C’est d’ailleurs l’époque des corporations, lesquelles exercent un contrôle strict sur les innovations techniques.
L’auteur pointe alors une ambivalence de ce qu’on nomme « travail » : s’il apparaît comme le moyen de triompher sur la nécessité naturelle, il emporte pourtant la soumission aux instruments de cette domination de la nature. Il ne s’agit donc pas d’un affranchissement de la nécessité, simplement du remplacement d’une nécessité par une autre. Au soutien de cette idée de retournement de la domination, l’auteur défend d’ailleurs l’idée selon laquelle il existe une confusion des techniques de production et de domination, à commencer par la division du travail.
L’auteur évoque en suivant la scission du travail et de la vie, liée à ce qu’il nomme « l’intégration fonctionnelle ». Reprenant l’analyse d’Habermas, l’auteur présente le marché comme une régulation hétéro régulée, c’est-à-dire faites d’interconnexions fonctionnelles qui ne correspondent à aucune intention des acteurs.
Or, le développement de ces mécanismes d’hétérorégulation entraîne une scission de plus en plus importante entre travailleurs spécialisés motivés par des incitations sans cohérence avec la finalité des organisations auxquels ils sont intégrés et une élite d’organisateurs qui met en place les buts incitatifs. S’en suit un éclatement entre la vie professionnelle et la vie personnelle, dès lors que les deux relèvent d’ensembles de valeurs différents, voire contradictoires. Au final, c’est à une scission du sujet lui-même qu’on aboutit.
Face à l’idéal de l’humanisme au travail, l’auteur développe une idée proche de celle qu’on retrouve plus tard chez Boltanski et Chiapello : le capitalisme se renouvelle en intégrant sa critique. Plus précisément, le capitalisme a fait sienne les valeurs de l’utopie du travail, telle que la maîtrise de l’activité et la valorisation des capacités individuelles. L’auteur conclut à la caducité du travail comme facteur d’intégration sociale du fait de la contradiction interne au capitalisme déjà évoquée.
Or, sortir de cela implique davantage qu’un simple changement du régime de propriété des moyens de production : le capitalisme auto géré reste du capitalisme. Cela rejoint son analyse du communisme, qu’il voit comme la forme achevée de la rationalisation, laquelle s’étend à toute la vie (d’où des similarités entre l’éthique puritaine et la morale communiste). A ce stade, on voit comment la pensée de Gorz peut préfigurer celle des auteurs de la critique de la valeur.
Pour l’auteur, cette domination est due à la taille des organisations : la machinerie n’est pas appropriable. La division macro sociale du travail serait donc irréversible : pour l’auteur, il serait impossible de s’approprier à nouveau le processus productif, du fait de sa complexité. Est mise en cause notamment la soumission acritique aux impératifs techniques, sans considération des finalités.
Autre conséquence : la division du travail, la complexité de la production empêchent les travailleurs de se penser comme producteurs car, concrètement, ils ne produisent rien en propre : ils ne sont que les fournisseurs d’un travail standardisé comme mesure et interchangeable à volonté. Pire encore, la fragmentation du travail se traduirait par une fragmentation du vécu : ne sommes-nous pas à l’ère du divertissement, de l’information parcellaire, de la recherche des sensations fortes et des expériences éphémères ?
Si les constats de l’auteur sont marquants par leur finesse d’analyse, la solution proposée, qui demeure un peu simpliste, voire naïve, déçoit : l’auteur se contente de proposer un retour à une autonomie du politique. Or, s’il suffisait d’un projet politique radical (ou, pour le dire autrement, de vouloir pour pouvoir), on se demande bien pourquoi les choses n’ont toujours pas changé. L’auteur élude donc la question essentielle, qui est celle de savoir pourquoi cette volonté politique fait défaut aujourd’hui.
Dans la seconde partie de l’ouvrage, intitulée « Critique de la raison économique », l’auteur développe l’idée d’une « colonisation » progressive de tous les aspects de la vie par la rationalité économique. Il étudie comment nous sommes passés d’une production pour la consommation (le « ça me suffit » face à la nécessité) à une production pour le marché (le « plus vaut plus » nécessaire au profit). La rationalité économique et son extension entraîneraient une perte progressive de la liberté de définir le niveau comme le contenu des besoins et de l’effort fourni pour y répondre. En rompant le lien entre travail et besoin, le capitalisme fait triompher l’objectivité de la quantité.
D’une part, le « suffisant » est une mesure subjective contrairement au gain qui est, quant à lui, objectif. Or, la mesure quantitative n’admet aucune limite intrinsèque, contrairement au qualitatif. D’où la tendance inhérente au capitalisme à s’étendre le plus possible : pour l’auteur, l’histoire du capitalisme est d’ailleurs l’histoire de l’évolution des limites imposées à la rationalité économique.
D’autre part, la rationalité économique rend superflu les intentions (donc la politique) car elle réduit le monde à des calculs inaccessibles au débat et à la critique : s’il reste possible de discuter les moyens, les fins sont désormais soustraites à la discussion et le débat sur les moyens devient lui-même un débat purement technique d’experts. Cet impérialisme de la rationalité économique dispense le sujet de faire des choix (fondés sur des valeurs) et de les assumer : il n’y a plus que des décisions fondées sur le calcul économique, privées de sens.
L’auteur développe ensuite une typologie des activités humaines, laquelle a pour but de mettre en lumière ce qui devraient être les limites de la rationalité économique selon lui. Arrive enfin le projet de société de l’auteur, opposé au revenu universel (n’y voyant qu’une enclave de liberté au sein de la rationalité économique dans le but de la rendre acceptable plus longtemps) mais favorable à une diminution progressive du temps alloué aux activités marchandes au profit du travail non marchand, particulièrement du travail pour soi.
Pour finir, un défaut de l’ouvrage que je déplore est l’usage du terme « rationalité économique ». L’auteur emploie parfois le terme comme synonyme de « capitalisme », mais pas toujours si bien qu’on perd de vue le sens propre de chaque terme. En particulier, c’est la place historique de ces concepts qui n’est pas claire. Ce manque de rigueur dans l’usage de termes pourtant clés dans un ouvrage comme celui-ci me semble témoigner d’un manque d’analyse du capitalisme dans ses formes de base et de contextualisation de son développement historique (notamment par rapport à la rationalité économique, laquelle a existé avant le capitalisme en tant que tel).