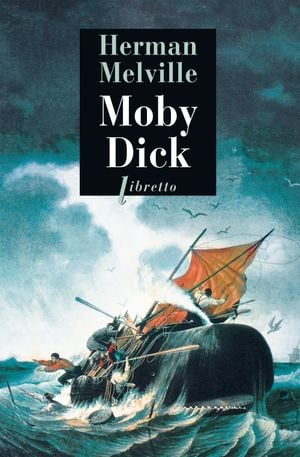Andromède frappée par les embruns, enchaînée aux flancs des falaises de Joppé, Jonas terrifié et coupable, fixant l’orage déchaîné, Pantagruel attendant de front le monstrueux physétère, Nemo cerné par une forêt de tentacules, Winslow Homer peignant le Gulf Stream, Geppetto à la dérive sur son radeau, Quint à l'affût sur l’Orca, ainsi s’étend indéfiniment la liste de ceux qui ont rivé leurs yeux à la surface liquide, ceux qui ont, anxieux, guetté les formes mouvantes sous le voile des eaux. Et si Achab est certainement le plus mémorable d’entre tous, c’est peut-être parce qu’en perdition, chassant jusqu’à l’agonie fantômes et chimères et façonnant dans sa peur la plus brutale des colères, il renvoie à tous le vague reflet familier de quelque condition taquine.
Comme dans tout mythe caressant l’inconnu, des bois tortueux du petit chaperon rouge à la pièce scellée de Barbe Bleue, il y a dans Moby-Dick un peu de cet enfant emmuré dans ses couvertures, n’offrant à l’air libre qu’un couple d’yeux écarquillés et une touffe de cheveux ébouriffés, ses doigts dessinant des angles aigus sur les coutures de son pyjama, s’entendant dire par une paire de parents bienveillants “Allez mon grand, maintenant il faut dormir, tu sais bien qu’il n’y a personne d’autre que toi dans cette chambre, bonne nuit.” et écoutant les pas de ses protecteurs et traîtres disparaître derrière la porte avec le dernier rai de lumière avant de n’avoir plus qu’un mur de ténèbres à fixer fiévreusement, là où chaque forme et chaque bruit devient une menace potentielle. Furieux, émerveillés, craintifs, rieurs ou bagarreurs, d’Ishmaël à Queequeg, de Starbuck à Tashtego, d’Achab au grand cétacé, tous sont une composante de cet enfant s’embarquant pour les rivages nocturnes. Certains s’embarquent pour vivre une aventure, un autre s’attache à payer sa dette d’honneur et un autre s’apprête au départ pour les confins du monde et jusque dans les enfers chasser sa chimère, et tous ont l’impuissance d’un gosse livré à lui même et à ses peurs profondes. Tous ont la stature d’un homme lancé dans une vie qui le surplombe et se devant, pour tenir en garde la folie, de s’offrir un but dans une baleine à conquérir.
Melville a beau peindre une facette entière de l’humanité, il n’en oublie pour autant jamais son rôle de conteur au coin de l’âtre, de ceux qui murmurent avec passion et amusement l’engouement de l’aventure et les mystères des terres inexplorées. Et c’est une virtuosité de suggestion et de modelage d’atmosphères qui sculpte les giboulées glacées de New-Bedford, la mer d’huile brillante du “brit”, la faune humaine abonnée aux bars nocturnes et aux églises obscures, des déambulations dans les ruelles givrées aux embardées du grand léviathan d’ivoire, le bouquin érige l’émerveillement à son plus beau rang. Un émerveillement ciselé dans l’attente, jusqu’aux limites du soutenable, du colossal titan blanc, conférant à l’animal de démesure toute cette aura surnaturelle propre aux êtres de légende et de rumeurs. Et j’aimerais bien défier quiconque aurait lu les premiers chapitres, découvrant un Ismaël fasciné par les lances placardées aux murs du Jet de la baleine, armes démentes forgées pour quelque improbable géant, planté là, comme Jack Driscoll le sera plus tard devant l’antique porte de l’Île du Crâne, je défierais bien quiconque disais-je, de résister à l’envie d’engloutir le reste de l’embarquée du Pequod avec l’avidité d’un gosse devant quelque conte merveilleux.
Bien des héros ont pris la mer pour aller trouver sur l’horizon des créatures fascinantes. L’un d’entre eux tenta d’ignorer les sirènes avant d’être bringuebalé de Charybde en Scylla, un autre, étrange pantin de bois, alla chercher son créateur jusque dans l’estomac - en taille assimilable à une cathédrale - d’un mégalodon, d’autres encore, marins accrochés aux rames de leur drakkar, durent faire face au serpent de mer et au grouillant kraken, mais rare sont ceux qui arrivèrent à la portée symbolique d’Achab et à la puissance destructrice du chapitre final de Moby-Dick.