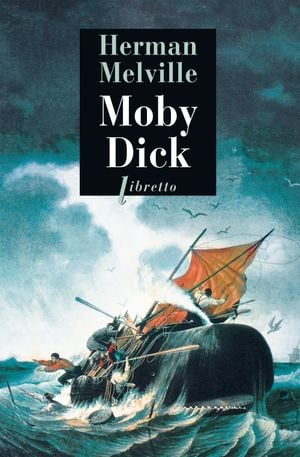Cela faisait des années que je m'étais promis de lire Moby Dick, dont je connaissais ce que connaît tout le monde, mais rien de plus.
Le thème m'interpelait vivement. Le sombre capitaine Achab, assoiffé de vengeance... L'insaisissable Moby Dick... Le duel entre l'homme et la nature... Entre l'homme et Dieu...
La longueur du roman, plus conséquente que celle du Dr Jeckyll et Mr Hyde, autre classique enfin lu cette année, me réjouit car elle annonçait un plaisir durable.
Les premiers chapitres me le confirmèrent et je ne boudai d'abord pas mon plaisir. Le personnage de Queequeg me prit par surprise en posant une thématique chère à mon cœur: celle de la rencontre entre l'homme civilisé et le sauvage. Tout cela promettait et je me frottai mentalement les mains de plaisir.
Mais tout se gâta lorsque je fus embarqué à bord du Péquod et que la côte fut trop éloignée pour envisager de rentrer à la nage. Ishmaël (ou Melville, c'est difficile à dire) fit tout pour me rappeler que j'étais un terrien et que nous avions des intérêts pour le moins divergents.
Alors que je ne rêvais que d'aventures maritimes hautes en couleur, on me servit, pages après pages, un tout autre repas. J'avalais les premières digressions en hôte soucieux de ne pas froisser qui l'héberge à mille lieues de toute humanité. Certaines attisèrent mon intérêt, d'autres le douchèrent. Mais je compris bientôt que des sept cent trente et une pages, seule une centaine, dans le meilleur des cas! se rapporterait à la chasse du Péquod proprement dite.
J'en vins à guetter les navires de passage, accalmies bienvenues dans le maelström d'informations dont Ishmaël m'abreuvait, avec lequel il m'abrutissait, dont le flot ininterrompu me laissait à demi-noyé.
Entendons-nous: d'ordinaire, je n'ai rien contre un peu d'érudition sur des sujets improbables, même si ce que l'on m'apprend est d'ores et déjà périmé. Je n'aspirais qu'à faire écho à Térence et clamer avec lui: Homo sum, humani nihil a me alienum puto. Melville me démontra que c'était du flanc. Je n'étais qu'un menteur ou, au mieux, j'avais largement exagéré. Il me faudrait désormais inscrire comme codicille: nihil (praeter multas balaenarum artes) a me alienum puto. De la baleine, j'en avais déjeuné, j'en avais dîné, j'en avais soupé, soupé et resoupé. Plus de phrénologie du cachalot pour moi. Plus de mesure au pouce près (ou presque) des côtes du grand léviathan. Plus d'inventaire des cales des baleiniers hollandais. Plus de Saint Georges à dos d'hippocampe, improbable patron des baleiniers. Plus de réduction du droit britannique au poisson perdu/trouvé nantucket. J'en avais ma claque.
Lorsque Moby Dick montra enfin le bout de son évent (page six cent nonante-quatre), je suivis la chasse d'un œil éteint. Le naufrage et l'abrupt épilogue ne me soulagèrent même pas.
De cet ouvrage, je saluerai tout de même le commencement, et quelques passages remarquables (la rencontre avec Queequeg, l'exégèse de Jonas et la baleine par le Père Mapple, le sermon aux requins, la supplique de la Rachel).
Mais de cet ouvrage, je dirai ce que jamais, au grand jamais je n'aurai cru devoir dire d'un livre, à plus forte raison d'un monument de la littérature:
"Moby Dick? C'est triste à dire, mais j'ai préféré le flash game au livre."
http://armorgames.com/play/7199/moby-dick-the-video-game