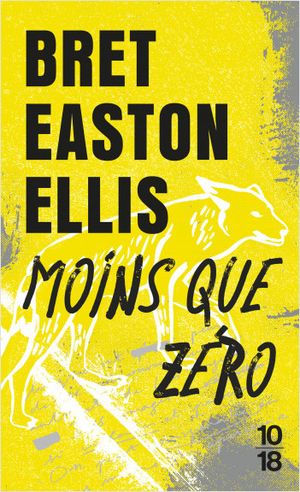Flaubert ne regardait pas assez M.T.V. C’est pourquoi il a écrit des livres sur plein de choses, mais pas sur rien. En 1852, le pauvre écrivait pourtant à Louise Colet : « Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c’est un livre sur rien ». Raté. Au lieu du rien, il s’est retrouvé avec une tripotée d’Emma Bovary et de Salammbô sur les bras. Voilà ce qui arrive quand on n’habite pas à Mulholland, qu'on ne consomme pas assez de Valium (le père de Flaubert était médecin, Gustave aurait pu faire un petit effort) et qu'on ne porte pas assez de t-shirts Hard Rock Café : on n’y connait rien au rien, on est incapable d'écrire un roman qui pourrait tenir en l’air comme la planète Terre, sans être soutenu par rien, par aucun sujet, aucun prétexte. Un roman qui tiendrait seulement par la « force interne de son style » nous dit Flaubert.
Mais Bret Easton Ellis, lui, en 1985, a réussi à l’écrire, ce roman sur rien. Et même sur le moins que rien. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais quelque chose me dit que l’important, pour en arriver là, c’est de beaucoup regarder M.T.V et surtout, surtout, de faire ça en coupant le son. C’est essentiel. Regarder une chaîne TV musicale sans couper le son, c’est prendre le risque d’entendre quelque chose et Clay, le héros de Moins que zéro, ne se fait pas avoir.
Pourquoi les gens n’aiment pas qu’on leur raconte la fin d’un livre ? Moi, au contraire, ça me débarrasse. Quand je connais la fin, je peux enfin lire tranquille, libéré du suspense, de la conclusion, de la morale – de toutes ces choses qui me font suer. C’est pareil quand je passe un après-midi à Grenade, au pied de l’Alhambra, à manger des glaces chez « Los Italianos »(1), je n’ai aucune envie de passer mon temps à me demander ce que je vais manger le soir. Et si on m'annonce : « A la fin de la journée, je te préviens, tu vas manger une omelette aux champignons », ça ne change pas tellement le goût de ma glace au citron ; pas du tout.
Ceci dit, avec Moins que zéro, je n’ai pas eu ce problème. Quand j’ai découvert la première phrase : « People are afraid to merge on freeways in Los Angeles »(2), j’ai compris que je n’aurais pas besoin de me demander si Mme Duchemol avait été assassinée par le Colonel Moutarde avec le chandelier.
Au fond, il est rigoureusement impossible de spoiler ce court roman. Même le pitcher, c’est pas simple. C’est l’histoire de jeunes riches qui ne font rien. Parfois au bord d’une piscine, mais pas forcément. Et à force de rien faire, ben rien, il ne se passe rien non plus.
Flaubert, encore lui, a dit une chose comme « le plus bête, c’est de conclure » (3). C’est un autre point commun entre lui et Bret Easton Ellis. Le début, on s’en fout ; la fin, on s’en contrefout. C’est le milieu qui compte. Voilà. C’est ça un bon roman : un milieu. Une plongée dans un milieu, une société, une époque, une façon de vivre ; bref, c’est Henry James, Zola, Gogol, c’est Moins que zéro. Welcome to Los Angeles.
C’est bien joli tout ça, mais dans le fond, et à la surface aussi, c’est pas un peu creux un livre sur rien ? Et bien, figurez-vous que ce serait plutôt le contraire. Il ne doit pas se passer une semaine sans que je pense à ce petit roman d’Ellis que j’ai lu à l’âge de 17 ans – quand j’étais encore un minimum sérieux. Il m’avait tellement terrorisé que je l’avais offert à ma copine : j’espérais sans doute qu’elle partagerait ma peine. Et je me souviens très bien de ce qu’elle m’avait dit, à mi-chemin, à la page 101 mettons : « C’est horriiiiiiiible ». Ensuite, elle avait pleuré, pleuré, pleuré...
Qu’est-ce qui la faisait pleurer à ce point ? Qu’y a-t-il de si horriiiiiible dans ce petit roman à part des jeunes gens qui écoutent M.T.V. sans le son ? Rien. Mais c’est tout le problème. Car ces jeunes gens ont l’air terriblement vrais, plus vrais que n’importe quel héros à la vie hautement romanesque. Clay et ses potes nous forcent à regarder ce dont la nature a horreur : le vide. Et pour une fois, ce n’est pas ce que les personnages se disent qu’on entend, c’est l’espace entre les mots. Et ce n’est pas les étoiles qu’on voit, c’est tout ce qu’il y a autour. Clay et ses potes ont l’air d’autistes qui flottent dans un gaz indéterminé, mais ils n’ont pas l’air bizarres, ou étranges, ou californiens pour autant. Pas du tout. En fait, ils ont l’air tout à fait comme toi, comme moi, comme beaucoup de gens, comme nous. Nous : les hommes et les femmes nés après 1945 dans un lieu qu’on appellera l’Occident. Et c’est cela qui fait peur. Et c’est cela qui donne le vertige. Tout ce vide. Ce grand vide dans lequel, au fond, on pourrait entrevoir une envie de plonger. Un doute. Une faille dans notre volonté d'exister.
(1) Je n’invente rien. Le meilleur glacier de la plus belle ville d’Andalousie s’appelle « Los Italianos » ; Calle Gran Vía de Colón, 4.
(2) « Les gens ont peur de se retrouver sur les autoroutes de Los Angeles ». Less than zero est si bien traduit qu’il n’y avait pas 36 000 possibilités. Seul un magnifique, irréprochable, immense traducteur pouvait avoir fait ça… Vous avez bien sûr reconnu THE Brice Matthieussent (Christian Bourgois Editeur puis, pour le format poche, Editions 10/18).
(3) La citation exacte est : « L’ineptie consiste à vouloir conclure », lettre à Louis Bouilhet du 4 septembre 1850.