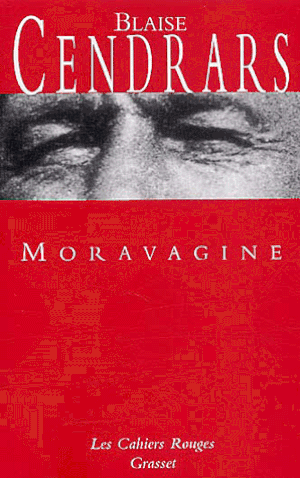Il y a quelque chose de doucement candide à Moravagine. Une qualité décidément étrange quand on pense à son personnage éponyme, roue libre de destruction, de cynisme et de cruauté. Et pourtant, c´est une impression qui s´incruste et persiste, s´ancre en nous malgré nous, comme on peut être frappé par la réalisation, après avoir discuté avec un affreux criminel, qu´il a le coeur bon. Moravagine est infect, sinistre et sans scrupule. Moravagine est aussi naïf, doucement, sournoisement ; son histoire est racontée dans un roman d´aventures, par un narrateur qui abandonne rapidement son style froid, médical, analytique, lorsqu´il rencontre son patient, Moravagine. D´un narrateur quasi-externe, on glisse insensiblement à un narrateur puissamment interne, comme une grosse loupe qu´on approche du texte et des personnages, qu´on enfonce dans leurs corps et dans leurs têtes, jusqu´à, parfois, ne retenir qu´une bouillie de narration, saturée par l´aventure, saturée par la vie.
Cendrars aussi a l´air de s´amuser comme un jeune écrivain (qu´il n´était plus tout à fait, en tout cas dans la mesure où Moravagine est sa quinzième publication), en truffant le récit de véritables morceaux de bravoure, comme pour satisfaire sa propre virtuosité narrative. On ne peut pas lui en vouloir. On se goinfre de son écriture comme de sachets de sucreries: le style est toujours touffu, abondant, parfois presque étouffant. Il s´élève bruyamment à la hauteur des gestes grandioses de ses personnages, de leur démesure et de leur folie. Le véritable poison de Moravagine, celui qui suinte du récit tout entier, c´est cette candeur bizarre, abjecte qui, en dépit des horreurs qu´elle sème et récolte, nous impose une soif desséchante d´aventures.