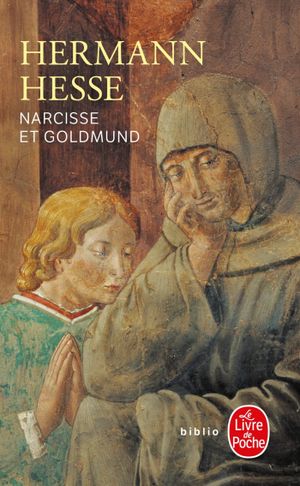Dans un style d’une richesse fabuleuse, rarement lourd ou éprouvant, Hermann Hesse déroule l’épopée à l’échelle humaine du jeune Goldmund, éveillé sur le sens de son existence par Narcisse, en passe quant à lui de prendre les vœux. La prouesse de l’auteur allemand, que j’ai découvert par ce livre, est cette tendance permanente à la nuance, à introduire de partout de la dualité, de l’opposition, sans toutefois jamais céder au manichéisme.
On pourra certes arguer que du point de vue de la fidélité historique, l’univers médiéval que Hesse décrit est à bien des égards irréaliste. Mais on oublie facilement ce point tant la saveur d’un récit méticuleusement tissé prend le pas sur le reste. Même serait-on tenté de l’interpréter comme un manifeste pour ce que cette Germanie du Saint-Empire avait d’attrayant dans ce Moyen Âge semi-idéalisé : régime fédératif de princes et d’archevêques, régi par des lois permettant la plupart du temps une paix perpétuelle en son sein, et dont Hesse, enfant du siècle des guerres globales dût se montrer nostalgique. On peut le savoir gré de ne pas pétrir l’intrigue de Goldmund d’un proto-protestantisme qui eût été indigeste et déplacé, mais plutôt d’orienter celle-ci dans le sens d’une opposition – très à la mode à l’époque de la rédaction du livre – entre l’apollonien et le dionysiaque.
Fort heureusement le roman ne prend là non plus jamais la tournure d’un traité philosophique, et c’est avec une grande délicatesse et un crescendo bien amené que l’auteur parvient à poser les bases chancelantes de cette dualité intrinsèque à la nature humaine, sans néanmoins abandonner l’idée plotinienne de la possible réconciliation entre les antagonismes par un travail introspectif et empirique poussé en chacun.
La parenté avec un certain pan de la philosophie rousseauiste, remarquée par l’un des membres de ce site, montre qu’il affleure à travers ce roman une conception multimodale de ce qu’une vie humaine libre se peut être (et c’est sans doute là la plus grande qualité de l’ouvrage).
Les quelques reproches que l’on peut faire à Narcisse et Goldmund est justement l’absence un peu trop notable de Narcisse, ainsi qu’une conclusion un tantinet décevante.
Lu en français dans la traduction de Fernand Delmas.