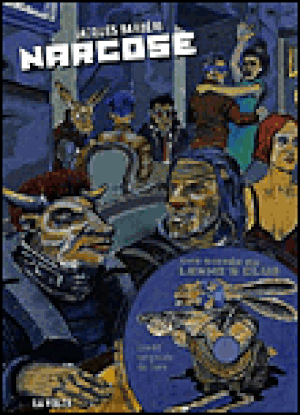La Volte, petite maison d’édition qui nous a habitué ces dernières années à des ouvrages très peu consensuels, s’illustre une nouvelle fois dans le hors norme. Vous aimez lire des textes bizarres et faire des expériences textuelles étranges ? Vous appréciez la démesure, les intrigues qui semblent totalement en roue libre et demeurent pourtant paradoxalement maîtrisées et cohérentes de bout en bout ? Vous allez être comblé avec Jacques Barbéri. Deux de ses ouvrages sont publiés conjointement : un recueil de vingt-et-une nouvelles, L’homme qui parlait aux araignées, et la réédition augmentée de son roman Narcose. Deux raisons d’effectuer sans retenue un plongeon au cœur de l’imaginaire obsessionnel et organique de l’auteur français.
Le monstre dort. Il a la taille d’un chaton, mais lorsqu’il déplie
ses pattes et qu’il se redresse, il ressemble à un bébé girafe, le cou
en moins et quelques pattes en plus. Il a un poil cendré, magnifique,
et des yeux en diamant noir plantés tout autour de son crâne,
observatoire circulaire que rien ne peut tromper. Son abdomen a la
taille d’un œuf d’autruche. Ses chélicères sont comme des canines de
tigre, longues et incurvées. Il s’appelle Aniel et Anton Orosco trouve
que ce nom évoque bien toute la puissance carnassière qu’il dégage.
Anton Orosco est un promoteur véreux plutôt malchanceux. Suite à une escroquerie ratée, le bougre est contraint d’abandonner le confort de son appartement et les attentions sensuelles de sa maîtresse Lysandra pour fuir dans l’extrados, la zone interlope où vivent les marginaux de la ville-sphère Narcose. Fendant la foule bigarrée et abrutie qui erre perpétuellement dans les allées du quartier Citron Vert, il file directement au Jungle Beer, le quartier général de Lion, un trafiquant notoire de corps.
Des compressions/expansions de membres, globes oculaires, viscères, décorent harmonieusement la pièce. Lion est langoureusement
étalé sur une haie de plastiboudins. Des métabêtes à têtes de chèvre
lui lèchent les paupières et les oreilles. Lion n’a de lion que la
tête. Une plastitête d’une valeur inestimable. Les derniers
recensements animaliers ne font plus état que de deux cent cinquante
lions en liberté, dont deux cents déjà réduits à l’état de
plastiorganes. Et la tête de lion de Lion est toujours sillonnée par
quelques traces volontairement oubliées, empreintes jaune feu de la
savane. Les gestes de Lion sont sauvages, et ses mains ont des griffes
; lorsqu’il mord ses hybrides, on peut même dire qu’il est féroce. Ses
femelles, aux organes sexuels sélectionnés avec amour, ont une tête de
vautour greffé au-dessus de leur pubis. Et ces têtes sont vivantes.
Lorsqu’il propose à un serviteur réjoui de faire l’amour à l’une
d’elles, le malheureux a la triste surprise de voir son pénis dévoré à
grands coups de becs dilacérateurs. Les testicules sont un dessert de
choix.
En échange de ses ultimes liquidités, Lion veut bien rendre service à Anton. Rassuré, Anton switche à travers la membrane d’entrée du bar. Le lendemain, il sera mort. Il ne lui reste plus qu’à dégueuler les litres d’amphécafé qu’il a avalé et à reprendre un verre de Scotch-benzédrine pour chasser ce mauvais goût qu’il a en bouche. Est-il pour autant au bout de ses peines ? Rien n’est moins sûr puisqu’une question reste en suspens. Quand sera-t-il assassiné et de quelle façon ? Et puis, n’oublions-pas qu’il ne faut pas vendre la peau du lapin avant de l’avoir tué.
Lire Jacques Barbéri, c’est un peu comme lire du Lewis carroll qui aurait infusé dans un bain de physique quantique – ou du Serge Brussolo, mais avec une once supplémentaire d’intelligence. On pénètre dans un univers d’une dinguerie finalement très rigoureuse, où drame, humour et cauchemar sont intimement intriqués. Et de la même manière qu’il s’approprie les codes et les archétypes de la S-F, Jacques Barbéri fait sienne la logique quantique pour en développer tout le potentiel poétique.
Univers gigognes, rêves enchâssés dans la réalité ou réalité encapsulée dans le rêve, on n’est jamais très loin non plus des mondes truqués de Philip K. Dick. Mais les mondes de Jacques Barbéri sont autrement plus vertigineux, si on peut me permettre ce sacrilège. Leur réalité prête à caution car elle est augmentée par le virtuel ou altérée par les drogues, voire par les deux à la fois. Le narrateur/observateur est exposé au principe d’incertitude auquel il ne peut espérer échapper que par la fuite dans un univers plus paisible ou par un oubli adouci au scotch-benzédrine.
Lolitrans, plastiorganes, psychomachines, métabêtes… sont autant de trouvailles langagières, de mots-valises, de jeux de mots qui donnent corps aux obsessions organiques de l’auteur, aux mutations chitineuses, aux copulations sémantiques et autres chimères dignes des visions cauchemardesques d’un Jérôme Bosch mais scénarisées par Tex Avery. Le foisonnement de ces obsessions et le tempo hypnotique de l’écriture portent le récit dans une démesure réjouissante qui nous fait scander : encore ! Cela tombe bien car Narcose est le premier volume d’une trilogie.
En attendant la suite, il n’est pas inutile de répéter que lire Jacques Barbéri, c’est être convié à un voyage textuel hallucinant dont on redescend fiévreux et transfiguré. Une expérience que l’on se doit de recommander.
Source