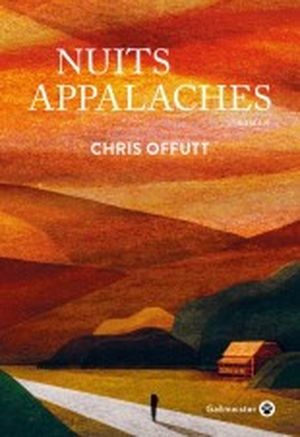Chronique vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=VtWuseJCxE4
De quoi ça parle ? Tucker, vétéran de la guerre de Corée compte survivre dans la nature loin des hommes. Mais un jour, alors qu’il se prépare tranquillement un ragout de serpent ou d’écureuil dans une carapace de tortue, il va interrompre une tentative de viol, celle de la jeune Rhonda par son oncle. Et c’est ainsi que s’amorce leur histoire.
On me l’a proposé sous la vidéo de My absolute darling, le roman de Gabriel Tallent que j’ai adoré, et je vois le rapport entre les deux. Malheureusement, je trouve que Nuits Appalaches représente ce qu’aurait été My Absolute Darling si Gabriel Tallent n’y avait pas passé 8 ans. Il est un peu à l’état d’ébauche, comme un roman qui n’aurait pas encore été terminé : les personnages sont des croquis archétypaux, la nature ne sert pas autant l’histoire qu’elle le devrait, et en général, Chris Offut ne fait pas assez confiance à son lecteur, il ne laisse pas assez de place à son imagination ou à son intelligence.
Le roman s’inscrit dans le genre du « nature writing », un genre américain que j’affectionne habituellement. C’est un genre littéraire qui remonte à Henry David Thoreau, et dans lequel les grands espaces jouent un rôle important, si ce n’est le rôle principal. Henry David Thoreau a écrit en 1854 Walden ou la vie dans les bois, un récit autobiographique qui détaille son séjour pendant 2 ans dans une cabane près d’un étang. Il s’agit souvent de textes poétiques, de textes qui s’inquiètent de l’environnement, et qui ont aussi parfois une portée décoloniale — avec le génocide des amérindiens en toile de fond. Comme récits emblématiques du « nature writing », on trouve Danse avec les loups, Le dernier des Mohicans, L’appel de la forêt, Légendes d’automne, ou plus récemment, avec une variante féministe des textes comme My absolute darling dont je parlais, ou même le Fémina de cette année. Des textes donc assez différents, qui peuvent même avoir des animaux comme personnages principaux. Et ce que l’on peut trouver de commun à tous ces romans, c’est la solitude des personnages. Isolé de leurs congénères et face aux dangers mais aussi à la beauté de la nature, le protagoniste doit se concentrer sur ses sensations, sur son animalité ou son ingéniosité pour survivre. C’est pour cela que ces récits interrogent l’homme en nous, notre fragilité, face à un monde dans lequel nous sommes fondamentalement étrangers.
Ce sont donc des auteurs qui remettent l’homme à sa juste place, lui qui n’est en fin de compte qu’un minuscule rouage dans la grande machine étrange qu’est le monde. Et cette humilité de l’homme, du little big man, c’est paradoxalement ce que l’on ne retrouve pas du tout dans le texte. D’abord, parce que la nature ne semble pas réellement intéresser Chris Offut.
En effet, l’écriture de la nature est laborieuse, on a vraiment l’impression que l’auteur a ouvert un almanach pour caser le plus de plantes possibles. Alors que les descriptions chez Tallent étaient très travaillées, une nature vénéneuse, dangereuse, qui servait de décor à un quotidien encore plus vénéneux et dangereux, ici, j’ai un sentiment d’artificialité. De nature reconstituée par l’écriture (une nature encyclopédique retranscrite, qui passe de livre en livre sans passer par le réel). Et ceci afin d’offrir un paysage d’abondance, un paysage qui comme le jardin d’Eden se plie à tous les désirs de l’homme, et en l’occurrence de Tucker.
« Il récupéra l’écureuil et quitta la forêt pour un pré, ramassant au passage du lamier et des pissenlits. Il chercha les feuilles pliées de l’oxalis et en déterra quatorze racines tubéreuses. Il fut attiré par les effluves aillés d’une touffe de poireaux sauvages. »
C’est difficile à croire, le fait qu’il se fasse une petite salade composée avec chaque ingrédient qui se trouve miraculeusement à sa portée. Mais ce n’est pas ce qui dérange le plus, le problème, et ce qu’on sent assez vite, c’est que ce n’est pas la nature qui intéresse Offut. Elle sert certes de refuge face à cette humanité qui a détruit une partie de Tucker, mais ce n’est que temporaire, que le temps de le faire vadrouiller vers d’autres aventures. Et c’est aussi le cas de Rhonda ou de leur famille, tout dans ce livre n’est qu’un moyen de mettre en scène l’héroïsme ou le courage de Tucker, et cela d’une manière assez puérile.
Masculinité puérile
Pourtant, j’étais bien partie, l’ouverture avec Tucker en autostoppeur le place dans la lignée d’un Tom Joad chez Steinbeck. Il n’y a pas trop de marqueurs, sauf ce vagabondage et les souvenirs. Mais dès le début, Tucker manque de complexité, il est trop gentil « Le moindre cent qu’il gagnait enfant, il le donnait à sa mère pour acheter à manger. » Vétéran souffrant de stress post-traumatique, s’excluant du monde des hommes qui l’a trop fait souffrir, il est taiseux, reprenant le trope du lonesome cowboy.
Celui d’un aventurier, du bon américain qui revient de la guerre, qui sauve la veuve et l’orphelin, qui représente la puissance masculine. Un cavalier solitaire au passé obscur. Ce qui n’aurait pas posé de problème dans un western des années 30 à 50 me donne la fâcheuse impression qu’il n’y a pas eu de réalisateurs comme John Ford ou Arthur Penn pour remettre en question cette imaginaire.
Et pire encore, on mélange ça à des représentations actuelles de super-héros, je pense aux combats à mains nues, où l’on prend tout ce qui se fait d’exagéré dans la virilité, de peu concret, où les coups n’ont aucune valeur à cause de leur accumulation, dans des scènes de combats hyperboliques « Jimmy se plia en deux. Son dos rebondit contre la voiture et il tomba à genoux. Il reprit son souffle, juste assez pour vomir ses œufs du matin sur le sol ». Dans le livre, c’est la deuxième fois qu’un mec vomit après avoir reçu un coup de Tucker. C’est une virilité exacerbée à la Batman, qui permet pas trop au lecteur de s’identifier.
Et comme je le disais, il y a quelque chose d’un peu puéril dans la caractérisation du héros, qui arrive toujours pile au bon moment pour venir en aide aux femmes, se tirer d’une situation dangereuse, et avec la bonne réplique en bouche « — Alors, dit Tucker, on a envie de danser ? ». J’imagine Chris Offut comme un gamin avec ses Action Man, je trouve qu’on a passé des décennies à complexifier la figure du héros, et que ce roman, c’est un gros retour en arrière.
Parfois, ça fait même parodie de western, on se croirait dans le Grand détournement. Et sans que ce soit voulu, ceci à cause de cette hypermasculinité. La description des méchants ressemblent à des costumes steam punk de jeux vidéo,
« Une paire de lunettes grossissantes spécialement conçues pour le travail de précision était relevée sur son crâne dégarni »
Ils n’existent pas, ils sont juste un moyen d’exacerber les pulsions de violence de l’auteur, pulsions qui traverse tout auteur, mais qu’on supprime en général — des scènes que j’inscrirais dans une toute-puissance infantile. On est dans un jeu vidéo ou rien n’a d’impact rien n’a d’importance puisqu’on part du postulat que tous les personnages sauf Tucker peuvent mourir. Comme le personnage joué dans GTA, il peut faire tout ce qui passe par la tête de l’auteur — dans la limite de la cohérence du monde crée.
Même la paternité est virile dans le bouquin. On a des scènes resucées du père qui bricole avec son fils, et lui dit de bien s’occuper de la maison :
« — Je suis pas encore un homme.
— Non, mais tu vas le devenir. »
Tucker est l’homme de la situation, mais aussi l’homme de la maison, celui qui règle tous les problèmes, sur qui tout repose.
« —Je vais aller voir, dit Tucker. Je suis là maintenant. Je vais prendre les choses en main. »
Rhonda, son épouse, est même adulte très infantilisée. Si lui c’est le lonesome cowboy, elle, elle reprend le trope de la demoiselle en détresse. Alors que la Turtle de Tallent était tout sauf une demoiselle en détresse, Rhonda est très passive. On assiste encore à une description naïve de l’adolescence féminine « Rhonda inspira profondément et battit des cils avec la grâce d’un papillon. »
Mais surtout, si elle parait avoir des émotions, ce sont des pensées rudimentaires, des formulations d’enfant de 4 ans. Quand Tucker va sortir de prison, « Elle espérait que tout fonctionnait encore correctement, que le devant de son derrière ne s’était pas asséché. »
C’est la femme comme le concevait justement les années 30-50 mentionnées plus tôt : une femme passive, dépendante, qui n’a aucune conscience d’elle-même, de ses désirs ou même de son corps.
De l’importance de faire confiance au lecteur
Chris Offut est trop centré sur la gestuelle de ses personnages dans ses descriptions, ce qui enlève de la fluidité, une vue d’ensemble et globale de la scène « Tucker le frappa trois fois à la tête, son bras s’activant comme un piston. L’homme tituba en arrière, et la fille courut à la voiture. L’homme leva les bras […]. » Je trouve que c’est bien de trancher avec les échelles dans ce genre de scènes. Le combat, on va dire que c’est le centre de la scène, la forêt autour, c’est la vue d’ensemble. On peut dézoomer pour montrer ce que font les oiseaux par exemple, est-ce qu’ils s’envolent de peur, est-ce qu’au contraire ils continuent comme si de rien n’était face à la violence des hommes, comme une nature immuable. Puis au contraire, on peut zoomer encore plus et aller dans la tête de Tucker à ce moment-là, ou de la jeune fille, est-ce qu’ils ont peur, comment ils respirent, ce qu’ils voient, est-ce que le soleil se pose de telle manière sur le visage de l’assaillant. Bref, beaucoup de solutions pour en faire une scène pas unidimensionnelle, mais lui ajouter des couches de réalisme, ce qui constitue la vie en fait, par ce fameux jeu d’échelle.
Parfois Chris Offut explicite trop. Par exemple, il est dans le tact, dans la suggestion quand la jeune fille sauvée pince les lèvres quand elle croit apprendre que Tucker est marié. On comprend qu’il lui plait, c’est sous-entendu, mais pas dit, c’est littéraire quoi. Sauf qu’il se sent obligé quelques lignes plus loin d’expliciter « Sa colère augmentait à chaque seconde. Surtout, elle en voulait au soldat d’être marié. »
Vers la moitié du roman, on quitte le genre du nature writing pour se concentrer sur la famille que Tucker a crée avec Rhonda. C’est ennuyeux et frustrant, parce qu’il amène le roman sur ces rives-là, avec le handicap des enfants, mais n’en fait pas grand-chose. On n’en saura pas plus, alors que je trouvais que c’était une bonne idée, que ça mettait du sang neuf dans le récit. On a l’impression que c’est uniquement pour ajouter du drame, un décor dramatique dans la vie de Tucker et le peindre en héros — comme l’oncle mort de Spider-man, où les parents de Batman. Justement, le lecteur, quand il tombe sur cette sorte de malédiction — puisque le couple a eu plusieurs enfants lourdement handicapés — il est avide d’en savoir plus. Ça titille un part sombre de nous, un côté voyeur, ce qui amenait les gens dans les freakshow au 20ème siècle. Mais si c’est titiller pour titiller, ça sert à rien. Car la difformité, ou plus généralement la monstruosité, puisque c’est le terme employé dans les œuvres littéraires ou cinématographiques, c’est passionnant. Ça amène toujours plus ou moins vers ces questions : Qu’est-ce qui fait notre humanité ? Qui sont les vrais monstres ? Questions magnifiquement soulevées dans des livres comme Notre dame de Paris ou des films comme Freaks ou Elephant Man. Ici, elle ne sert strictement à rien — les enfants sont enlevés à la mère quand Tucker est en prison, on ne sait pas pourquoi ils n’arrivent pas à avoir des enfants qui ne sont pas handicapés, et puis un jour, ils en ont — et c’est comme si ça effaçait la malédiction. Les autres enfants sont en institution, mais c’est pas grave parce que le petit Shiny va bien. C’est n’importe quoi. C’est comme pour le cas de Rhonda, ne se servir de ses personnages que pour mettre en valeur Tucker, pour lui ajouter du background, comme dans un comics.
Les antagonistes sont manichéens, parce que le lecteur ne supporterait pas l’ambiguïté, visiblement. Ainsi parle le patron de l’assistante sociale de la famille, patron qui par la suite tentera de l’agresser sexuellement : « Une maison pleine de bêtes de foire. J’avais peur de tomber sur une femme à barbe et un garçon alligator en ouvrant une porte. ». On ne peut que ressentir des émotions primaires, avec des antagonismes simples, lisibles immédiatement. Tucker en sauveur de la veuve, de l’orphelin, et de la travailleuse sociale ennuyée par un patron Weinsteinisant.
Et même le texte aide trop le lecteur, il montre et souligne ce qui va servir le récit plus tard, comme s’il pensait qu’on souffrait d’amnésie « Tucker réalisa que le gamin éprouvait du ressentiment envers son oncle et il mit cette information dans un coin de sa tête. » Et donc plus loin dans le livre « C’était le moment d’utilise ce trait contre lui en plus du ressentiment qu’il avait déjà remarqué en sortant de la prison » On dirait une note à lui-même, c’est le genre de choses qu’il faut supprimer du texte à la fin. Je veux dire, c’est comme si dans Anna Karénine, Tolstoi nous disait dans la scène où elle rencontre Wronsky à la gare — t’as vu, elle est pas trop à l’aise, on va le garder dans un coin de notre tête, hein, parce que les trains, ça pourrait être dangereux.
Et ce manque de confiance dans la compréhension du lecteur, elle s’immisce jusque dans la phrase, avec un manque cruel de pronom, et l’abondance de prénoms, pour que surtout, on ne perde pas le fil « Tucker aida Jimmy à se relever et ils partirent en laissant la crète derrière eux. Il ramassa le chapeau de Jimmy, l’épousseta et le lui remit sur la tête. Ils avançaient lentement, Jimmy forçant sur une jambe, manquant d’équilibre avec son bras en écharpe. Tucker avait leurs deux armes. Il marchait derrière Jimmy. »
Bon, et l’épilogue ressemble encore à des notes, ou au fameux écran de fin dans un film où on explique ce que sont devenus les personnages. Pour moi, c’est l’antilittérature ce genre d’épilogue. C’est nier le rôle de la clôture d’un roman : celle de faire une passerelle entre le réel et la fiction, entre l’imagination de l’auteur et celle du lecteur : une sorte de « à toi de jouer maintenant, à toi d’imaginer la suite. » Non, là il faut à tout prix tout expliquer, tout refermer. Empêcher toute autonomie du lecteur.