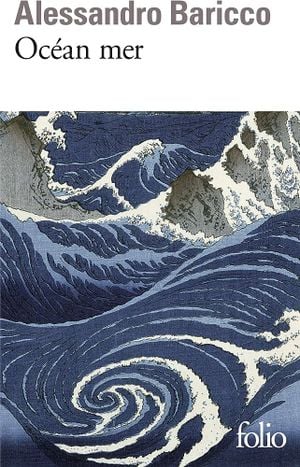Un matin de fin du monde. Le ciel bas, empesé de nuages, recouvre la ville de son manteau couleur myosotis noyé d'améthyste. C'est une aube rimbaldienne, poétique, dangereuse et saisissante. L'esprit encore ensommeillé se prépare à affronter l'assaut tentaculaire de la vie urbaine: moteurs vrombissants, musique tonitruante s'échappant d'écouteurs dont la forme rappelle parfois la structure de certains coquillages, valse des corps dans les rames du métro qui tourne parfois à la mêlée.
Les paupières se ferment, le silence revient, et apparaît alors l'immense Océan Mer.
Voici Plasson devant son chevalet, fixant la mer avec intensité pour en faire le portrait. Mais elle est insaisissable, changeante, joueuse et entêtée. Elle ne peut être représentée avec des pigments, elle ne peut être définie avec des mots. Cela est un bien grand mal pour Bartlebloom qui tente tant bien que mal de terminer la rédaction de l'entrée "mer" de son Encyclopédie des limites. Elle rit, la mer à cette idée car elle n'a pas de limites. L'étreinte de deux corps dans la nuit du monde, c'est encore l'Océan Mer. Deux âmes qui se noient et qui se raccrochent l'une à l'autre pour ne pas disparaître dans les profondeurs du monde. L'une se nomme Elisewin, fragile et forte comme une rose dans les frimas; l'autre se fait appeler Adams (ou Thomas) aussi violent, impétueux et inconstant que le vent.
Oui, elle rit la mer.
Ann Dévéria sait cela mieux que personne. Combien les vagues du désir peuvent vous porter loin des rivages de votre existence, jusqu'à vous briser par grande tempête. Mille bateaux jetés à la mer ne suffiraient pas à porter secours à cet être qui a goûté aux charmes du voyage ("intérieur le voyage, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref", précise l'ami de Bartlebloom), celui on l'on se rencontre soi-même comme Ulysse dans l'Odyssée (précisons qu'une fois encore, nous voilà confrontés à l'insaisissable Océan Mer). La beauté lunaire de la jeune femme, son charme foudroyant ont ensorcelé bien des hommes, mais Ann Dévéria n'a chaviré que pour un seul d'entre eux, un médecin-marin d'eaux troubles aux mains si douces et aux lèvres si tièdes qu'elle en perd le cap. Pour elle, point de cercueil étroit mais l'étreinte de l'eau enveloppant son corps et son âme comme un linceul liquide.
Le père Pluche a songé à écrire une prière pour toutes ces âmes, mais il appert après mûre réflexion, qu'il est lui-même particulièrement ébranlé dans ses convictions. Il regarde le ciel, puis la mer, depuis la fenêtre de la pension Almayer située entre ces deux mondes, et il est chamboulé. C'est qu'elle murmure la mer. Elle chante et conte des histoires pour Dira, Dood, et les autres enfants de la pension ; elle revêt ses plus beaux atours pour le portraitiste longtemps aveugle aux vérités du monde. Et elle reflète la voûte céleste comme pour nous rapprocher de Dieu. Alors le père Pluche tente sa chance et admoneste le Seigneur, véritable coup de tonnerre dans un verre de lait.
Alessandro Baricco bouscule les limites du roman et nous offre une oeuvre qui oscille entre le conte initiatique, le théâtre et le roman. L'ensemble déborde de poésie et est construit comme une symphonie. L'écriture est soumise à un rythme changeant, de l'allegro moderato à l'andante, comme pour faire écho au mouvement des vagues qui viennent caresser la surface du sable avant de refluer vers cette envoûtante immensité bleue qu'est l'Océan Mer. Une leçon édifiante sur l'être humain, sur ses peurs et ses désirs, ses espoirs et ses doutes et sur son incroyable capacité à rêver.
Un miracle.