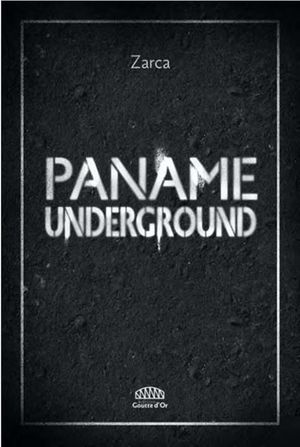Un livre à la fois facile et difficile d’accès. Facile, parce que sa narration est fluide, parfois trop fluide, voire simplette. Difficile, pour ce qu’il raconte, ce qu’il montre, la face B sordide et dégueulasse de ce qui n’est finalement pas tant la ville-lumière que ça. Facile et difficile à cause son langage, pour l’argot parigot/youv qui s’y étale par galettes cent fois plus grasses que chez Simonin ou San-Antonio.
Car Zarca a visiblement autre chose à foutre que de s’encombrer de réflexions sur le monde underground parisien ; il a compris que l’univers dans lequel il a fait ses classes est un univers dont on parle sans ostensiblement le montrer ni en expliciter tous les bails. Il met en scène la plupart des recoins les plus sordides de Paris ceux dont on ne parle pas par pudeur, par crainte ou pas discrétion. En cela, combiné avec son patois volontiers vulgaire, il rapproche inévitablement son œuvre du polar « hard-boiled », et par-là du roman réaliste/naturaliste qu’ont développé Balzac, puis Sue, puis Zola ; l’exploration de Paname, qui se transforme bientôt en quête, est plus proche de la réalité objective de notre capitale que la quasi-totalité de ce que les romanciers contemporains grattent. Il répond aux problématiques d’un Paname rongé par la corruption, la racaille, la crasse et la drogue.
Car malgré toute la fiction déployée, ayez malgré tout conscience – bien qu’avec discernement – de l’authenticité de tout ce dont parle Zarca dans ce récit. Les combats clandestins à la Fight Club, le bar à putes de Pigalle, la chapelle des toxicos de Barbès, le sanctuaire de la Gare du Nord, l’hyperglauque boîte gay Le Gouffre à Montparnasse… tout cela existe bel et bien, et aussi loin que vous aimeriez y jeter un œil par curiosité mal placée, croyez-moi vous le regretteriez très vite.
Evidemment, tout ce que raconte Zarca n’est pas 100% véridique, mais la frontière entre fiction et réalité est trop trouble pour ne pas nous laisser éberlué d’une telle lecture. Au fur et à mesure que progresse Paname Underground, une réelle descente aux Enfers se dessine, rythmée par les visites de places toujours plus cradingues, les rencontres et les amitiés qui se renforcent, les drogues dures consommées avec de moins en moins de retenue, pour mettre en scène les dessous d’une meurtre, et comment la quête de la vengeance s’opère au fil des réseaux tissés dans le milieu. Vengeance sans rédemption, violence sans catharsis, trips sans rémission, coups bas sans code d’honneur, dans cet environnement sombre, torturé et puant, tout se relie et s’interconnecte sans pitié, mais aussi avec chaleur, parfois même avec humanité (il suffit de voir les liens qu’entretient Zarca avec Dina, Slim et Cylia).
Dans cet objet littéraire de par les rapports qu’il entretient avec le monde, plus rien n’est beau, tout sent la merde, la littérature même se voit désacralisée. Le vocabulaire crasseux et ordurier dont ne se départit aucun personnage massacre la langue que l’on veut romanesque, la quête de vengeance sans enrichissement appauvrit les visées narratologiques, et Zarca lui-même en tant que « héros » ne transcende aucune valeur ni ne donne aucune sens à sa quête, sinon la bassesse d’un monde ignoble aux avatars tout aussi répugnants et une vengeance qui n’aura rien de purgative.
Si Hemingway affirme que Paris est une fête, Zarca nous en offre la version alternative, la face cachée qui doit le rester. Ce livre, loin de tenter de désacraliser et d’aseptiser le milieu underground, confirme que l’univers underground existera toujours, qu’il survivra à toutes les tentatives de standardisation du milieu urbain, et que les tréfonds de Paris sont tortueux, sombres et dangereux, répulsifs mais attrayants, dégueulasses mais fascinants.