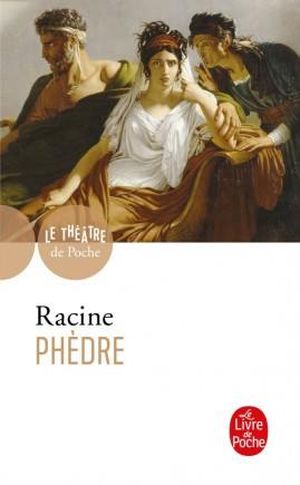"Aimer Phèdre, c'est pas facile", aurait pu dire notre (ancien) petit président, s'il avait la moindre idée de l'existence de cette pièce. En fait, ça dépend de tout un tas de trucs compliqués, qui sont le plus souvent dus au hasard : a-t-on eu un bon prof de français, au lycée ? aime-t-on le Grand Siècle et la mythologie ? croit-on en l'universalité de l'expérience tragique ? a-t-on confiance dans le jugement de Proust ? Personnellement, j'ai du mal avec Wagner, mais passons.
Phèdre, c'est une histoire bête à pleurer qui créerait aujourd'hui un mini-scandale à Wisteria Lane avant qu'il ne soit oublié par un crash d'avion ou le quinzième meurtre en huit ans. Une femme aime le fils de son mari qui lui préfère la gentille petite descendante de l'ennemi mortel (et mort). "Et alors ?", a-t-on envie de dire. "Quitte ton gros lourd, inscris-toi sur Meetic et trouve un sosie encore plus jeune histoire de la jouer couguar décomplexé !". Oui, sauf que ça marche pas comme ça.
Pourquoi ? À cause de quelques concepts désuets, dont le premier est celui du devoir sacré. Phèdre ne peut pas aimer le fils de son mari, car c'est son fils, littéralement. Cet amour incestueux est donc interdit. À moins que... Thésée ne meure, bien sûr. Et le premier acte s'achève sur cette déclaration : le roi est descendu aux Enfers. Y aurait-il un espoir ?
C'est là qu'Oenone entre en jeu. Oenone, la suivante docile, Oenone qui écarte tout le monde quand sa maîtresse le lui demande, Oenone qui arrange les cheveux de Phèdre, qui les orne, qui les voile... et qui enclenche le mécanisme, cher à Anouilh. Les premiers mots de Phèdre sont pourtant : "N'allons pas plus avant..." ; Oenone fait fi de cette supplique et l'exhorte à avancer, à vivre, à avouer son amour, à calomnier l'innocent Hippolyte. C'est le bras du destin, contre lequel une femme à la volonté affaiblie ne peut pas lutter. Phèdre qui n'est "ni tout à fait innocente, ni tout à fait coupable" se laisse subjuguer par l'espoir, le fol espoir d'un amour partagé... Jusqu'au moment, horrible entre tous, où l'illusion s'écroule : "Oenone, qui l'eût cru ? J'avais une rivale".
Phèdre, c'est plus qu'un récit, c'est une tragédie. Ce sont surtout des vers sublimes, quintessence de la langue française (quoi qu'en aient pu dire certains critiques du XVIIe siècle, nos augustes aïeux). Ce sont des soubresauts de passion, de folie, des moments de délire que suivent de profonds abattements, une joie éphémère que les personnages paient durement, par la mort ou le deuil. Phèdre, c'est un trio macabre auquel Racine ajoute Aricie, de peur qu'Hippolyte ne soit pris pour un inverti (ce qui aurait été horrible, n'en doutons pas).
Je conçois qu'on puisse détester Phèdre, surtout si l'on a vu au théâtre l'une de ses mises en scène grotesques, où une septuagénaire ridée et emperlouzée vient déclamer en se boursouflant qu'elle brûle d'une passion funeste, bla bla bla. Oubliez ces images ridicules, ces mises en scènes mortelles qui dénaturent le propos, et souvenez-vous que Phèdre a vingt ans, Thésée la trentaine triomphante et Hippolyte quinze. Mettez-y, en lisant, la passion de la jeunesse, identifiez-vous ! Moi, je garde de cette tragédie un souvenir puissant, car l'ayant lue, comme tout le monde, au lycée, je n'avais aucune difficulté à m'identifier à l'héroïne, à ressentir la douleur d'un amour non partagé, d'une jalousie irrationnelle. Phèdre n'est pas un bouquin barbant de vieux barbon, qu'on lit au coin du feu en charentaises pendant sa retraite ; c'est une folie de jeunesse, qu'on adule et dont on se détache peu à peu, c'est un journal intime d'adolescent qu'on relit avec nostalgie et un brin d'ironie.
Car rien n'empêche de trouver Phèdre drôle, malgré elle :
"Misérable ! et je vis ? et je soutiens la vue
De ce sacré Soleil dont je suis descendue ?"