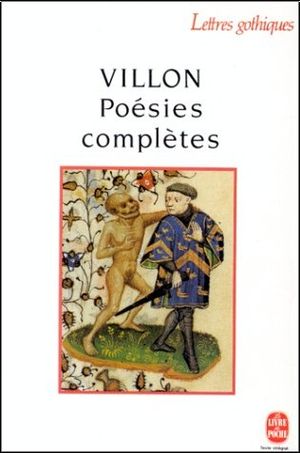À la postérité, Villon lègue l’idée qu’un voyou peut raconter sa vie de voyou et que ça peut aboutir à une œuvre littéraire. À ma connaissance, c’est le premier écrivain de la littérature française dans ce cas ; le deuxième viendra longtemps après – Genet ? (Je parle d’écrivain, pas de personnage fictif.) Dans un registre proche, je ne goûte pas spécialement les modernisations à outrance, mais voir dans la poésie de Villon quelque chose comme une anticipation du rap ne me paraît pas entièrement dénué de fondement : forme littéraire codifiée, goût pour le clash et les punchlines, caractère autobiographique et quotidien du propos…
Item, aux historiens et aux historiens de la littérature passés, présents et à venir, il donne l’occasion de dépoussiérer quelques kilomètres linéaires d’archives. Les érudits de 1900 se demandaient si « la grosse Margot » était un type littéraire, une bordelière réelle ou une enseigne de cabaret ; peut-être ceux du XXIe siècle éclairciront-ils certaines zones d’ombre de la vie de notre « eschollier ». Outre les personnages, outre l’argot de Ballades en jargon qui ne sont encore que partiellement déchiffrées, il y a chez Villon un goût du double sens qui est peut-être l’un des rares plaisirs authentiquement partagés par un philologue universitaire et par un simple lecteur cultivé.
Item, au lecteur, une conscience de l’histoire littéraire. Sans être un spécialiste de la littérature médiévale, on voit bien que la langue de Villon n’est pas celle d’un Chrétien de Troyes ou d’un Jean de Meung. Il le sait et en joue, dans cette partie du Testament (vers 385 à 412 de l’édition des « Lettres gothiques ») qui pastiche l’ancien français.
Item, aux critiques de toutes écoles, de quoi assouvir leur soif. Les critiques biographiques s’amusent, les médiévistes ont quelques manuscrits à se mettre sous la dent, et même les structuralistes peuvent y retrouver leur goût pour l’intertextualité (« mes troys povres orphelins » du Testament, v. 1275, sont les « troys petits enffans tous nudz » du Lais, v. 194), et pour l’écriture en train de se faire (Lais, XXXV).
Item, à quiconque se sent vieillir, l’expression d’une angoisse profonde devant le temps qui passe. « “Ainsi le bon temps regretons / Entre nous, povres vielles soctes, / Assises bas à cruppetons, / Tout en ung tas, comme peloctes, / À petit feu de chenevoctes, / Tost aluméës, tost estainctes… / Et jadis fusmes si mignotes ! », déplore la Belle Heaumière devant ses compagnes, avant d’ajouter : « Ainsi en prent à maint et maintes.” », regrette la Belle Heaumière. Le temps, chez Villon, marque une décrépitude à la fois physique et morale, et surtout à la fois individuelle et universelle : « Je plains le temps de ma jeunesse » (Testament, XXII) et « Mais où sont les neiges d’anten ? » (« Ballade des dames du temps jadis »), même combat.
Item, à tous, un humour particulier : combien de digressions dans le Testament qui l’éloignent non seulement des testaments réels, mais surtout des testaments poétiques de l’époque ? Cet humour – dont les enjeux n’ont rien de léger – est finalement assez noir. Oui, parallèlement au macabre profond du chef-d’œuvre qu’est la ballade dite « des Pendus », on trouvera des blagues d’ivrognes et des jeux de mots scatologiques. Parce que d’un côté, Villon écrit « Premier doue de ma povre ame / La glorïeuse Trinité », de l’autre « Item, mon corps j’ordonne et laisse / À nostre grant mere la terre. » (Testament, LXXXV-LXXXVI). Il me semble d’ailleurs que toute l’œuvre de Villon repose sur ce déchirement entre aspiration à l’idéal et réalité qui « poise » : « Je suis pecheur, je le sçay bien, / Pourtant ne veult pas Dieu ma mort, » (Testament, v. 105-6).
Il y a un codicille : une invitation, « De tout ce testament, en somme, / S’aucun y a difficulté, / L’oster jusqu(es)’au rez d’une pomme / Je luy en donne faculté. // De le gloser et commanter, / De le diffinir et descripre, / Diminuer ou augmenter, / De le canceller ou prescripre / De sa main – et ne ne sceust escripre – / Interpreter et donner sens, / À son plaisir, meilleur ou pire, / À tout ceci je m’y consens. »