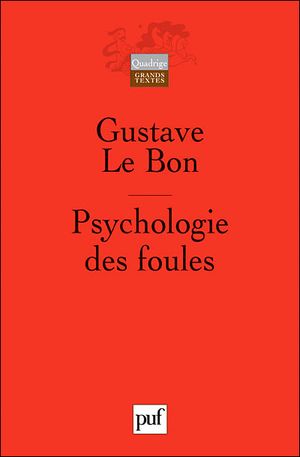Gustave Le Bon, médecin et sociologue du XIXe livre une analyse à charge sur la psychologie collective qui compose les foules (il faut comprendre les masses).
Il s'appuie sur les travaux de Taine, de Tocqueville, Renan ainsi que ses précédents écrits pour éclairer aux regards de l'analyse des événements de la révolution Française et de l'Empire période illustrant parfaitement comment se comportent les foules lors des moments liesses - parfois de haines - populaires. Passe sous sa lunette, les jurés, magistrats, députés, religieux et la façon dont les rares meneurs de foules que l'histoire connut réussirent à les manipuler. L'exemple de Napoléon met en exergue ces sentiments de prestige que pouvaient susciter le grand homme sur ses troupes et sur les Français. Gustave Le Bon utilise l'étonnante escapade victorieuse de l'Ile d'Elbe pour montrer que le prestige seul - sans pouvoir réel - peut être un facteur d'adhésion pour les masses mais également pour les individus les plus brillants (Ney, Davou, Maret, Ornano, Augereau, Vandamme ...).
Passent également sous son crible, l'influence qu'a la presse sur les masses ainsi que la soumission des élites dirigeantes aux sentiments des foules. La docilité des foules électorale les forcent à un dogmatisme qui donne, selon lui, l'illusion de la démocratie.
Si, de nos jours, les foules n'existent plus à proprement parler dans les rues de Paris comme des masses assoiffées de sang et justice, elles peuvent encore se trouver sur les réseaux sociaux ... Le composé est different, l'hétérogénéité de la foule toujours présente mais le modus operandi diffère. L'effet de foule, lui, subsiste. Que ce soit pour lyncher ou louer.
Le livre se clôture sur les considérations suivantes qui sonnent prophétique :
« Si nous envisageons dans leurs grandes lignes la genèse de la grandeur et de la décadence des civilisations qui ont précédé la nôtre, que voyons-nous ?
A l'aurore de ces civilisations une poussière d'hommes, d'origines variées, réunie par les hasards des migrations, des invasions et des conquêtes. De sangs divers, de langues et de croyances également diverses, ces hommes n'ont de lien commun que la loi à demi reconnue d’un chef. Dans ces agglomérations confuses se retrouvent au plus haut degré les caractères psychologiques des foules. Elles en ont la cohésion momentanée, les héroïsmes, les faiblesses, les impulsions et les violences. Rien n’est stable en elles. Ce sont des barbares.
Puis le temps accomplit son oeuvre. L'identité des milieux, la répétition des croisements, les nécessités d'une vie commune, agissent lentement. L’agglomération d'unités dissemblables commence à se fusionner et à former une race, c'est-à-dire un agrégat possédant des caractères et des sentiments communs, que l'hérédité va fixer de plus en plus. La foule est devenue un peuple, et ce peuple va pouvoir sortir de la barbarie.
Il n'en sortira tout à fait pourtant que quand, après de longs efforts, des luttes sans cesse répétées et d'innombrables recommencements, il aura acquis un idéal. Peu importe la nature de cet idéal, que ce soit le culte de Rome, la puissance d'Athènes ou le triomphe d'Allah, il suffira pour donner à tous les individus de la race en voie de formation une parfaite unité de sentiments et de pensées.
C'est alors que peut naître une civilisation nouvelle avec ses institutions, ses croyances et ses arts. Entraînée par son rêve, la race acquerra successivement tout ce qui donne l'éclat, la force et la grandeur. Elle sera foule encore sans doute à certaines heures, mais alors, derrière les caractères mobiles et changeants des foules, se trouvera ce substratum solide, l'âme de la race, qui limite étroitement l'étendue des oscillations d'un peuple et règle le hasard.
Mais, après avoir exercé son action créatrice, le temps commence cette oeuvre de destruction à laquelle n'échappent ni les dieux ni les hommes. Arrivée à un certain niveau de puissance et de complexité, la civilisation cesse de grandir, et, dès qu’elle ne grandit plus, elle est condamnée à décliner bientôt. L'heure de la vieillesse va sonner pour elle.
Cette heure inévitable est toujours marquée par l'affaiblissement de l'idéal qui soutenait l'âme de la race. A mesure que cet idéal pâlit, tous les édifices religieux, politiques ou sociaux dont il était l'inspirateur commencent à s’ébranler.
Avec l'évanouissement progressif de son idéal, la race perd de plus en plus ce qui faisait sa cohésion, son unité et sa force. L'individu peut croître en personnalité et en intelligence, mais en même temps aussi l'égoïsme collectif de la race est remplacé par un développement excessif de l'égoïsme individuel accompagné par l'affaissement du caractère et par l'amoindrissement de l'aptitude à l'action. Ce qui formait un peuple, une unité, un bloc, finit par devenir une agglomération d'individus sans cohésion et que maintiennent artificiellement pour quelque temps encore les traditions et les institutions. C'est alors que, divisé par leurs intérêts et leurs aspirations, ne sachant plus se gouverner, les hommes demandent à être dirigés dans leurs moindres actes, et que l'État exerce son influence absorbante.
Avec la perte définitive de l'idéal ancien, la race finit par perdre entièrement son âme ; elle n'est plus qu'une poussière d'individus isolés et redevient ce qu'elle était à son point de départ : une foule. Elle en a tous les caractères transitoires sans consistance et sans lendemain. La civilisation n'a plus aucune fixité et est à la merci de tous les hasards. La plèbe est reine et les barbares avancent. La civilisation peut sembler brillante encore parce qu'elle possède la façade extérieure qu'un long passé a créée, mais c'est en réalité un édifice vermoulu que rien ne soutient plus et qui s’effondrera au premier orage.
Passer de la barbarie à la civilisation en poursuivant un rêve, puis décliner et mourir dès que ce rêve a perdu sa force, tel est le cycle de la vie d'un peuple. »