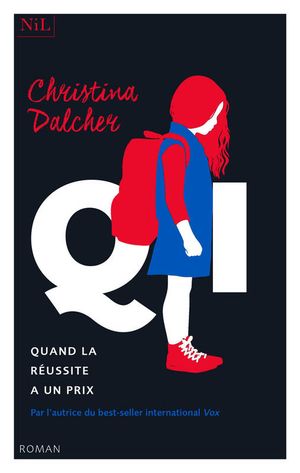C'est intéressée par les dérives et les espoirs de l'école que j'ai ouvert ce roman dystopique, et c'est ennuyée par les pensées progressistes de son auteur que je l'ai refermé. Parce que si les premières pages laissent entrevoir une histoire réfléchie, très vite le cauchemar scolaire mentionné devient prétexte à l'établissement d'un fourre-tout de bien-pensance — et aux jérémiades d'une quarantenaire malheureuse en mariage qui n'attire pas la sympathie. Jamais les abus du système établi dans ce livre ne sont détaillés, tout n'est que sous-entendu maladroit, allusion tranquille ; il faut attendre le soixante-quatorzième chapitre (à dix-huit pages de la fin) pour comprendre « l'enfer » promis aux élèves qui ne correspondent pas aux idéaux prônés par les « méchants ». Les scènes scolaires sont en fait si rares que je m'interroge sur la pertinence de mettre en évidence les noms « école », « enseignante » et « élèves » dans le résumé... Ce n'est véritablement que l'histoire d'une mère de famille mise au pied du mur, rencontrant une foule de gens stéréotypés (mais que, semble-t-il, l'écrivain imagine non conventionnels) et passant son temps à critiquer méchamment tout ce qui l'entoure, des cheveux pleins de pellicules d'une adolescente aux massifs de la voisine. L'héroïne est à ce point bêtasse que je me demande encore comment elle peut avoir un tel score Q ; c'est sans doute là le fait le plus incohérent du roman.