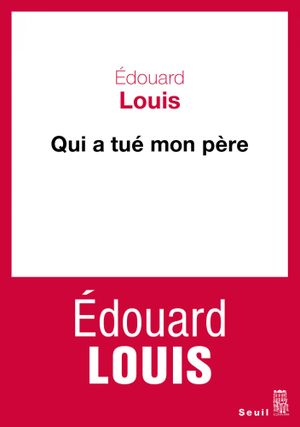Dans une perspective nettement ernausienne, ce bref ouvrage consiste en une méditation (auto)biographique sur le père d’Édouard Louis, qu’on avait déjà croisé dans En finir avec Eddy Bellegueule, et pas sous son meilleur jour. Cette fois, les réconciliations de rigueur ayant eu lieu, c’est dans un but d’hommage que le jeune écrivain prend la plume. L’ouvrage est divisé en trois parties. La première, la plus longue, me paraît la moins intéressante. Elle consiste en une série de souvenirs, associés à une date, qui concernent les rapports du jeune Eddy Bellegueule avec son père. Cette relation, grevée par les silences et les tabous, oscille entre la haine, la violence et l’amour tout de même qui transparaît parfois par éclairs. Le style est brut, sobre ; le narrateur nous laisse digérer les faits, généralement sans les commenter. Il est dommage qu’à une ou deux reprises il ait besoin de sortir les grands auteurs (Sartre, Éribon, p. 35) pour tirer lourdement les leçons de la séquence qu’on vient de lire. Ce faisait, il accuse un défaut de son livre : l’insuffisance d’une narration qui ne permet pas aux faits de parler d’eux-mêmes.
La deuxième partie, plus brève, est plus réussie parce qu’elle concerne un événement en lui-même plus grave et plus traumatisant que les autres : la tentative de meurtre commise par le frère d’Eddy Bellegueule sur son père, et dont Eddy se sent responsable parce que c’est lui qui a volontairement provoqué la dispute qui a dégénéré (ici, le souvenir d’Annie Ernaux est patent). Le rythme du récit est mieux géré qu’ailleurs, et le mélange de sobriété stylistique et de dramatisation (à grand renfort de prolepses, effets d’attente, etc.) donne une grande intensité à la scène en soulignant efficacement le caractère implacable et terrible de la machine à violence qui s’emballe.
La troisième et dernière partie est littérairement la plus réussie : ce n’est plus Édouard Louis cette fois qui manque de tuer son père, mais les responsables politiques, dont les mesures et les lois (dérembourser des médicaments, détricoter le droit du travail) ont un impact grave et direct sur la santé et la vie des gens : « Jacques Chirac et Xavier Bertrand te détruisaient les intestins » (p. 75), « Nicolas Sarkozy et Martin Hirsch te broyaient le dos » (p. 77), « Hollande, Valls et El Khomri t’ont asphyxié » (p. 79). « Pourquoi est-ce qu’on ne dit jamais ces noms dans une biographie ? » demande l’auteur (p. 75), soulignant avec un peu de lourdeur la relative originalité de sa démarche. Et de fait, il y a quelque chose de vertigineux, il y a de la force et du souffle, dans cette exhalaison de colère, dans cette manière de connecter la vie anonyme de M. Bellegueule aux décisions que certains prennent à l’Élysée et à Matignon. Incontestablement ça marche.
Reste que, politiquement, il y a quelque chose qui me gêne là-dedans. C’est un peu léger de traiter tous ces gens de « meurtriers » (p. 82) sous prétexte que M. Bellegueule a souffert de leurs décisions, et je suis content qu’Édouard Louis me donne l’occasion de parler de cela. Une bonne politique n’est pas une politique qui ne fait pas souffrir ; on rate totalement l’idée de justice, si on croit pouvoir simplement l’indexer au degré de bien-être d’untel ou d’unetelle. La politique, ça implique de faire des choix, et parfois de laisser mourir des gens, parce que les ressources dont on dispose sont limitées (et ce n’est pas une question de capitalisme : la force de travail disponible sera toujours limitée) et parce qu’on ne pourra jamais sécuriser tous les virages dangereux ou soigner toutes les maladies rarissimes. Prendre un type, constater qu’il souffre, et dire que c’est la faute de ce salaud de Sarkozy, c’est un peu facile et naïf. Peut-être que le déremboursement des médicaments était injuste (sans doute), peut-être que la loi Travail était injuste (sans doute), mais ce n’est pas à cela que ça se voit, et un mauvais argument ne devient pas bon parce qu’il est là pour servir une bonne cause. Du coup, c’est un peu triste pour lui, mais j’ai le sentiment que dans son énième tentative pour articuler de manière satisfaisante l’expérience individuelle aux faits collectifs, Édouard Louis a encore échoué.
De la deuxième à la troisième partie, la responsabilité se déplace : ce n’est plus Eddy ou son frère qui ont « tué », ou failli tuer, leur père, mais Chirac, Sarkozy, Hollande et leurs ministres respectifs. La démonstration est limpide, et la question qui donnait son titre au livre trouve une réponse. Mais est-ce une question ? On est frappé, sur la couverture, par l’absence du point d’interrogation attendu. Le titre Qui a tué mon père figure, en noir, juste en dessous du nom de l’auteur, en rouge, et sans aucun signe de ponctuation. J’ai envie de faire confiance à ce que je vois et de rétablir un sens conforme à ce qui est écrit : « Édouard Louis qui a tué mon père ». Avec une relative. Le père de qui, alors, sinon celui d’Eddy Bellegueule, avec lequel décidément on n’arrive pas à en « finir » ? Il me plaît d’imaginer (mais enfin, je ne délire pas, ce n’est pas ma faute s’il n’y a pas de point d’interrogation) qu’Eddy Bellegueule est le locuteur de cette couverture, le narrateur du paratexte, le paranarrateur, pour employer un mot que feu Gérard Genette a me semble-t-il omis d’inventer. Il n’y a pas à forcer beaucoup, n’est-ce pas, pour faire de la mutation d’Eddy Bellegueule en Édouard Louis, et de la sortie de son premier roman, une manière de parricide symbolique. Alors oui, tout de même, en fin de compte, peut-être qu’Édouard Louis a quelque chose à se reprocher et qu’il en a conscience…