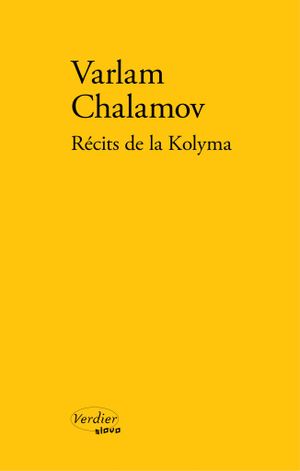Varlam Tikhonovitch Chalamov (1907-1982) fut arrêté à l’âge de vingt-deux ans pour avoir diffusé le Testament de Lénine, qui exprimait ses réserves envers Staline. S’ensuivent dix-sept années de goulag, qui le transforment en « crevard », en squelette à peine vivant.
La Kolyma est une presqu’île à l’Est de la Sibérie, où les conditions de vie sont proches des camps d’extermination. Aucune chambre à gaz, juste un froid qui va de -50 à -60 degrés, et des rations alimentaires quasi-inexistantes. Les détenus sont affectés à des travaux de force (gisements aurifères, notamment) : quelques semaines suffisent à éteindre en eux toute humanité. La plupart d’entre eux ignore pourquoi elle a été déportée. Les « 58 », article vague aux innombrables alinéas qui punit la propagande antisoviétique, les truands, les « caves », les « chiennes », affluent par vagues. Et sont décimés.
Chalamov ne doit sa survie qu’à une succession de hasards, de rencontres, et non pas de chances. Ce mot est absent du vocabulaire des camps, singulièrement appauvri. La chance, s’il y en a une, serait bien plutôt la mort immédiate, instantanée, aussitôt arrivé. Durant ces dix-sept terribles années, le poète s’épuise seize heures par jour, sans jamais remplir la « norme » (le minimum imposé par les autorités). Il est hospitalisé à maintes reprises. Enfin, il est choisi pour passer le concours d’aide-médecin, qualification qui le sauve.
La Kolyma, c’est l’Enfer. Les hommes se transforment en bêtes, certains trouvent la force de résister, la plupart s’abandonnent. Le suicide est un idéal très rarement atteint. Observer les montagnes enneigées, tenir un crayon dans ses mains, croire en une chose aussi lointaine que l’art, sont tout simplement impensables. Chalamov a tout perdu – sa mémoire, sa force, sa culture. Et pourtant, ce sont des vers qui l’habitent, tout au long de cet exil atroce, et qui le maintiennent éveillé.
Les Récits de la Kolyma, commencés en 1954, et publiés pour la première fois en 1978 à Londres, se composent de 146 nouvelles, divisées en 6 parties – « Les récits de la Kolyma », « Rive Gauche, « Le virtuose de la pelle », « Essais sur le monde du crime », « La résurrection du mélèze », « Le Gant ». La forme de la nouvelle, lapidaire, sans appel, est d’une bouleversante justesse. Tel une mosaïque hideuse et infinie, le système concentrationnaire russe se déploie sous nos yeux. Les anecdotes cruelles, les histoires enchâssées, les souvenirs obsédants, tout cela nourrit l’écriture de Chalamov – une écriture épurée, digne, magnifique - qui n’espère plus rien.
De nombreuses nouvelles sont autobiographiques. D’autres s’inspirent de figures réelles ou fantasmées, qui parfois reviennent, comme des doubles morts de l’auteur. De grands personnages apparaissent : Pouchkine, Blok, Mandelstam, Akhmatova, Maïakovski…Et c’est un peu comme si la littérature russe toute entière était enfermée, était étouffée dans ces camps de la mort.
Les Récits de la Kolyma sont un exploit, un miracle. Chalamov parvient à élever ce gâchis inconcevable, ces dix-sept années abominables, vers le monumental. Vers le monument littéraire. Son mémorial est assurément l’une des plus grandes œuvres de la littérature russe.
Extrait du « Train », la libération, enfin:
Tout était comme à l’accoutumée : les sifflets des locomotives, les wagons qui roulaient, la gare, le milicien, le marché de la gare, comme si je venais simplement de faire un rêve qui aurait duré de longues années et que je me réveillais à peine. J’en fus effrayé, je sentis une sueur glaciale me monter au front. Je fus épouvanté par cette terrible force humaine : le désir et la capacité d’oubli. Je me rendis compte que j’étais prêt à tout oublier, à rayer vingt années de ma vie. Et quelles années ! Et, en le comprenant, je remportai une victoire sur moi-même. Je savais que je ne laisserais jamais ma mémoire effacer tout ce que j’avais connu. […]
Dans la cohue et le bruit du wagon, je n’entendis pas l’essentiel, ce que je voulais et devais entendre, ce dont j’avais rêvé pendant dix-sept ans, ce qui était devenu pour moi comme le symbole du continent, un symbole de vie, le symbole de la Grande Terre. Je n’entendis pas siffler la locomotive. Je n’y avais pas même pensé pendant la bataille pour les places. Je n’entendis pas le sifflet. Mais il y eut un soubresaut, les wagons s’entrechoquèrent et notre voiture, notre convoi, commença à se déplacer, comme si je m’endormais et que la baraque glissait devant mes yeux.
Je m’obligeai à comprendre que je partais. Pour Moscou. […]
La gare de Iaroslavl. Le bruit, le ressac urbain de Moscou, de la ville qui m’était plus chère que toutes les villes du monde. Le wagon s’arrêta. Le visage de ma femme, ce visage que je connaissais si bien, m’accueillant de la même façon qu’auparavant, quand je rentrais de mes nombreux voyages. Cette fois, la mission avait été longue : presque dix-sept ans. Et, surtout, je ne rentrais pas de mission. Je revenais de l’enfer.
(traduit du russe par Luba Jurg)