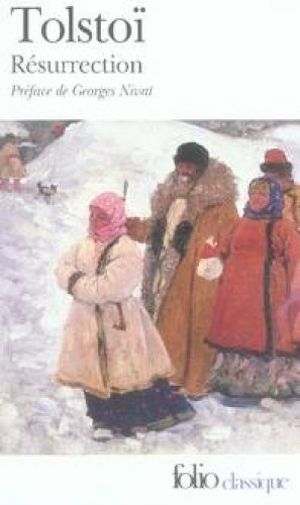Oh combien de fois j’ai déploré qu’à l’inverse du « jamais deux sans trois » traditionnel, ce cher Lev Nikolaïevitch n’ait pas eu la bonne idée d’écrire un dernier pavé après Guerre et Paix et Anna Karenine, un roman touffu comme il savait si bien les tricoter. J’aurais dû mieux regarder sa page Wikipédia ! car ce roman existe, même si pas grand monde ne le lit. Par quelle étrange concours de circonstances ai-je donc cru toutes ces années que sous ce titre un peu glaçant se cachait une pénible profession de foi toute à la gloire du Christ roi, un récit de sa conversion, un texte partisan et monolithique ? Mystère.
Évidemment, le fond du problème est que ce roman est mal-aimé. Sur le principe effectivement, il n’y a rien qui milite en sa faveur, car quoi de plus difficile que de réussir un roman à thèse ? En décidant, à pratiquement soixante-dix ans, de se pencher sur le sort des prisonniers russes, Tolstoï prend des risques littéraires énormes. Mais voilà, le constat est là : quand on a du talent, les pires gageures peuvent accoucher des plus merveilleux chefs-d’œuvres, et mis par lui-même au pied du mur, Léon se surpasse, et offre en guise de testament un des plus grand roman militant de tous les temps.
Le vrai danger des idées, c’est qu’elles risquent à tout moment de phagocyter la vie autour d’elles, de tout rendre sec et verbeux. Elles sont un peu l’inverse du romanesque, ce long courant qui porte en lui les multiples facettes vacillantes de la réalité. L’énorme réussite de Résurrection c’est de savoir mêler les deux, plutôt que de contempler avec fatalisme le mur qui semblait les avoir séparés une fois pour toute. Car des idées, sur la pauvreté, le crime, le système judiciaire, le cynisme des riches, le malheur des pauvres, la prévarication, l’injustice, l’oppression, Tolstoï n’en manque pas. Il pose sur l’état de son pays un regard d’une violence et d’une lucidité impressionnantes. Partout il ne voit qu’un système souverain et tyrannique : une machine à broyer les faibles, des rouages judiciaires qui sous couvert de défendre la société ne font que perpétuer et accroitre le mal qu’ils entendent combattre. Contre cela, le vieux comte pense qu’on peut, qu’on doit lutter avec une seule arme possible : l’amour universel, et le refus absolu pour l’être humain de se poser en juge. Une solution qui dit comme ça parait bien simpliste. Mais dès lors que de prétexte à l’énoncer, un roman en devienne une image vivante et soudain un souffle gigantesque s’élève, comme si les idées étaient désormais des globules rouges dans le sang d’un récit, grand corps vigoureux qui en tire toute sa force et son énergie. Et par contrecoup les fait voyager dans chaque veine, dans chaque cellule qui le composent.
C’est cet équilibre parfait qu’aura trouvé Tolstoï, en racontant le périple de Nekhlioudov, aristocrate et dandy se transformant sous nos yeux en un activiste de la justice sociale. Pour des raisons un peu grotesques au départ, mais qui comme une cascade obstinée effrite jour après jour la carapace qui le tenait éloigné de ses frères humain. Un périple, oui, aussi bien géographique, à travers les prisons, les cabinets ministériels, les plaines de Sibérie, que mental, à travers les doutes, les revirements, le désespoir et la révolte. Rien pour ce héros si particulier, si changeant, n’est jamais gagné d’avance et c’est ce flou permanent qui permet au romancier de s’avancer dans les hautes herbes de son livre sans les écraser. Sa plume est comme un grand vent, à la fois mystique et humoristique, qui a l’immense privilège de tout bouleverser, de tout secouer, mais sans rien casser. Elle passe et quand elle se retourne le paysage est resté le même. Et pourtant, il a changé a tout jamais.