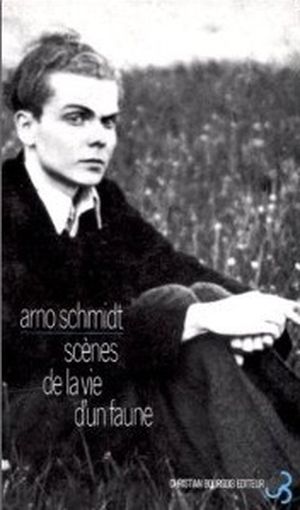Qui a dit que l’humour était absent de la littérature allemande ? Celui de Lichtenberg était causticité pure, celui des "Scènes de la vie d’un faune" est particulièrement noir : « je tiens absolument à la crémation ; c’est bien plus hygiénique ! » écrit Arno Schmitt (p. 125). En 1953, alors que l’Allemagne se reconstruit dans la honte et la culpabilité, le roman grand-guignolise le nazisme, comme plus tard Tarantino le KKK dans "Django Unchained" (oui, la scène de cavalcade encagoulée…). Ou alors il parle d’autre chose, alors que l’action a lieu en 1939 et 1944 : « Le plus fiable, ce sont encore les beautés de la nature. Ensuite les livres, puis un rôti braisé choucroute. Tout le reste est versatile et vain. » (p. 37). Un cran encore au-dessus des « quatre ans de grandes vacances » que fut la première guerre mondiale « pour tant de très jeunes garçons » et pour Raymond Radiguet.
Cela dit, le nazisme n’est que la toile de fond des "Scènes de la vie d’un faune". Il n’y est pas question d’une génération, ni de grandes idées épiques, mais d’un individu : Heinrich Düring, petit fonctionnaire administratif de province qui aurait pu partager son bureau avec le Bougran de Huysmans, le Goliadkine de Dostoïevski ou Joseph K. Il sera le narrateur de ces cent cinquante pages plus denses que quatre cents. Car pour se faire une idée du récit, on peut imaginer un roman classique dont on aurait retranché tout ce qui n’est pas indispensable — descriptions et transitions incluses. Il ne se passe pas rien : Düring évolue, voyage, visite un musée, se prend d’intérêt pour l’histoire d’un déserteur de l’armée de Napoléon. Ainsi, débarrassées du superflu, raclées jusqu’à l’os, les "Scènes de la vie d’un faune" ont l’air d’un squelette.
Düring n’est pas un héros sans ambiguïtés. Il est pleutre. Il aime le confort. Il méprise ses enfants et trompe sa femme avec une lycéenne qui doit avoir leur âge. Mais il est lucide et intelligent. Il lutte à sa manière, avec les armes dont il dispose : « je possède un vocabulaire plus vaste que celui de tous les membre du parti pris ensemble ; en outre je possède two separate sides to my head, alors que les nazis n’ont qu’un hémisphère cérébral. » (p. 101-102).
C’est que le vrai centre du roman — le vrai centre de tout roman hors du commun ? —, c’est le langage. La langue du narrateur est fragmentée, virevoltante, baignée d’une ponctuation délirante mais jamais insignifiante, saturée de références, aussi faussement décousue que tout bon monologue intérieur, ultra-violente. Alors que le Bartleby de Melville protestait par le silence, Düring — et Arno Schmidt avec lui — attaque par le langage. Ce qui nous distingue des nazis — et même « les autres ne valent pas mieux : attendez seulement que les Américains élisent leur Hindenburg ! » (p. 24) —, ce sont les mots, en tant que véhicules de la pensée.
À ce titre la fiction de Schmidt rappelle l’essai sur la Lingua Tertii Imperii de Klemperer. « Je n’avais plus la force des mots : paroles délavées, resucées par des milliards de langues, mots dietricheckartiens, servant à farcir des milliards de bouchées friandes à la Fritzschgoebbels, mots écrabouillés sur toutes les voies respiratoires, aplatis sur toutes les lèvres, éternués, crachats expectorés, fournées de débris, étalés par la balayette de chiotte : langue maternelle (oh, quel vocable adorable, vénérable, n’est-ce pas ?!). » (p. 159). Et en fil rouge la vanité de tout.
Cet utilisateur l'a également mis dans ses coups de cœur et l'a ajouté à sa liste Livres offerts