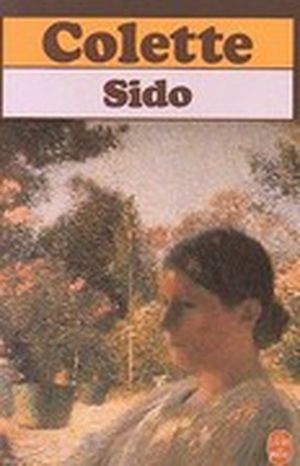Je n’aime pas l’autobiographique, parce que je ne trouve pas en général qu’il parvienne à surpasser la suspicion de narcissisme qui lui est intrinsèque. Je crois que je suis incapable de l’acte de foi fondamental qui soutient tout le genre et qui veut que l’on puisse sans dommage instrumentaliser son intime pour en faire une rampe d’accès à l’universel. Je n’y crois pas parce que la recomposition du soi et du réel à laquelle on procède constamment, et sans s’en rendre compte le plus souvent, n’est dangereuse que lorsque l’on se pense sincère, puisque qui s’illusionne soi-même ne peut pas accéder au recul nécessaire pour transmettre une observation à autrui sans l’empoisonner. De là, je postule d’une nécessité pour la littérature, si elle a la moindre ambition vertueuse – ce qui n’est pas toujours le cas –, de mentir en créant des paravents habillés de notre contrôle sur l’idée qui savent qu’ils sont analogiques et fondamentalement distincts du monde.
Personne n’a le droit de prétendre dire le vrai d’un autre à travers la dignité symbolique que donne un ouvrage, car nous sommes les produits d’une civilisation du papier consacrant.
Sido se compose de trois portraits en enfilade, celui de la mère, celui du père, celui de la fratrie, qui vient fétichiser ce que l’arrogance d’une égoïste aura décidé de synthétiser de la vie d’êtres qui lui sont radicalement étrangers – on rappellera d’ailleurs qu’elle juge ici d’événements survenus des dizaines d’années plus tôt, lorsqu’elle avait moins de dix ans.
Au fil d’une sur-écriture constante, on peinera tout le long d’un ouvrage pourtant très bref à découvrir les destinées singulièrement inintéressantes d’une jardinière, d’un amputé et de deux adolescents qui se couchent dans les fourrés du trou du cul de la Bourgogne – ma famille vient de l’Yonne, pas de vexation.
Alors oui, des gens portent des sécateurs et parlent à leurs voisins au-dessus de la haie. D’autres n’aiment pas leur pote d’école et Papa ne racontait pas ses histoires de guerre. Tout cela nous permet de décréter que sœurette est une merde qui a mis sa vie dans le mur parce qu’elle n’a pas décidé d’être une pute émancipée comme celle qui a raison car elle tient le crayon.
Un vrai livre de femme de lettres, dans la distinction que faisait Balzac entre un homme de lois et un avoué.
PS : Intérêt pédagogique de cette daube absolument nul. Je refuse de croire qu’on fera accrocher la lecture à quiconque se tapera ce genre de tartine pour des scènes au paramétrage insignifiant :
Surtout elle nous rapportait son regard gris voltigeant, son teint vermeil que la fatigue rougissait, elle revenait ailes battantes, inquiète de tout ce qui, privé d’elle, perdait la chaleur et le goût de vivre. Elle n’a jamais su qu’à chaque retour l’odeur de sa pelisse en ventre-de-gris, pénétrée d’un parfum châtain clair, féminin, chaste, éloigné des basses séductions axillaires, m’ôtait la parole et jusqu’à l’effusion. D’un geste, d’un regard elle reprenait tout. Quelle promptitude de main ! Elle coupait des bolducs roses, déchaînait des comestibles coloniaux, repliait avec soin les papiers noirs goudronnés qui sentaient le calfatage. Elle parlait, appelait la chatte, observait à la dérobée mon père amaigri, touchait et flairait mes longues tresses pour s’assurer que j’avais brossé mes cheveux… Une fois qu’elle dénouait un cordon d’or sifflant, elle s’aperçut qu’au géranium prisonnier contre la vitre d’une des fenêtres, sous le rideau de tulle, un rameau pendait, rompu, vivant encore. La ficelle d’or à peine déroulée s’enroula vingt fois autour du rameau rebouté, étayé d’une petite éclisse de carton…Je frissonnai, et crus frémir de jalousie, alors qu’il s’agissait seulement d’une résonance poétique, éveillée par la magie du secours efficace scellé d’or…