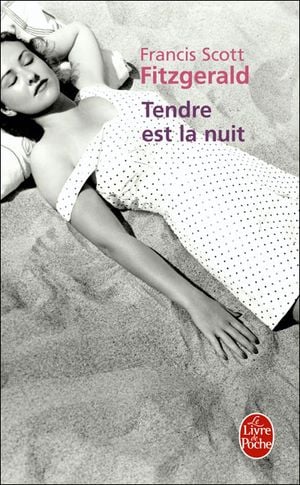Il y a plein de choses qui ne vont pas dans cette histoire. Ça sent un peu le roman inachevé. C'est parfois banal, rempli de clichés. Les passages concernant la folie de Nicole peuvent être franchement mauvais – n'ayons pas peur des mots. Le flottement des points de vue, le bizarre montage narratif fait parfois perdre pied au lecteur. On a envie de sauter des pages, mais quand on ne connaît pas encore le livre comme sa poche, on ne sait pas où on va retomber. Et puis, qu'est-ce que c'est kitsch parfois, d'un mauvais goût tout ce qu'il y a de plus américain. Mais tout ça n'a pas d'importance. Il y a des épiphanies. Il y a des pages que tout écrivain rêverait d'avoir écrites. Des pages qui sont révélation pure. Épiphanie : « manifestation d'une réalité cachée », selon notre grand ami le dictionnaire. Force est de constater qu'il a raison. Fitzgerald est loin de la perfection d'ensemble qu'il a atteinte dans Gatsby, de l'évidence d'un roman qui semble tenir de lui-même par la perfection de sa forme. Mais il tient quelque chose de plus – un saut dans l'inconnu. Dans les premiers chapitres surtout. Là, la tension est surnaturelle. Dick fait les cent pas sur la page. Rosemary tombe amoureuse de lui. Tommy Barban va se baigner, sous le soleil, dans l'eau froide, choc électrique. La peau d'Abe North brûle tandis qu'il cherche à s'évanouir sous le cagnard. Les enfants jouent un peu plus loin. Chacun de ces gestes est réussi. Chacun de ces personnages existe. Bien sûr, ça finit par voler en éclat, ça ne peut pas tenir sur la durée. À un moment, il y a trop de tension, l'équilibre est trop précaire, la vision trop large, trop pleine, la phrase trop pure, trop translucide, trop concentrée. Il faut retourner pour quelques pages dans le roman de bas étage, dans la romance indigeste.
Mais est-ce que c'est grave ? On aura au moins lu ça, on aura au moins connu ça, on aura compris quelque chose. La forme romanesque peut servir à ça. A quoi ? A révéler. Quand tout à coup on voit tout, on sait tout, on sent tout, on comprend tout : on emprunte le regard naïf de Rosemary et la correction délirante d'acuité que Fitzgerald, par sa présence à la fois cotonneuse et tyrannique, fait subir à sa myopie. Je me répète : et soudain on voit tout : on voit les choses la surface des choses, et en même temps, sans accroc, sans ajustement, on voit leur intimité. Et aucune de ces visions ne nuit à l'autre : c'est la même phrase. Ça donne mal au crâne bien sûr, et j'imagine que quand on pose le stylo pour aller déjeuner, on ne sort pas indemne d'avoir écrit comme ça. Mieux vaut avoir une petite bouteille de whisky sous la main. J'imagine que Fitzgerald, au moment précis où il fait ça, se tient vraiment proche du gouffre. Il touche à quelque chose. Disons sa vérité, sa vision, je ne sais pas, son âme, soyons un peu lyrique, de temps en temps ça ne fait pas de mal. Soudainement au détour d'un paragraphe parfaitement maîtrisé, instinctif, – paf –, lumière ; une description en actes, deux trois paroles échangées, une sensation mal sentie, et soudaine tout devient translucide, limpide. Fitzgerald tient soudaine sous sa plume qui avance sur le papier, à quelle vitesse ? en raturant ? sans raturer ? par quels détours ? où, comment ? il tient tous les niveaux de compréhension, ce qui est simple et ce qui est complexe, ce qui est solaire et ce qui est morbide, surtout ce qui est futile, surtout ce qui est dérisoire, il n'y a même plus de narrateur, on devient omniscient, on sait ce que Dick pense, ce que Rosemary en comprend et ce qui lui échappe, ce qu'Abe pense, ce qu'il sent et ce qu'il le déchire, ce qu'est Tommy, ce qu'en penserait la mère de Rosemary si elle était là – tout ça dans le creux d'une seule phrase qui progresse.
Il y a dans ce roman de la compréhension totale, parfaite, et des gros morceaux de vérité, arrachés de je ne sais où. Et là, Dostoïevski devient lourdingue, Hemingway pathétique, Nabokov futile, et tous les écrivains aveugles, nuls, rejetés loin de ça. Y a plus que le maladroit Scott, soudain funambule, qui avance comme ça, sans tomber dans le piège de sa propre cristallité. On est sur la plage, en maillot de bain à rayures, sous les parasols, les enfants jouent un peu plus loin, il fait chaud, et on ressent la toile de tous ces rapports humains. Il faut être parvenu au bout du livre pour ça, il faut le lire une deuxième fois une troisième fois, et petit à petit, il n'y a plus d'ombre, tout est là, c'est parfait, et voilà Dieu remboursé dans sa propre monnaie : l'objectivité.
Dick, sobre et désinvolte, Dick le flamboyant, se fait soudain caricature, bouffon, il vaudrait mieux qu'il se taise, mieux pour tout le monde ; Nicole belle et languide n'oublie pas d'être cruelle et creuse, et tous, ensemble, avec leurs maillots à rayures, sur la Riviera qu'ils ont inventé, sont hautains, maléfiques, provocateurs. Ils savent que tout cela va mal finir. Ils s'amusent. Ils jouent avec leurs nerfs. Ils n'ont qu'une envie, se faire le plus de mal possible avant de mourir. Ils n'ont qu'une vie, alors autant la rater correctement.
Bien sûr, ça ne dure pas. Il faut se coltiner Dick étudiant, Dick rencontrant Nicole, ça pique un peu, on retombe lourdement sur nos pieds, on baille, on est de nouveau aveuglé par la lumière, et puis on n'a perdu certaines de nos facultés d'omniscience, on ne sent plus les synesthésies, il manque quoi ? C'est quoi ce goût amer au fond de la gorge ? La phrase redevient vide et creuse, parfois maniérée, soudain elle se met à pulluler d'émotion, ou à crever toute rabougrie. Mais on ne va pas se mentir : ça fait du bien. De toute façon, heureusement, le niveau de littérature auquel Fitzgerald atteint quelques fois, au moment où il écrit ce roman (où ? quand ? comment ?), on ne peut le toucher que par intermittences, quand certains paramètres se rencontrent, qui sait pourquoi.
Personne n'a jamais écrit aussi bien – et vraisemblablement, n'écrira aussi bien, que Fitzgerald dans ses moments d'apesanteur, ses moments où il déchire le voile, c'est le moment où il tient tout, tout ce qu'il veut, au creux de son poing, et où sa phrase perce, et où sa magie opère, où la surface et ce qu'elle dissimule se révèlent en même temps. Je commence à me répéter alors je me tais.
Je sais qu'on peut pas tous être sensibles aux même choses, et que certains ne verront rien dans ce roman que de la camelote, je sais, je sais, comme moi je ne vois que dalle à certains livres auxquels je mets 3 étoiles sans plus y penser, alors qu'ils mériteraient des larmes.
Encore une fois : Parce que Fitzgerald nous montre dans le même temps, et sans contradictions, les apparences, et ce qu'elles recouvrent, on voit à travers les choses, mais on ne cesse jamais de voir leur surface, et c'est pour ça que tout à coup, on les comprend entièrement, pleinement.
Pourquoi lui ? Pourquoi lui, en écrivant certaines pages de ce livre, il ne fait soudain aucun compromis – il fait fi de tout, ses propres peurs, ses problèmes d'argent, son orgueil, ses inhibitions, ses projets –, il n'est plus qu'un écrivain au vrai sens du terme. Un type qui combat l'opacité, et qui se paye le luxe de la vaincre parfois. Plus de recherche de style. Plus de lecteur, on ne cherche pas à lui plaire. Juste un monde à façonner et à faire danser, une obsession de le posséder entièrement, cadre, personnages, d'être à l'intérieur et à l'extérieur à la fois, et de fondre ses deux positions, en une seule, de les fusionner au sein de la phrase, du regard parfait.