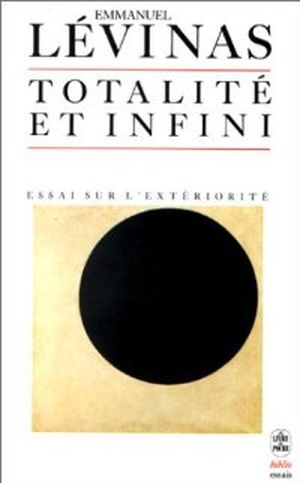« Lorsque l’homme voit mourir un animal, l’horreur le saisit : ce qu’il est lui-même — sa substance même — s’anéantit sous ses yeux, cesse d’être. Mais quand ce qui meurt est un homme, et un homme qu’on aime, alors, en plus de l’horreur ressentie devant l’anéantissement de la vie, on éprouve encore un déchirement, l’âme est atteinte d’une blessure qui, tout comme une plaie physique, parfois tue, parfois se cicatrise, mais fait toujours souffrir et craint les contacts extérieurs qui l’enveniment. »
— Léon Tolstoï
Section 1 : Le même et l’autre
A. Métaphysique et transcendance
1. Désir de l’invisible
« “La vraie vie est absente.” […] Le désir métaphysique tend vers tout autre chose, vers l’absolument autre. […] n’aspire pas au retour, car il est désir d’un pays où ne naquîmes point. […] ne repose sur aucune parenté préalable. […] Le désir est absolu si l’être désirant est mortel et le Désiré, invisible. […] La vision est une adéquation entre l’idée et la chose : compréhension qui englobe. […] la métaphysique désire l’Autre par-delà les satisfactions […]. Mourir pour l’invisible — voilà la métaphysique. »
2. Rupture de la totalité
« le métaphysicien et l’Autre ne se totalisent pas. […] L’irréversibilité ne signifie pas seulement que le même va vers l’Autre, autrement que l’Autre ne va vers le Même. Cette éventualité n’entre pas en ligne de compte : la séparation radicale entre le Même et l’Autre, signifie précisément qu’il est impossible de se placer en dehors de la corrélation du Même et de l’Autre pour enregistrer la correspondance ou la non-correspondance de cet aller à ce retour. Sinon, le Même et l’Autre se trouveraient réunis sous un regard commun et la distance absolue qui les sépare serait comblée. […] Le moi, ce n’est pas un être qui reste toujours le même, mais l’être dont l’exister consiste à s’identifier, à retrouver son identité à travers tout ce qui lui arrive. Il est l’identité par excellence, l’œuvre originelle de l’identification.
Le Moi est unique jusque dans ses altérations. Il se les représente et les pense. L’identité universelle où l’hétérogène peut être embrassé, a l’ossature d’un sujet, de la première personne. Pensée universelle, est un « je pense ».
Le Moi est identique jusque dans ses altération, dans un autre sens encore. En effet, le moi qui pense s’écoute penser ou s’effraie de ses profondeurs et, à soi, est un autre. Il découvre ainsi la fameuse naïveté de sa pensée qui pense « devant elle », comme on marche « devant soi ». Il s’écoute penser et se surprend dogmatique, étranger à soi. Mais le Moi est le Même devant cette altérité, se confond avec soi, incapable d’apostasie à l’égard de ce « soi » surprenant. La phénoménologie hégélienne — où la conscience de soi est la distinction de ce qui n’est pas distinct — exprime l’universalité du Même s’identifiant dans l’altérité des objets pensés et malgré l’opposition de soi à soi.
L’identification du Même dans le Moi ne se produit pas comme une monotone tautologie : « Moi c’est Moi ». L’originalité de l’identification irréductible au formalisme de A est A, échapperait ainsi à l’attention. Il faut la fixer non pas en réfléchissant sur l’abstraite représentation de soi par soi. Il faut partir de la relation concrète entre un moi et un monde. Celui-ci, étranger et hostile, devrait, en bonne logique, altérer le moi. Or, la vraie et l’originelle relation entre eux, et où le moi se révèle précisément comme le Même par excellence, se produit comme séjour dans le monde. La manière du Moi contre l’“autre” du monde, consiste à séjourner, à s’identifier en y existant chez soi. Le Moi, dans un monde, de prime abord, autre, est cependant autochtone. Il est le revirement même de cette altération. Il trouve dans le monde un lieu et une maison. Habiter est la façon même de se tenir ; non pas comme le fameux serpent qui se saisit en se mordant la queue, mais comme le corps qui, sur la terre, à lui extérieure, se tient et peut. Le « chez soi » n’est pas un contenant, mais un lieu où je peux, où, dépendant d’une réalité autre, je suis, malgré cette dépendance, ou grâce à elle, libre. Il suffit de marcher, de faire pour se saisir de toute chose, pour prendre. Tout, dans un certain sens est dans le lieu, tout est à ma disposition en fin de compte, même les astres, pour peu que je fasse des comptes, que je calcule les intermédiaires ou les moyens. Le lieu, milieu, offre des moyens. […] Dans le monde je suis chez moi, parce qu’il s’offre ou se refuse à la possession. […] L’identification du Même [est…] le concret de l’égoïsme. […]
L’absolument Autre, c’est Autrui. Il ne fait pas nombre avec moi. La collectivité où je dis « tu » ou « nous » n’est pas un pluriel de « je ». Moi, toi, ce ne sont pas là individus d’un concept commun. Ni la possession, ni l’unité du nombre, ni l’unité du concept, ne me rattachent à autrui. Absence de patrie commune qui fait de l’Autre – l’Étranger ; l’Étranger qui trouble le chez soi. Mais Étranger veut dire aussi le libre. Sur lui je ne peux pouvoir. Il échappe à ma prise par un côté essentiel, même si je dispose de lui. Il n’est pas tout entier dans mon lieu. Mais moi qui n’ai pas avec l’Étranger de concept commun, je suis, comme lui, sans genre. Nous sommes le Même et l’Autre. La conjonction et n’indique ici ni addition, ni pouvoir d’un terme sur l’autre.
[…] La « pensée », l’ « intériorité », sont la brisure même de l’être et la production (non pas le reflet) de la transcendance. […] L’altérité n’est possible qu’à partir de moi.
[…] Nous proposons d’appeler religion le lien qui s’établit entre le Même et l’Autre, sans constituer une totalité.
[…] Ce n’est pas moi qui me refuse au système, comme le pensait Kierkegaard, c’est l’Autre. »
3. La transcendance n’est pas la négativité
« Le mouvement de la transcendance se distingue de la négativité par laquelle l’homme mécontent, refuse la condition où il est installé. […] Le négateur et le nié se posent ensemble, forment système, c’est-à-dire totalité. […] Précisément, la perfection dépasse la conception, déborde le concept, elle désigne la distance l’idéalisation qui la rend possible est un passage à la limite, c’est-à-dire une transcendance, passage à l’autre, absolument autre. L’idée du parfait est une idée de l’infini. La perfection que ce passage à la limite désigne, ne reste pas sur le plan commun au oui et au non où opère la négativité. […] l’idée du parfait et de l’infini ne se réduit pas à la négation de l’imparfait. »
4. La métaphysique précède l’ontologie
« L’ontologie qui ramène l’Autre au Même, promeut la liberté qui est l’identification du Même, qui ne se laisse pas aliéner par l’Autre.
Une mise en question du Même — qui ne peut se faire dans la spontanéité égoïste du Même — se fait par l’Autre.
[…] l’horizon [dans la phénoménologie depuis Husserl] joue un rôle équivalent à celui du concept dans l’idéalisme classique ; l’étant surgit sur un fond qui le dépasse comme l’individu à partir du concept. […] Aborder l’étant à partir de l’être, c’est, à la fois, le laisser être et le comprendre.
[…] Philosophie du pouvoir, l’ontologie, comme philosophie première qui ne met pas en question le Même, est une philosophie de l’injustice. L’ontologie heideggérienne qui subordonne le rapport avec Autrui à la relation avec l’être en général — même si elle s’oppose à la passion technique, issue de l’oubli de l’être caché par l’étant — demeure dans l’obédience de l’anonyme et mène, fatalement, à une autre puissance, à la domination impérialiste, à la tyrannie. Tyrannie qui n’est pas l’extension pure et simple de la technique à des hommes réifiés. Elle remonte à des « états d’âme » païens, à l’enracinement dans le sol, à l’adoration que des hommes asservis peuvent vouer à leurs maîtres. L’être avant l’étant, l’ontologie avant la métaphysique ¬— c’est la liberté (fût-elle celle de la théorie) avant la justice. C’est un mouvement dans le Même avant l’obligation à l’égard de l’Autre.
Il faut intervertir les termes. »
5. La transcendance comme idée de l’Infini
« […] la distance à laquelle se tient l’objet n’exclut pas — et en réalité implique — la possession de l’objet, c’est-à-dire la suspension de son être. L’ « intentionnalité » de la transcendance est unique en son genre. La différence entre objectivité et transcendance va servir d’indication générale à toutes les analyses de ce travail.
[…] Le visage d’Autrui détruit à tout moment, et déborde l’image plastique qu’il me laisse, l’idée à ma mesure et à la mesure de son ideatum — l’idée adéquate. Il ne se manifeste pas par ces qualités, mais kathauto. Il s’exprime. […] Aborder Autrui dans le discours, c’est accueillir son expression où il déborde à tout instant l’idée qu’en emporterait une pensée. C’est donc recevoir d’Autrui au-delà de la capacité du Moi ; ce qui signifie exactement : avoir l’idée de l’infini. Mais cela signifie aussi être enseigné. Le rapport avec Autrui ou le Discours, est un rapport non-allergique, un rapport éthique, mais ce discours accueilli est un enseignement. »
B. Séparation et discours
1. L’athéisme ou la volonté
L’idée de l’Infini suppose la séparation du Même par rapport à l’Autre. Mais cette séparation ne peut reposer sur une opposition à l’Autre, qui serait purement antithétique. La thèse et l’antithèse, en se repoussant, s’appellent.
[… Le psychisme] est déjà une manière d’être, la résistance à la totalité. […] La cause de l’être est pensée ou connue par son effet comme si elle était postérieure à son effet. […] La postériorité de l’antérieur — inversion logiquement absurde — ne se produit dirait-on que par la mémoire ou par la pensée. Mais l’ « invraisemblable » phénomène de la mémoire ou de la pensée, doit précisément s’interpréter comme révolution dans l’être. Ainsi déjà la pensée théorique — mais en vertu d’une structure plus profonde encore qui la soutient, le psychisme — article la séparation. Non pas reflétée dans la pensée mais produite par elle. L’Après ou l’Effet y conditionne l’Avant ou la Cause : l’Avant apparaît et est seulement accueilli. De même, par le psychisme, l’être qui est dans un lieu, reste libre à l’égard de ce lieu ; posé dans un lieu où il se tient, il est celui qui y vient d’ailleurs ; le présent du cogito, malgré l’appui qu’il se découvre après coup dans l’absolu qui le dépasse, se soutient tout seul — ne fût-ce que pendant un instant, l’espace d’un cogito.
[…] L’être qui pense semble d’abord s’offrir à un regard qui le conçoit, comme intégré dans un tout. En réalité, il ne s’y intègre qu’une fois mort. La vie lui laisse un quant-à-soi, un congé, un ajournement qui est précisément l’intériorité. La totalisation ne s’accomplit que dans l’histoire — dans l’histoire des historiographes — c’est-à-dire chez les survivants. […] L’intériorité comme telle est un « rien », « pure pensée », rien que pensée. […] L’intériorité est la possibilité même d’une naissance et d’une mort qui ne puisent point leur signification dans l’histoire.
[…] La mémoire comme inversion du temps historique est l’essence de l’intériorité.
[…] l’intériorité est le refus de se transformer en un pur passif, figurant dans une comptabilité étrangère. L’angoisse de la mort est précisément dans cette impossibilité de cesser, dans l’ambiguïté d’un temps qui manque et d’un temps mystérieux qui reste encore. […] Le mourir est angoisse, parce que l’être en mourant ne se termine pas tout en se terminant. Il n’a plus de temps, c’est-à-dire ne peut plus porter nulle part ses pas mais va ainsi où on ne peut aller, étouffe ; mais jusqu’à quand ? La non-référence au temps commun de l’histoire, signifie que l’existence mortelle se déroule dans une dimension qui ne court pas parallèlement au temps de l’histoire et qui ne se situe pas par rapport à ce temps, comme par rapport à un absolu. C’est pourquoi la vie entre la naissance et la mort n’est ni folie, ni absurdité, ni lâcheté. Elle s’écoule dans une dimension propre où elle a un sens et où peut avoir un sens un triomphe sur la mort.
[…] La séparation n’est radicale que si chaque être a son temps, c’est-à-dire son intériorité, si chaque temps ne s’absorbe pas dans le temps universel. […] La discontinuité de la vie intérieure interrompt le temps historique. La thèse du primat de l’histoire constitue pour la compréhension de l’être un choix où l’intériorité est sacrifiée. Le présent travail propose une autre option. Le réel ne doit pas seulement être déterminé dans son objectivité historique, mais aussi à partir du secret qui interrompt la continuité du temps historique, à partir des intentions intérieures. Le pluralisme de la société n’est possible qu’à partir de ce secret. Il atteste ce secret. Nous savons depuis toujours, qu’il est impossible de se faire une idée de la totalité humaine, car les hommes ont une vie intérieure fermée à celui qui, cependant, saisit les mouvements globaux de groupes humains. L’accès de la réalité sociale à partir de la séparation du Moi, n’est pas englouti dans l’ « histoire universelle » où n’apparaissent que des totalités. L’expérience de l’Autre à partir d’un Moi séparé, demeure une source de sens pour la compréhension des totalités, comme la perception concrète reste déterminante pour la signification des univers scientifiques. Cronos qui croit avaler un dieu n’avale qu’une pierre.
L’intervalle de la discrétion ou de la mort est une notion troisième entre l’être et le néant.
L’intervalle n’est pas à la vie ce que la naissance est à l’acte. Son originalité consiste à être entre deux temps. Nous proposons d’appeler cette dimension temps mort. La rupture de la durée historique et totalisée, que marque le temps mort, est celle-là même que la création opère dans l’être. La discontinuité du temps cartésien demandant une création continuée, enseigne la dispersion même et la pluralité de la créature. Tout instant du temps historique, où commence l’action, est, enfin de compte, naissance et rompt, par conséquent, le temps continu de l’histoire, temps des œuvres et non pas des volontés. La vie intérieure est la manière unique pour le réel d’exister comme une pluralité […]
On peut appeler athéisme cette séparation si complète que l’être séparé se maintient tout seul dans l’existence sans participer à l’Être dont il est séparé — capable éventuellement d’y adhérer par croyance.
[…] Les individus participant à l’extension d’un concept sont un par ce concept ; les concepts, à leur tour, sont un dans leur hiérarchie ; leur multiplicité forme un tout.
2. La vérité
[…] La vérité suppose un être autonome dans la séparation — la recherche d’une vérité est précisément une relation qui ne se repose pas sur la privation du besoin. Chercher et obtenir la vérité, c’est être en rapport, non pas parce qu’on se définit par autre chose que soi, mais parce que, dans un certain sens, on ne manque de rien.
[…] Le Désir est une aspiration que le Désirable anime ; il naît à partir de son « objet », il est révélation. Alors que la besoin est un vide de l’Âme, il part du sujet.
La vérité se cherche dans l’autre, mais par celui qui ne manque de rien. La distance est infranchissable et, à la fois, franchie. L’être séparé est satisfait, autonome et, cependant, recherche l’autre d’une recherche qui n’est pas aiguillonnée par le manque du besoin — ni par le souvenir d’un bien perdu — une telle situation est langage. La vérité surgit là où un être séparé de l’autre ne s’abîme pas en lui, mais lui parle.
[…] La religion est Désir et non point lutte pour la reconnaissance. Elle est le surplus possible dans une société d’égaux, celui de la glorieuse humilité, de la responsabilité et du sacrifice, condition de l’égalité elle-même.
3. Le discours
[…] Reconnaître la vérité comme dévoilement c’est la rapporter à l’horizon de celui qui dévoile.
[…] Le « qu’est-ce que c’est » aborde le « ceci » en tant que « cela ». Car connaître objectivement, c’est connaître l’historique, le fait, le déjà fait, le déjà dépassé.
[…] L’expérience absolue n’est pas dévoilement mais révélation : coïncidence de l’exprimé et de celui qui exprime, manifestation, par là même privilégiée d’Autrui, manifestation d’un visage par-delà la forme. La forme trahissant incessamment sa manifestation ¬ se figeant en forme plastique, puisque adéquate au Même, aliène l’extériorité de l’Autre. Le visage est une présence vivante, il est expression. La vie de l’expression consiste à défaire la forme où l’étant, s’exposant comme thème, se dissimule par là même. Le visage parle. La manifestation du visage est déjà discours. Celui qui se manifeste porte, selon le mot de Platon, secours à lui-même. Il défait à tout instant la forme qu’il offre. […] La signification ou l’expression [… est,] par excellence, la présence de l’extériorité. Le discours n’est pas simplement une modification de l’intuition (ou de la pensée), mais une relation originelle avec l’être extérieur. Il n’st pas un regrettable défaut d’un être privé d’intuition intellectuelle — comme si l’intuition qui est une pensée solitaire, était le modèle de toute droite dans la relation. Il est la production du sens. Le sens ne se produit pas comme une essence idéale — il est dit et enseignée par la présence, et l’enseignement ne se réduit pas à l’intuition sensible ou intellectuelle, qui est la pensée du Même. Donner un sens à sa présence est un événement irréductible à l’évidence. Il n’entre pas dans une intuition. Il est, à la fois, une présence plus directe que la manifestation visible et une présence lointaine — celle de l’autre. Présence dominant celui qui l’accueille, venant des hauteurs, imprévue et, par conséquent, enseignant sa nouveauté même. Elle est la franche présence d’un étant qui peut mentir, c’est-à-dire dispose du thème qu’il offre, sans pouvoir y dissimuler sa franchise d’interlocuteur, luttant toujours à visage découvert. À travers le masque percent les yeux, l’indissimulable langage des yeux. L’œil ne lui pas, il parle. L’alternative de la vérité et du mensonge, de la sincérité et de la dissimulation, est le privilège de celui qui se tient dans la relation d’absolue franchise, dans l’absolue franchise qui ne peut se cacher.
L’action n’exprime pas. Elle a un sens, mais nous mène vers l’agent en son absence. Aborder quelqu’un à partir des œuvres, c’est entrer dans son intériorité, comme par effraction ; l’autre est surpris dans son intimité, où il s’expose certes, mais ne s’exprime pas, comme les personnages de l’histoire. Les œuvres signifient leur auteur, mais indirectement, à la troisième personne.
[…] La constitution du corps d’Autrui dans ce que Husserl appelle « la sphère primordiale », l’ « accouplement » transcendantal de l’objet ainsi constitué avec mon corps, expérimenté lui-même de l’intérieur comme un « je peux », la compréhension de ce corps d’autrui, comme d’un alter ego — dissimule, dans chacune de ses étapes que l’on prend pour une description de la constitution, des mutations de la constitution d’objet en une relation avec Autrui — laquelle est aussi originelle que la constitution dont on cherche à la tirer.
[…] Je-Tu est événement (Geschehen), choc, compréhension — mais ne permet pas de rendre compte (si ce n’est que comme d’une aberration, d’une chute ou d’une maladie) d’une vie autre que l’amitié : l’économie, la recherche, la recherche du bonheur, la relation représentative avec les choses. […Ce travail] se place dans une perspective différence, en partant de l’idée de l’Infini.
La prétention de savoir et d’atteindre l’Autre, s’accomplit dans la relation avec autrui, laquelle se coule dans la relation du langage dont l’essentiel est l’interpellation ; le vocatif. L’autre se maintient et se confirme dans son hétérogénéité aussitôt qu’on l’interpelle et fût-ce pour lui dire qu’on ne peut lui parler, pour le classer comme malade, pour lui annoncer sa condamnation à mort ; en même temps que saisi, blessé, violenté, il est “respecté”. L’invoqué n’est pas ce que je comprends : il n’est pas sous catégorie. Il est celui à qui je parle — il n’a qu’une référence à soi, il n’a pas de quiddité. Mais la structure formelle de l’interpellation doit être développée.
L’objet de la connaissance est toujours fait, déjà fait et dépassé. L’interpellé est appelé à la parole, sa parole consiste à « porter secours » à sa parole — à être présent. Ce présent n’est pas fait d’instants mystérieusement immobilisés dans la durée, mais d’une reprise incessante des instants qui s’écoulent par une présence qui leur porte secours, qui en répond. Cette incessance produit le présent, est la présentation,— la vie — du présent. Comme si la présence de celui qui parle inversait le mouvement inévitable qui conduit le mot proféré vers le passé du mot écrit. L’expression est l’actualisation de l’actuel. Le présent se produit dans cette lutte, (si on peut dire) contre le passé, dans cette actualisation. L’actualité unique de la parole l’arrache à la situation où elle paraît et qu’elle semble prolonger. Elle apporte ce dont la parole écrite est déjà prive : la maîtrise. La parole, mieux qu’un simple signe, est essentiellement magistrale. Elle enseigne avant tout cet enseignement même, grâce auquel elle peut seulement enseigner (et non pas, comme la maïeutique éveiller en moi) choses et idées. Les idées m’instruisent à partir du maître qui me les présente : qui les met en cause ; l’objectivation et le thème auxquels accède la connaissance objective, reposent déjà sur l’enseignement. La mise en question des choses dans un dialogue, n’est pas la modification de leur perception, elle coïncide avec leur objectivation. L’objet s’offre, lorsque nous avons fait accueil à un interlocuteur. Le maître — coïncidence de l’enseignement et de l’enseignant — n’est pas un fait quelconque, à son tour. Le présent de la manifestation du maître qui enseigne, surmonte l’anarchie du fait.
Le langage ne conditionne pas la conscience sous le prétexte qu’il fournit à la conscience de soi une incarnation dans une œuvre objective qui serait le langage, comme le voudraient les hégéliens. L’extériorité que dessine le langage — relation avec Autrui — ne ressemble pas à l’extériorité d’une œuvre, car l’extériorité objective de l’œuvre se situe déjà dans le monde qu’instaure le langage c’est-à-dire la transcendance. »
4. Rhétorique et injustice
« N’importe quel discours n’est pas relation avec l’extériorité.
Ce n’est pas l’interlocuteur notre maître que nous abordons le plus souvent dans nos discours, ais un objet ou un enfant, ou un homme de la multitude, comme le dit Platon. [… La rhétorique] aborde l’Autre non pas de face, mais de biais ; non pas certes comme une chose — puisque la rhétorique demeure discours et que, à travers tous ses artifices, elle va vers Autrui, sollicite son oui. Mais la nature spécifique de la rhétorique (de la propagande, de la flatterie, de la diplomatie, etc.) consiste à corrompre cette liberté. C’est pour cela qu’elle est violence par excellence, c’est-à-dire injustice. Non point violence s’exerçant sur une inertie — ce ne serait pas violence — mais sur une liberté, laquelle, comme liberté précisément, devrait être incorruptible. À la liberté, elle sait appliquer une catégorie — elle semble en juger comme d’une nature, elle pose la question contradictoire dans ses termes : « quelle est la nature de cette liberté ? »
[…] L’Autre en tant qu’autre est Autrui. Il faut la relation du discours pour le « laisser être » ; le « dévoilement » pur, où il se propose comme un thème, le respecte pas assez comme cela. Nous appelons justice cet abord de face, dans le discours. Si la vérité surgit dans l’expérience absolue où l’être luit de sa propre lumière, la vérité ne se produit que dans le véritable discours ou dans la justice.
[…] La vérité se rattache ainsi au rapport social qui est justice. La justice consiste à reconnaître en autrui mon maître. L’égalité entre personnes ne signifie rien par elle-même. Elle a un sens économique et suppose l’argent et repose déjà sur la justice — qui bien ordonnée, commence par autrui. Elle est reconnaissance de son privilège d’autrui, et de sa maîtrise, accès à autrui en dehors de la rhétorique qui est ruse, emprise et exploitation. Et, dans ce sens, dépassement de la rhétorique et justice coïncident.
5. Discours et Éthique
« […] Autrement dit, le langage se parle là où manque la communauté entre les termes de la relation, là où manque, où doit seulement se constituer le plan commun. Il se place dans cette transcendance. Le Discours est ainsi expérience de quelque chose d’absolument étranger, « connaissance » ou « expérience » pure, traumatisme de l’étonnement.
L’absolument étranger seul peut nous instruire. Il n’y a que l’homme qui puisse m’être absolument étranger — réfractaire à toute typologie, à tout genre, à toute caractérologie, à toute classification — et, par conséquent, terme d’une « connaissance » enfin pénétrant au-delà de l’objet. L’étrangeté d’autrui, sa liberté même ! Seuls les êtres libres peuvent être étrangers les uns aux autres. La liberté qui leur est « commune » est précisément ce qui les sépare. La « connaissance pure », le langage, consiste dans le rapport avec un être qui dans un certain sens, n’est pas par rapport à moi ; ou, si l’on veut, qui n’est en rapport avec moi que dans la mesure où il est entièrement par rapport à soi, kath’auto être qui se place par-delà tout attribut, lequel aurait précisément pour effet de le qualifier, c’est-à-dire de le réduire à ce qui lui est commun avec d’autres êtres ; être, par conséquent, parfaitement nu.
[…] La chose est toujours une opacité, une résistance, une laideur.
[…] Dévoiler quelque chose c’est l’éclairer par la forme : lui trouver une place dans le tout en apercevant sa fonction ou sa beauté.
[…] L’étrangeté qui est liberté, est aussi l’étrangeté-misère. La liberté se présente comme l’Autre ; au Même qui, lui, est toujours l’autochtone de l’être, toujours privilégié en sa demeure. L’autre, le libre est aussi l’étranger. La nudité de son visage se prolonge dans la nudité du corps qui a froid et qui a honte de sa nudité. L’existence kath’auto est, dans le monde, une misère. Il y a là entre moi et l’autre un rapport qui est au-delà de la rhétorique.
Ce regard qui supplie et exige — qui ne peut supplier que parce qu’il exige — privé de tout parce que ayant droit à tout et qu’on reconnaît en donnant (tout comme on « met les choses en question en donnant ») — ce regard est précisément l’épiphanie du visage comme visage. La nudité du visage est dénuement. Reconnaître autrui, c’est reconnaître une faim. Reconnaître Autrui — c’est donner. Mais c’est donner au maître, au seigneur, à celui que l’on aborde comme « vous » dans une dimension de hauteur.
C’est dans la générosité que le monde possédé par moi — monde offert à la jouissance — est aperçu d’un point de vue indépendant de la position égoïste. L’ « objectif » n’est pas simplement objet d’une impassible contemplation. Ou plutôt la contemplation impassible se définit par le don, par l’abolition de la propriété inaliénable. La présence d’Autrui équivaut à cette mise en question de ma joyeuse possession du monde. La conceptualisation du sensible tient déjà à cette coupure dans la chair vive de ma substance, de ma maison, dans cette convenance du mien à Autrui, qui prépare la descente des choses au rang de marchandises possibles. Ce dessaisissement initial conditionne l’ultérieure généralisation par l’argent. La conceptualisation est la généralisation première et le conditionnement de l’objectivité. Objectivité coïncide avec l’abolition de la propriété inaliénable —ce qui suppose l’épiphanie de l’Autre. Tout le problème de la généralisation se pose ainsi comme problème de l’objectivité. Le problème de l’idée générale et abstraire ne peut pas supposer l’objectivité comme constituée : l’objet général n’est pas un objet sensible, mais seulement pensée dans une intention de généralité et d’idéalité. Car la critique nominaliste de l’idée générale et abstraite n’est pas surmontée pour autant ; il faut encore dire ce que signifie cette intention d’idéalité et de généralité. Le passage de la perception au concept appartient à la constitution de l’objectivité de l’objet perçu. On ne doit pas parler d’une intention d’idéalité, revêtant la perception, à travers laquelle l’être solitaire du sujet s’identifiant dans le Même, se dirige sur le monde transcendant des idées. La généralité de l’Objet est corrélative de la générosité du sujet allant vers Autrui, par-delà la jouissance égoïste et solitaire, et faisant éclater, dès lors, dans la propriété exclusive de la jouissance, la communauté des biens de ce monde.
Reconnaître autrui, c’est donc l’atteindre à travers le monde des choses possédées, mais, simultanément, instaurer, par le don, la communauté et l’universalité. Le langage est universel parce qu’il est le passage même de l’individuel au général, parce qu’il offre des choses miennes à autrui. Parler c’est rendre le monde commun, créer des lieux communs. Le langage ne se réfère pas à la généralité des concepts, mas jette les bases d’une possession en commun. Il abolit la propriété inalinable de la jouissance. Le monde dans le discours, n’est plus ce qu’il est dans la séparation — le chez moi où tout m’est donné — il est ce que je donne — le communicable, le pensé, l’universel. »
6. La Métaphysique et l’humain
7. Le face à face, relation irréductible
« […] Si la totalité ne peut se constituer, c’est que l’Infini ne se laisse pas intégrer. Ce n’est pas l’insuffisance du Moi qui empêche la totalisation, mais l’Infini d’Autrui.
[…] Le Même et l’Autre ne sauraient entrer dans une connaissance qui les embrasserait. […] Même quand j’aurai relié Autrui à moi par la conjonction « et », Autrui continue à me faire face, à se révéler dans son visage. La religion sous-tend cette formelle totalité. Et si j’énonce, comme dans une vision dernière et absolue, la séparation et la transcendance dont il est question dans cet ouvrage même, ces relations que je prétends la trame de l’être lui-même se nouent déjà au sein de mon discours présent tenu à mes interlocuteurs : immanquablement l’Autre me fait face — hostile, ami, mon maître, mon élève — à travers mon idée de l’Infini. La réflexion, certes, peut prendre conscience de ce face à face, mais la position « contre-nature » de la réflexion n’est pas un hasard dans la vie de la conscience. Elle implique une mise en question de soi, une attitude critique qui se produit elle-même en face de l’Autre et sous son autorité. […] Le face à face demeure situation ultime. »
C. Vérité et justice
1. La liberté mise en question
« […] La vérité, en effet, ne se sépare pas de l’intelligibilité. Connaître, ce n’est pas simplement constater, mais toujours comprendre. On dit aussi, connaître c’est justifier, en faisant intervenir, par analogie avec l’ordre moral, la notion de justice. La justification du fait consiste à lui enlever le caractère de fait, d’accompli, de passé et, par là, d’irrévocable qui, comme tel, met obstacle à notre spontanéité. Mais dire que, obstacle à notre spontanéité, le fait est injuste, c’est supposer que la spontanéité ne se met pas en question, que l’exercice libre n’est pas soumis aux normes, mais est la norme. Et cependant, le souci d’intelligibilité se distingue foncièrement d’une attitude qui engendre une action sans égard pour l’obstacle. Il signifie au contraire un certain respect de l’objet. Pour que l’obstacle devienne un fait qui demande une justification théorique ou une raison, il a fallu, que la spontanéité de l’action la surmonte soit inhibée, c’est-à-dire mise elle-même en question. C’est alors que nous passons d’une activité sans égard pour rien à une considération du fait. La fameuse suspension de l’acte qui rendrait la théorie possible, tient à une réserve de la liberté qui ne se livre pas à ses élans, à ses mouvements primesautiers et garde les distances. La théorie où surgit la vérité, est l’attitude d’un être qui se méfie de soi. Le savoir ne devient savoir d’un fait que si, en même temps, il est critique, s’il se met en question, remonte au-delà de son origine (mouvement contre nature, qui consiste à quérir plus haut que son origine et qui atteste ou décrit une liberté créée).
Cette critique de soi peut se comprendre, soit comme une découverte de sa faiblesse, soit comme une découverte de son indignité : c’est-à-dire, soit comme une conscience de l’échec, soit comme une conscience de la culpabilité. Dans le dernier cas, justifier la liberté, ce n’est pas la prouver, mais la rendre juste.
[…] La liberté ne se met en question que dans la mesure où elle se trouve, en quelque façon, imposée à elle-même : si j’avais pu avoir librement choisi mon existence, tout serait justifié. L’échec de ma spontanéité, encore dépourvue de raison, réveille la raison et la théorie ;il y aurait eu une douleur qui serait mère de la sagesse. De l’échec seulement viendrait la nécessité de mettre un frein à la violence et d’introduire de l’ordre dans les relations humaines.
[…] Autrui n’est pas initialement fait, n’est pas obstacle, ne me menace pas de mort. Il est désiré dans ma honte. Pour découvrir la facticité injustifiée du pouvoir et de la liberté, il faut non pas la considérer comme objet, ni considérer Autrui comme objet, il faut se mesure à l’infini, c’est-à-dire le désirer. Il faut avoir l’idée de l’infini, l’idée du parfait, comme dirait Descartes, pour connaître sa propre imperfection. L’idée du parfait n’est pas idée, mais désir. C’est l’accueil d’Autrui, le commencement de la conscience morale, qui met en question ma liberté. Cette façon de se mesurer à la perfection de l’infini, n’est donc pas une considération théorétique. Elle s’accomplit comme honte où la liberté se découvre meurtrière dans son exercice même. Elle s’accomplit dans la honte où la liberté, en même temps qu’elle se découvre dans la conscience de la honte, se cache dans la honte même. La honte n’a pas la structure de la conscience et de la clarté, mais est orientée à l’envers. Son sujet m’est extérieur. Le Discours et le Désir où autrui se présente comme interlocuteur, comme celui sur qui je ne peux pas pouvoir, que je ne peux pas tuer, conditionnent cette honte où, en tant que moi, je ne suis pas innocente spontanéité, mais usurpateur et meurtrier. Par contre, l’infini, l’Autre en tant qu’Autre, n’est pas adéquat à une idée théorique d’un autre moi-même, déjà pour cette simple raison qu’il provoque ma honte et qu’il se présente comme dominant. Son existence justifiée est le fait premier, le synonyme de la perfection même. Et si l’autre peut m’investir et investir ma liberté par elle-même arbitraire, c’est que moi-même je peux en fin de compte, me sentir comme l’Autre de l’Autre. Mais cela ne s’obtient qu’à travers des structures fort complexes.
La conscience morale accueille autrui. C’est la révélation d’une résistance à mes pouvoirs, qui ne les met pas, comme force plus grande, en échec, amis qui met en question le droit naïf de mes pouvoirs, ma glorieuse spontanéité de vivant. La morale commence lorsque la liberté, au lieu de se justifier par elle-même, se sent arbitraire et violente. La recherche de l’intelligible, mais aussi la manifestation de l’essence critique du savoir, la remontée d’un être en deçà de sa condition — commence du même coup. »
2. L’investiture de la liberté ou la critique
« L’existence en réalité, n’est pas condamnée à la liberté, mais est investie comme liberté. La liberté, n’est pas nue. Philosopher, c’est remonter en deçà de la liberté, découvrir l’investiture qui libère la liberté de l’arbitraire. Le savoir comme critique, comme remontée en deçà de la liberté — ne peut surgir que dans un être qui a une origine en deçà de son origine — qui est créé.
La critique ou la philosophie est l’essence du savoir. Mais le propre du savoir n’est pas dans sa possibilité d’aller vers un objet, mouvement par lequel il s’apparente aux autres actes. Son privilège consiste à pouvoir se mettre en question, à pénétrer en deçà de sa propre condition. Il est en retrait par rapport au monde non pas parce qu’il a le monde pour objet ; il peut avoir le monde pour thème, en faire un objet, parce que son exercice consiste à tenir en main, en quelque façon, la condition même qui le soutient et qui soutient jusqu’à cet acte même de tenir en main.
[…] Le savoir dont l’essence est critique, ne peut se réduire à la connaissance objective. Il conduit vers Autrui. Accueillir Autrui, c’est mettre ma liberté en question.
[…] Avant le cogito, l’existence se rêve elle-même, comme si elle restait étrangère à soi. C’est parce qu’elle soupçonne qu’elle se rêve, qu’elle se réveille. Le doute lui fait rechercher la certitude. Mais ce soupçon, cette conscience du doute, suppose l’idée du Parfait. Le savoir du cogito renvoie ainsi à une relation avec le Maître — à l’idée de l’infini ou du Parfait. L’idée de l’Infini n’est ni l’immanence du je pense, ni la transcendance de l’objet. Le cogito s’appuie chez Descartes sur l’Autre qui est Dieu et qui a mis dans l’âme l’idée de l’infini, qui l’avait enseignée, sans susciter simplement, comme le maître platonicien, la réminiscence de visions anciennes.
Le savoir comme acte ébranlant sa condition — se joue par là même, au-dessus de tout acte. Et si la remontée à partir d’une condition en deçà de cette condition, décrit le statut de la créature, où se nouent l’incertitude de la liberté et son recours à la justification, si le savoir est une activité de créature, cet ébranlement e la condition et cette justification viennent d’Autrui. Autrui seul échappe à la thématisation. La thématisation ne peut servir à fonder la thématisation — car elle la suppose déjà fondée, elle est l’exercice d’une liberté sûre d’elle-même dans sa spontanéité naïve ; alors que la présence d’Autrui n’équivaut pas à sa thématisation et ne requiert pas, par conséquent, cette spontanéité naïve et sûre d’elle-même. L’accueil d’autrui est ipso facto la conscience de mon injustice — la honte que la liberté éprouve pour elle-même. Si la philosophie consiste à savoir d’une façon critique, c’est-à-dire à chercher un fondement à sa liberté à la justifier, elle commence avec la conscience morale où l’Autre se présente comme Autrui et où le mouvement de la thématisation s’inverse. Mais cette inversion ne revient pas à « se connaître » comme thème visé par autrui ; mais à se soumettre à une exigence, à une moralité. Autrui me mesure d’un regard incomparable à celui par lequel je le découvre. La dimension de hauteur où se place Autrui, est comme la courbure première de l’être à laquelle tient le privilège d’Autrui, le dénivellement de la transcendance. Autrui est métaphysique. Autrui n’est pas transcendant parce qu’il serait libre comme moi. Sa liberté, au contraire, est une supériorité qui vient de sa transcendance même. […] Le rapport avec Autrui ne se mue pas, comme la connaissance, en jouissance et possession, en liberté. Autrui s’impose comme une exigence qui domine cette liberté et, dès lors, comme plus originelle que tout ce qui se passe en moi. Autrui dont la présence exceptionnelle s’inscrit dans l’impossibilité éthique où je suis de le tuer, indique la fin des pouvoirs. Si je ne peux plus pouvoir sur lui, c’est qu’il déborde absolument toute idée que je peux avoir de lui. […] La présence d’Autrui — hétéronomie privilégiée — ne heurte pas la liberté, mais l’investit. […] L’essence de la raison ne consiste pas à assurer à l’homme un fondement et des pouvoirs, mais à le mettre en question et à l’inviter à la justice. »
3. La vérité suppose la justice
a) L’anarchie du spectacle : le malin génie
« Le monde silence est un monde qui nous vient d’autrui, fût-il malin génie. Son équivoque s’insinue dans une raillerie. Le silence n’est pas, ainsi, une simple absence de parole ; la parole est au fond du silence comme un rire perfidement retenu. »
b) L’expression est le principe
« Le monde est offert dans le langage d’autrui, des propositions l’apportent. Autrui est principe du phénomène. Le phénomène ne se déduit pas de lui ; on ne le retrouve pas en remontant du signe que serait la chose, vers l’interlocuteur donnant ce signe, dans un mouvement analogue à la marche qui conduirait de l’apparence vers les choses en soi. Car la déduction est une manière de penser qui s’applique à des objets déjà donnés. L’interlocuteur ne saurait être est déduit, car la relation entre lui et moi est présupposée par toute preuve. »
c) Le cogito et Autrui
« Le cogito ne fournit pas de commencement à cette itération du rêve. Il y a dans le cogito cartésien, certitude première (mais qui, pour Descartes, repose déjà sur l’existence de Dieu), un arrêt arbitraire, qui ne se justifie pas par lui-même. Le doute au sujet des objets, implique l’évidence de l’exercice même du doute. Nier cet exercice, serait encore affirmer cet exercice. En réalité, dans le cogito, le sujet pensant qui nie ses évidences, aboutit à l’évidence de cette œuvre de négation, mais à un niveau différent de celui où il a nié. Mais, surtout, il aboutit à l’affirmation d’une évidence qui n’est point affirmation dernière ou initiale, car à son tour, elle peut être mise en doute. C’est à un niveau encore plus profonde que s’affirme alors la vérité de la deuxième négation, mais, une fois de plus, comme n’échappant pas à la négation. Ce n’est pas purement et simplement un travail de Sisyphe, puisque la distance chaque fois parcourue n’est pas la même. C’est un mouvement de descente vers un abîme toujours plus profond et que nous avons appelé ailleurs il y a, par-delà l’affirmation et la négation. […]
Le moi dans la négativité se manifestant dans le doute, rompt la participation, mais ne trouve pas dans le cogito tout seul un arrêt. Ce n’est pas moi ¬— c’est l’Autre, qui peut dire oui. De lui vient l’affirmation. Il est au commencement de l’expérience.
d) Objectivité et langage
« Ainsi, le monde silencieux serait an-archique. Le savoir ne pourrait y commencer. Mais déjà comme an-archique — à la limite du non-sens — sa présence à la conscience st dans son attente de la parole qui ne vient pas. Elle apparaît ainsi au sein d’une relation avec Autrui, comme signe qu’Autrui délivre, même s’il dissimule son visage, c’est-à-dire se dérobe au secours qu’il aurait à porter aux signes qu’il délivre et qu’il délivre, par conséquence, dans l’équivoque. […] un monde aussi silencieux ne pourrait même pas s’offrir en spectacle.
Le spectacle, en effet, n’est contemplé que dans la mesure où il a un sens. Le sensé n’est pas postérieur au « vu » au « sensible » — par eux-mêmes insignifiants, et que notre pensée malaxerait ou modifierait d’une certaine façon selon des catégories a priori.
Pour avoir compris le lien indissoluble qui rattache apparition à signification, on a tenté de rendre l’apparition postérieure à la signification — en la situant au sein de la finalité de notre comportement pratique. Ce qui ne fait qu’apparaître, la « pure objectivité », le « rien qu’objectif », ne serait qu’un résidu de cette finalité pratique à laquelle il emprunterait son sens. D’où la priorité du souci par rapport à la contemplation, l’enracinement de la connaissance dans une compréhension qui accède à la « mondanité » du monde et qui ouvre l’horizon à l’apparition de l’objet.
L’objectivité de l’objet est sous-estimée de la sorte. L’antique thèse qui met la représentation à la base de tout comportement pratique — taxée d’intellectualisme — est très vite discréditée. Le regard le plus pénétrant ne saurait découvrir dans la chose sa fonction d’ustensile.
[…] En qualité de pratique — la signification renvoie en fin de compte à l’être qui existe en vue de cette existence même. Elle est ainsi empruntée à un terme qui est fin de lui-même. De sorte que celui qui comprend la signification est indispensable à la série où les choses acquièrent un sens, comme fin de série. Le renvoi qu’implique la signification se terminerait là où le renvoi se fait de soi à soi — dans la jouissance. Le processus naturel auquel les êtres emprunteraient leur sens ne serait pas seulement fini en fait, mais en tant que finalité, il consisterait par essence à aller à un terme, à finir. Or, l’aboutissement est le point où toute signification de moyens selon qu’ils se placent sur la voie qui mène à elle ou s’en écartent. Mais les moyens eux-mêmes, perdent leur signification dans l’aboutissement. La fin est inconsciente dès qu’elle est atteinte.
[…] L’objectivité n’est pas ce qui reste d’un ustensile ou d’une nourriture, séparés du monde où se joue leur être. Elle se pose dans un discours, dans un entre-tien qui propose le monde. Cette proposition se tient entre deux points qui ne constituent pas de système de cosmos, de totalité.
L’objectivité de l’objet et sa signification viennent du langage. Cette façon pour l’objet d’être posé comme thème qui s’offre, enveloppe le fait de signifier ; non pas le fait de renvoyer le penseur qui le fixe à ce qui est signifié (et qui fait partie du même système), mais le fait de manifester le signifiant, l’émetteur du signe, une altérité absolue qui, cependant, lui parle et, par là même, thématise, c’est-à-dire propose un monde. Le monde précisément comme proposé, comme expression, a un sens, mais n’est jamais, pour cette raison même, en original.
e) Langage et attention
f) Langage et justice
« […] Si nous appelons conscience morale une situation où ma liberté est mise en question, l’association ou l’accueil d’Autrui, est la conscience morale. […] Ma liberté n’a pas le dernier mot, je ne suis pas seul. […] La conscience morale et le désir ne sont pas des modalités entre autres de la conscience, mais sa condition. »
D. Séparation et absolu
« Le Même et l’Autre à la fois se tiennent en rapport et s’absolvent de ce rapport, demeurant absolument séparés. L’idée de l’Infini demande cette séparation. Elle fut posée comme la structure ultime de l’être, comme la production de son infinitude même. La société l’accomplit concrètement. Mais aborder l’être au niveau de la séparation, n’est-ce pas l’aborder dans sa déchéance ? Les positions que l’ont vient de résumer contredisent l’antique privilège de l’unité qui s’affirme de Parménide à Spinoza et Hegel. La séparation et l’intériorité seraient incompréhensibles et irrationnelles. La connaissance métaphysique reliant le Même à l’Autre, refléterait alors cette déchéance. La métaphysique s’efforcerait de supprimer la séparation, d’unir. L’être métaphysique devrait absorber l’être métaphysicien. La séparation de fait où la métaphysique commence, résulterait d’une illusion ou d’une faute. Étape que parcourt l’être séparé sur le chemin de retour vers sa source métaphysique, moment d’une histoire qui s’achèvera par l’union, la métaphysique serait une Odyssée et son inquiétude, la nostalgie. Mais la philosophie de l’unité n’a jamais su dire d’où venait cette illusion et cette chute accidentelles, inconcevables dans l’Infini, l’Absolu et le Parfait.
Concevoir la séparation comme déchéance ou privation ou rupture provisoire de la totalité, c’est ne pas connaître d’autre séparation que celle dont témoigne le besoin. Le besoin atteste le vide et le manque dans le besogneux, sa dépendance à l’égard de l’extérieur, l’insuffisance de l’être besogneux, précisément parce qu’il ne possède pas entièrement son être et qui, par conséquent, n’est pas à proprement parle, séparé. L’une des voies de la métaphysique grecque conçoit le Bien comme séparé de la totalité de l’essence et, par là, entrevoit-elle, (sans aucun apport d’une soi-disant pensée orientale) une structure telle que la totalité puisse admettre un au-delà. Le Bien est Bien en soi et non pas par rapport au besoin auquel il manque. Il est un luxe par rapport aux besoins. C’est par là précisément qu’il est au-delà de l’être. Quand un dévoilement fut opposé plus haut à la révélation où la vérité s’exprime et nous illumine avant que nous le cherchions, la notion du Bien en soi fut déjà reprise. Plotin retourne à Parménide, quand il figure par l’émanation et par la descente l’apparition de l’essence à partir de l’Un. […]
L’Infini se produit en renonçant à l’envahissement d’une totlaité dans une contraction laissant une place à l’être séparé. Ainsi, se dessinent des relations qui se fraient une voie en dehors de l’être. Un infini qui ne se ferme pas circulairement sur lui-même, mais qui se retire de l’étendue ontologique pour laisser une place à un être séparé, existe divinement. Il inaugure au-dessus de la totalité une société. Les rapports qui s’établissent entre l’être séparé et l’Infini, rachètent ce qu’il y avait de diminution dans la contraction, créatrice de l’Infini. L’homme rachète la création. La société avec Dieu n’est pas une addition à Dieu, ni un évanouissement de l’intervalle qui sépare Dieu de la créature. Par opposition à la totalisation, nous l’avons appelée religion. La limitation de l’Infini créateur, et la multiplicité — sont compatibles avec la perfection de l’Infini. Elles articulent le sens de cette perfection.
L’Infini s’ouvre l’ordre du Bien. Il s’agit d’un ordre qui ne contredit pas, mais dépasse les règles de la logique formelle. Dans la logique formelle, la distinction entre besoin et Désir ne saurait se refléter ; en elle, le désir se laisse toujours couler dans les formes du besoin. De cette nécessité purement formelle vient la force de la philosophie parménidienne. Mais l’ordre du Désir — de la relation entre étrangers qui ne se manquent pas les uns aux autres, — du désir dans sa positivité — s’affirme à travers l’idée de la création ex-nihilo. Alors s’évanouit le plan de l’être besogneux, avide de ses compléments et s’inaugure la possibilité d’une existence sabbatique où l’existence suspend les nécessités de l’existence. En effet, un étant n’est étant que dans la mesure où il est libre, c’est-à-dire en dehors du système qui suppose dépendance. Toute restriction apportée à la liberté est une restriction apportée à l’être. Pour cette raison la multiplicité serait la déchéance ontologique d’êtres se limitant mutuellement de par leur voisinage. […] La création ex-nihilo rompt le système, pose un être en dehors de tout système, c’est-à-dire là où sa liberté est possible. La création laisse à la créature une trace de dépendance […].
SECTION II
INTÉRIORITÉ ET ÉCONOMIE
A. La séparation comme vie
1. Intentionnalité et relation sociale
2. Vivre de… (jouissance). La notion d’accomplissement
« La nourriture, comme moyen de revigoration, est la transmutation de l’autre en Même, qui est dans l’essence de la jouissance : une énergie autre, reconnue comme autre, reconnue nous le verrons, comme soutenant l’acte même qui se dirige sur elle, devient, dans la jouissance, mon énergie, ma force, moi. Toute jouissance dans ce sens, est alimentation. La faim, est le besoin, la privation par excellence et, dans ce sens précisément, vivre de… n’est pas une simple prise de conscience de ce qui remplit la vie. Ces contenus sont vécus : ils alimentent la vie. On vit sa vie. Vivre est comme un verbe transitif dont les contenus de la vie sont les compléments directs. Et l’acte de vivre ces contenus, est, ipso facto, contenu de la vie. […] Nous vivons dans la conscience de la conscience, mais cette conscience de la conscience n’est pas réflexion. Elle n’est pas savoir, mais jouissance, et, comme nous allons le dire, l’égoïsme même de la vie. […] La vie est amour de la vie […]. Ce que je fais et ce que je suis, est à la fois, ce dont je vis. »
3. Jouissance et indépendance
« […] Et parce que la vie est bonheur, elle est personnelle. »
4. Le besoin et la corporéité
« […] Le corps est la possession même de soi par laquelle le moi, libéré du monde par le besoin, arrive à surmonter la misère même de cette libération. […]
Dès lors, ayant reconnu ses besoins comme besoins matériels, c’est-à-dire comme capable de se satisfaire, le moi peut se tourner vers ce qui ne lui manque pas. Il distingue le matériel du spirituel, s’ouvre au Désir. Le travail requiert cependant déjà le discours et, par conséquent, la hauteur de l’Autre irréductible au Même, la présence d’Autrui. Il n’y a pas de religion naturelle ; mais déjà l’égoïsme humain, sort de la pure nature par le corps humain dressé de bas vers le haut, engagé dans le sens de la hauteur. Il n’en est pas l’illusion empirique, mais la production ontologique et l’ineffaçable témoignage. Le « je peux » procède de cette hauteur.
Notons encore la différence entre besoin et Désir. Dans le besoin, je puis mordre sur le réel et me satisfaire assimiler l’autre. Dans le Désir, pas de morsure sur l’être, pas de satiété, mais avenir sans jalons devant moi. C’est que le temps que suppose le besoin m’est fourni par le Désir. Le besoin humain repose déjà sur le Désir. Le besoin a ainsi le temps de convertir cet autre en même, en travaillant. J’existe comme corps, c’est-à-dire comme exhaussé, organe qui pourra saisir et, par conséquent, se placer, dans ce monde dont je dépends, devant des fins techniquement réalisables. Tout n’est donc pas d’ores et déjà accompli, d’ores et déjà fait, pour un corps qui travaille — et c’est ainsi qu’être corps, c’est avoir du temps au milieu des faits, être moi tout en vivant dans l’autre.
Révélation de la distance, révélation ambiguë, car le temps à la fois détruit la sécurité du bonheur instantané et permet de surmonter la fragilité ainsi découverte. Et c’est la relation avec l’Autre — qui s’inscrit dans le corps comme son élévation — qui rend possible la transformation de la jouissance en conscience et travail. »
5. Affectivité comme ipséité du Moi
« Nous entrevoyons une possibilité de rendre intelligible l’unicité du moi. L’unicité du Moi traduit la séparation. La séparation par excellence est solitude et la jouissance — bonheur ou malheur — sont l’isolement même.
Le moi n’est pas unique comme la Tour Eiffel ou la Joconde. L’unicité du moi ne consiste pas seulement à se trouver en un exemplaire unique, mais à exister sans avoir de genre, sans être individuation d’un concept. L’ipséité du moi consiste à rester en dehors de la distinction de l’individuel et du général. »
6. Le moi de la jouissance n’est ni biologique ni sociologique
[critique du libéralisme]
B. Jouissance et représentation
« Ce dont nous vivons et jouissons ne se confond pas avec cette vie même. Je mange du pain, j’écoute de la musique, je suis le cours de mes idées. Si je vis ma vie, la vie que je vis et le fait de la vivre demeurent cependant distincts. Même s’il est vrai que cette vie elle-même devient continuellement et essentiellement son propre contenu.
Peut-on préciser ce rapport ? La jouissance comme façon dont la vie se rapporte à ses contenus, n’est-elle pas une forme de l’intentionnalité prise au sens husserlien de ce terme, dans une acception très large, comme fait universel de l’existence humaine ? Tout moment de la vie (consciente et même inconsciente, telle que la conscience la devine), est en relation avec un autre que ce moment même. On connaît le rythme selon lequel cette thèse s’expose : toute perception est perception du perçu, toute idée idée d’un idéatum, tout désir, désir d’un désiré, toute émotion, émotion d’un émouvant : mais toute obscure pensée de notre être, s’oriente, elle aussi, vers quelque chose. Tout présent dans sa nudité temporelle, tend vers l’avenir et retourne sur le passé ou reprend ce passé — est prospection et rétrospection. Cependant, dès la première exposition de l’intentionnalité, comme d’une thèse philosophique, apparaissait le privilège de la représentation. La thèse selon laquelle toute intentionnalité est soit une représentation, soit fondée sur une représentation — domine les Logische Untersuchungen et revient comme une obsession dans toute l’œuvre de Husserl. Quel est le rapport entre intentionnalité théorétique de l’acte objectivant, comme Husserl l’appelle, et la jouissance ? »
1. Représentation et constitution
« [… L’intentionnalité objectivante] est un moment nécessaire de l’événement de la séparation en soi, […] et qui s’articule à partir de la jouissance dans la demeure et dans la possession. La possibilité de se représenter et la tentation d’idéalisme qui en découle, bénéficient déjà, certes, de la révolution métaphysique et du rapport avec l’absolument Autre, mais attestent la séparation au sein de cette transcendance même (sans cependant se réduire à un écho de la transcendance).
[…] L’objet de la représentation se détache de l’acte de la représentation — c’est là l’affirmation fondamentale et la plus féconde de la phénoménologie husserlienne […]. Dans un certain sens, l’objet de la représentation est bel et bien intérieur à la pensée : il tombe malgré son indépendance, sous le pouvoir de la pensée. Ce n’est pas à l’ambiguïté berkeleyenne du sentant et du senti au sein de la sensation que nous faisons allusion et nous ne limitons pas notre réflexion aux objets dits sensibles. Il s’agit au contraire de ce qui d’après la terminologie cartésienne devient idée claire et distincte. Dans la clarté un objet, de prime abord extérieur, se donne c’est-à-dire se livre à celui qui le rencontre comme s’il avait été entièrement déterminé par lui. Dans la clarté l’être extérieur se présente comme l’œuvre de la pensée qui le reçoit. L’intelligibilité, caractérisée par la clarté, est une adéquation totale du pensant au pensé, dans le sens très précis d’une maîtrise exercée par le pensant sur le pensé, où s’évanouit dans l’objet sa résistance d’être extérieur. Cette maîtrise est totale et comme créatrice ; elle s’accomplit comme une donation de sens : l’objet de la représentation se réduit à des noèmes. L’intelligible, c’est précisément ce qui se réduit entièrement aux noèmes et dont touts les rapports avec l’intelligence se réduisent à ceux qu’instaure la lumière. Dans l’intelligibilité de la représentation s’efface la distinction entre moi et l’objet — entre intérieur et extérieur. L’idée claire et distincte de Descartes se manifeste comme vraie et entièrement immanente à la pensée : entièrement présente – sans rien de clandestin et dont la nouveauté même est sans mystère. Intelligibilité et représentation sont des notions équivalentes : une extériorité livrant à la pensée dans la clarté et sans impudeur tout son être, c’est-à-dire totalement présente sans que, en droit, rien heurte la pensée, sans que jamais la pensée se sente indiscrète. La clarté est la disparition de ce qui pourrait heurter. L’intelligibilité, le fait même de la représentation, est la possibilité pour l’Autre de se déterminer par le Même, sans déterminer le Même, sans introduire d’altérité en lui, exercice libre du Même. Disparition, dans le Même, du moi opposé au non-moi.
La représentation occupe ainsi, dans l’œuvre de l’intentionnalité, la place d’un élément privilégié. La relation intentionnelle de la représentation, se distingue de toute relation — causalité mécanique ou rapport analytique ou synthétique du formalisme logique, de toute autre intentionnalité que représentative — en ceci : le Même y est en relation avec l’Autre, mais de telle manière, que l’Autre n’y détermine pas le Même, que c’est toujours le Même qui détermine l’Autre. Certes, la représentation est siège de vérité : le mouvement propre de la vérité consiste en ce que l’objet qui se présente au pensant, détermine le pensant. Mais il le détermine sans le toucher, sans peser sur lui ; de telle sorte que le pensant qui se plie au pensé, s’y plie de « bonne grâce », comme si l’objet, jusque dans les surprises qu’il réserve à la connaissance, avait été anticipé par le sujet.
Alors que toute activité, d’une façon ou d’une autre s’éclaire par une représentation, s’avance donc ainsi sur un terrain déjà familier — la représentation est un mouvement partant du Même sans qu’aucun éclaireur le précède. « L’âme est quelque chose de divinatoire » selon l’expression de Platon. Il y a un liberté absolue, créatrice, antérieure à l’aventureuse entreprise de la main qui se risque vers le but qu’elle cherche, car, pour elle, au moins la vision de ce but s’est frayé un passage, s’est déjà projetée. La représentation c’est ce projet lui-même, comme inventant le but qui aux actes, encore tâtonnants, s’offrira comme conquis à priori. l’ « acte » de la représentation ne découvre, à proprement parler, rien devant lui.
La représentation est spontanéité pure, quoique en deçà de toute activité. De sorte que l’extériorité de l’objet représenté, apparaît à la réflexion comme le sens que le sujet représentant prête à un objet, réductible lui-même à une œuvre de pensée.
Certes, le moi qui pense la somme des angles d’un triangle est aussi déterminé par cet objet. Il est précisément celui qui pense cette somme et non pas celui qui pense le poids atomique. Il est déterminé par le fait d’avoir passé par la pensée de la somme des angles qu’il s’en souvienne ou qu’il l’ait oublié. C’est ce qui apparaître à l’historien pour qui le moi se représentant, est déjà un représen