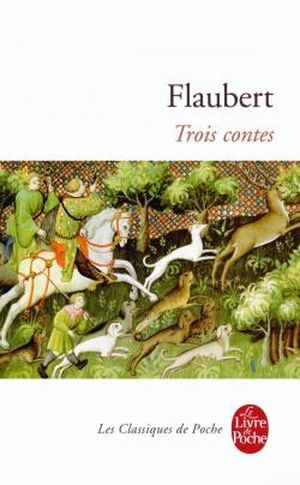J’ai lu ces Trois contes pour avoir un premier contact avec ce monument de la littérature française qu’est Flaubert, et je dois bien dire que, si je n’ai pas non plus été subjugué, ma curiosité a tout de même été bel et bien piquée. Ce court ouvrage vaut vraiment le détour.
Le premier de ces Trois contes est assez simple, certes, mais il est tout de même assez touchant. Il dépeint la vie de Félicité, une domestique de province. Le récit qui se déploie est alors celui d’une vie ingrate ; en raison des diverses difficultés propres à la condition de domestique, d'abord, mais aussi ( et surtout ) en raison des aléas de la vie en général. En tout cas, en dépit de sa simplicité, ce conte n’en conserve pas moins certaines fulgurances littéraires ci et là. Mais surtout, il fonctionne grâce au portrait attendrissant et pathétique de Félicité, qui est d’une grande justesse. Ce conte, s’il n’est donc pas forcément très marquant selon moi, demeure de très bonne facture.
Le deuxième récit est probablement le plus frappant et le plus puissant. Situé dans une époque médiévale au parfum de légende, ce deuxième conte est parcouru par un souffle épique et mystique qui le traverse dès les premières pages. Riche en images saisissantes, cette histoire apparaît comme un périple aventureux et mystérieux frappé du sceau de la fatalité et dans lequel, au milieu des batailles et des récits épiques, se joue l’itinéraire mystique d’un homme torturé qui passera de la grandeur à la misère avant d’accéder au Salut. Flaubert fait avec ce conte une merveilleuse synthèse d’éléments répartis dans les deux autres contes. Le premier insiste plus sur la dimension réaliste du récit, même si, toutefois, dans plusieurs passages, il y a quelques pointes religieuses et spirituelles ( notamment avec ce fameux perroquet qui apparaît comme le Saint-Esprit ) ; le troisième, en tant que récit biblique, apparaît en revanche comme une histoire légendaire absolue, de par son décor, de par ses personnages et, surtout, de par son sujet ; mais ce deuxième conte allie ces différents éléments de façon équilibrée dans un seul et même ensemble tout à fait grandiose.
Le troisième conte est peut-être celui qui a le plus résonné en moi. Il est vrai qu'il est quelque peu confus de par le nombre de ses personnages et légèrement inégal quant à son rythme. Mais le récit qui s’y déploie est envoûtant, languissant et mélancolique ( ce qui est surtout dû au personnage d’Antipas, roi très humain et qui semble ici dépassé par les événements plus que cruel ). Mais, ce qui est vraiment réussi dans ce troisième et dernier conte, c’est son atmosphère, son ambiance ; et cela vient du contexte du conte. Il s’agit, en effet, du récit Évangélique d’Hérode, de Jean-Baptiste et de la danse de Salomé. C’est cet univers légendaire, ancien, lointain, si mystérieux, que Flaubert parvient à retranscrire et à décrire pour nous y immerger. Flaubert donne vie, avec un style réaliste qui accentue la tangibilité de l’action et des personnages, à cet environnement et à ces personnages qui sont tellement ancrés dans notre imaginaire collectif et dans notre patrimoine culturel. On a vraiment l’impression de se transporter dans ces histoires fondatrices des Écritures et de les voir se dérouler devant nous. Aussi, ce conte apparaît comme l’occasion pour Flaubert de satisfaire ses fantasmes orientalistes ( et, du même coup, les nôtres ). A cet égard, les descriptions sont toutes plus somptueuses les unes que les autres ; elles sollicitent notre imaginaire et stimulent nos sens. Parures féminines, sensualité, faste, palais, banquets… tout ce qui fait le charme de ce monde antique qui suscite tant notre curiosité est ici convoqué avec inspiration et finesse pour élaborer des images fortes et évocatrices. J’ai pris goût, du début à la fin, à me laisser transporter dans cette Palestine de l’Empire Romaine, sablonneuse et illuminée par un soleil de plomb.
Un bel ouvrage donc, qui vaut le détour.