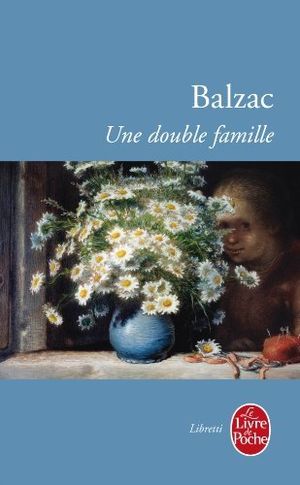Bien sûr, en apparence, Une double famille ne montre pas le meilleur de Balzac : pour commencer quelques tableaux à la Greuze, façon Mère et Fille pauvres au coin du feu, puis un incognito si cousu de fil blanc qu’il en devient vite lassant… Mais voilà : Balzac est un bâtisseur de récits hors pair. C’est-à-dire que même sans utiliser les meilleurs matériaux – en l’occurrence l’histoire assez attendue d’un avocat mal marié qui va chercher la passion entre les bras d’une grisette –, il vous construit un court roman qui fait mieux que tenir la route.
Concrètement, après avoir raconté la naissance et l’établissement de la relation adultère entre Caroline Crochard et Roger de Granville, un peu avant la moitié du roman le narrateur s’interrompt pour annoncer la deuxième partie : « Pour comprendre l’intérêt que cache l’introduction de cette scène, il faut en oublier un moment les personnages, pour se prêter au récit d’événements antérieurs […]. Ces deux parties formeront alors une même histoire qui, par une loi particulière à la vie parisienne, avait produit deux actions distinctes » (p. 47). C’est net, clair, explicite, presque une caricature des interventions balzaciennes.
Le flash-back qui suivra, si long qu’il n’en sera plus un, retracera l’aspect officielle de la vie amoureuse de Roger, qui d’une part en explique l’aspect clandestin, d’autre part en accroît l’intérêt : l’intervention de mi-récit n’était pas mensongère. Cette partie sera par ailleurs l’occasion d’une charge violente contre la bigoterie (1), qui nuance l’idée qu’on peut se faire d’un Balzac apologiste de la religion sur tous les plans.
Et c’est là que ce qu’il pouvait y avoir d’agaçant dans le début trouve son sens et sa justification. Au mièvre tableau de genre de l’introduction répond, « placée dans sa chambre à coucher [de Caroline], la gravure du tableau de Psyché arrivant avec sa lampe pour voir l’Amour malgré sa défense, [qui] lui rappelait les conditions de son bonheur » (p. 40-41). À l’atelier de la jeune brodeuse et de sa mère (« ses grands yeux gris étaient aussi calmes que la rue, et les rides nombreuses de son visage pouvaient se comparer aux crevasses des murs », p. 19) répond l’antichambre de la femme bien née, « cette pièce, peu importante il est vrai, mais qui donne toujours l’idée d’une maison, de même qu’on juge l’esprit d’un homme sur sa première phrase. Une antichambre est une espèce de préface qui doit tout annoncer, mais ne rien promettre » (p. 58-9).
Ce passage n’est d’ailleurs qu’une illustration d’une idée qui explique plus d’une description balzacienne : « S’il est vrai, d’après un adage, qu’on puisse juger une femme en voyant la porte de sa maison, les appartements doivent traduire son esprit avec encore plus de fidélité » (p. 58). Les personnages de la Comédie humaine sont pris dans un perpétuel jeu de parallélismes et d’oppositions qui les définit et les anime. C’est sans doute pour cela que les deux amoureux de la première partie restent longtemps anonymes l’un pour l’autre : parce que la relation conjugale de la seconde sera, au contraire, l’alliance de deux noms – et seulement de noms.
La première partie se concluait sur la mort de la mère de Caroline : « La vieille expira en essayant de prendre un air malicieux. Si Mlle de Bellefeuille [c’est-à-dire Caroline] avait pu observer le visage de sa mère, elle eût vu ce que personne ne verra, rire la Mort » (p. 47). Inutile de dire que la seconde aura sa part de mort, et sa part de rire noir.
Il y aurait bien d’autres choses à dire sur Une double famille, qui me semble notamment annoncer, thématiquement sinon idéologiquement, le naturalisme à venir quelque quarante ans plus tard. Je me contenterai de relever la récurrence des ces digressions de moraliste, parfois très courtes, qui donnent leur goût secret à beaucoup de fictions balzaciennes. Pour le plaisir, une, qui me paraît incontestable : « La dévotion porte à je ne sais quelle humilité fatigante qui n’exclut pas l’orgueil » (p. 61).
(1) : « Cette régularité mesquine, cette pauvreté d’idées que tout trahit, ne s’exprime que par un seul mot, et ce mot est bigoterie. Dans ces sinistres et implacables maisons, la bigoterie se peint dans les meubles, dans les gravures, dans les tableaux : le parler y est bigot, le silence est bigot et les figures sont bigotes. La transformation des choses et des hommes en bigoterie est un mystère inexplicable, mais le fait est là. Chacun peut avoir observé que les bigots ne marchent pas, ne s’asseyent pas, ne parlent pas comme marchent, s’asseyent et parlent les gens du monde ; chez eux l’on est gêné, chez eux l’on ne rit pas, chez eux la raideur, la symétrie règnent en tout, depuis le bonnet de la maîtresse de la maison jusqu’à sa pelote aux épingles ; les regards n’y sont pas francs, les gens y semblent des ombres, et la dame du logis paraît assise sur un trône de glace » (p. 65).